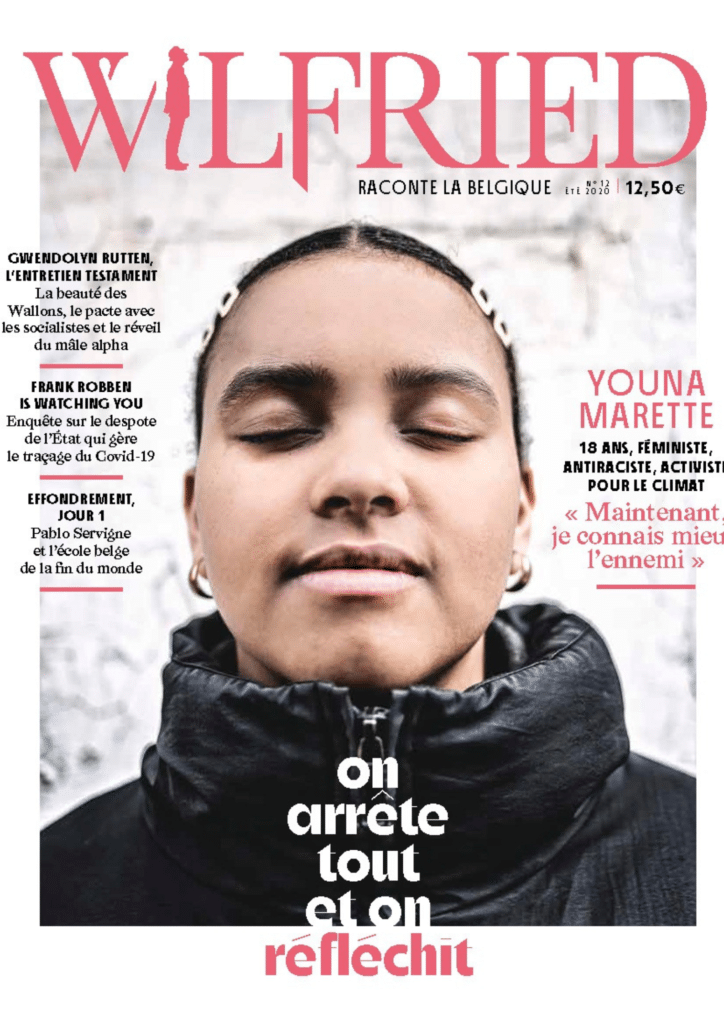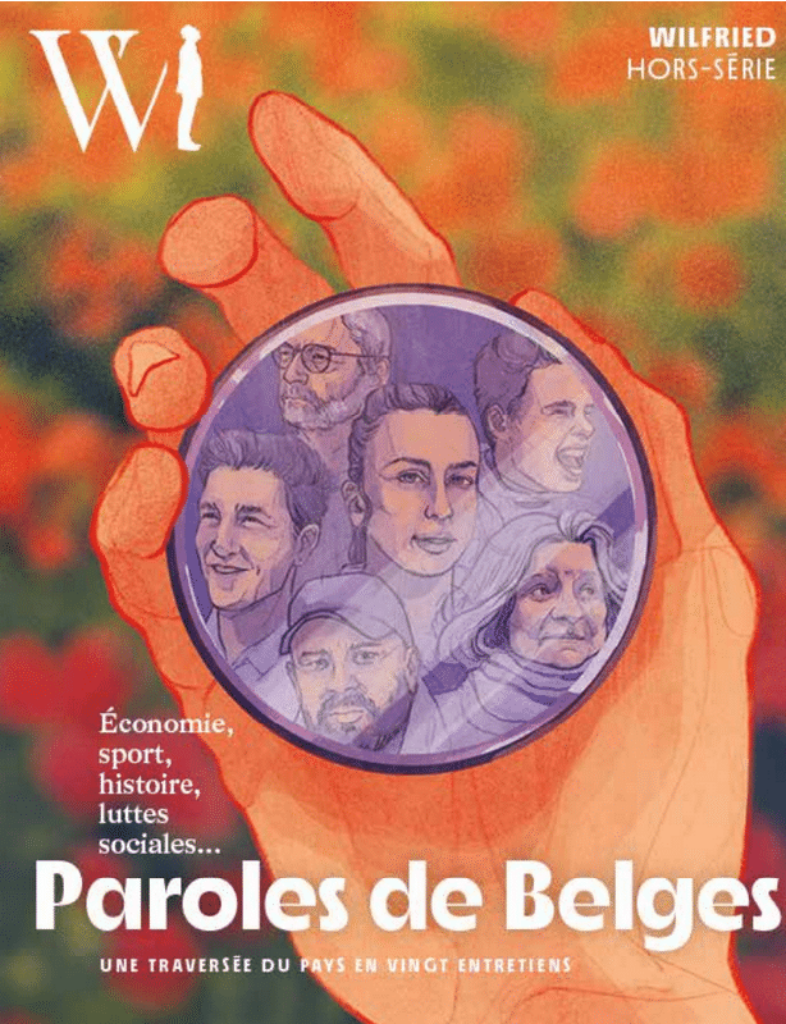Au commencement, les annonceurs de l’effondrement de notre civilisation se comptaient sur les doigts d’une main. De tsunamis en feux de forêts, de krachs boursiers en pandémies, leur cri d‘alarme trouve toujours plus d’écho. Et leurs rangs s’élargissent. « Wilfried » a rencontré deux éminents collapsologues, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. En chemin, nous avons également croisé Philippe Lamberts, député européen, Jacques Crahay, chef d’entreprise, Michèle Gilkinet, objectrice de croissance, Renaud Duterme, professeur de géographie. Ça fait beaucoup de monde, mais l’ultimatum est le même : bon, là, il est vraiment temps de changer de modèle.
C’est un reportage qui ressemble à une escapade fluviale. Une occasion manquée de blottir son anatomie au fond d’un vieux kayak humide. On se serait bien vu, pagaie à la main, glisser tranquillement sur la Dyle. Remonter l’Escaut à la seule force des bras. Zigzaguer, hilare, sur le canal Bruxelles-Charleroi. Flirter avec le Samson. Taquiner la Semois. Allez savoir pourquoi : le voyage qui va suivre est peuplé de cours d’eau. Ceux-là mêmes dont le niveau tient les observateurs en alerte en cette période de sécheresse accrue. Comme un rappel permanent au sujet qui nous occupe. Des menaces pèsent sur notre