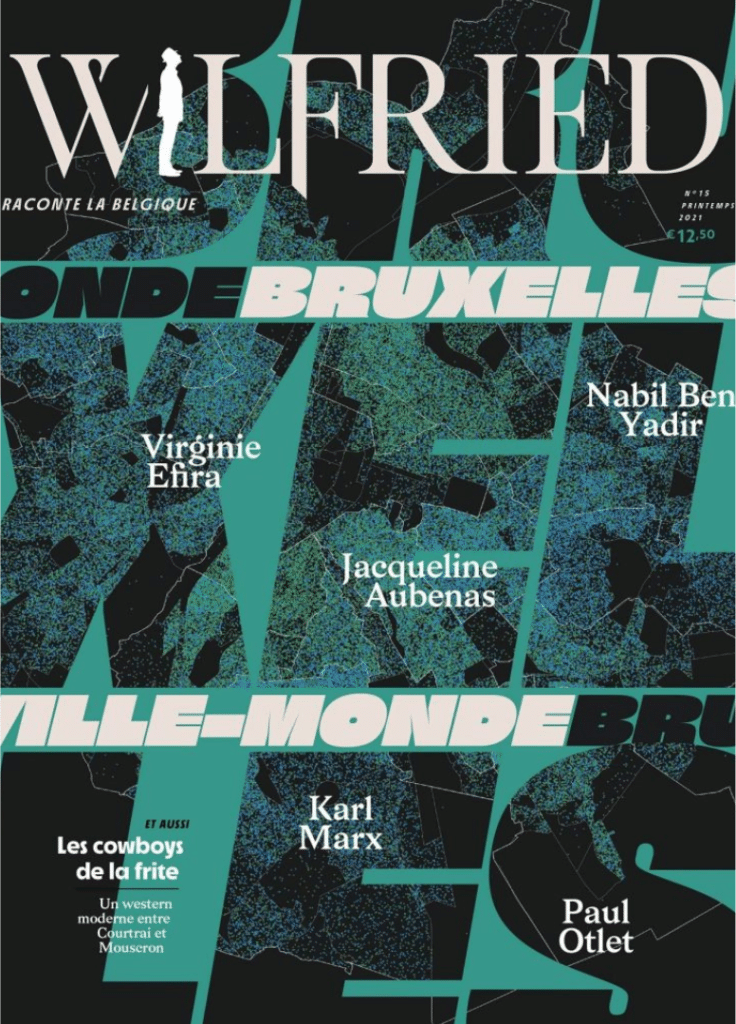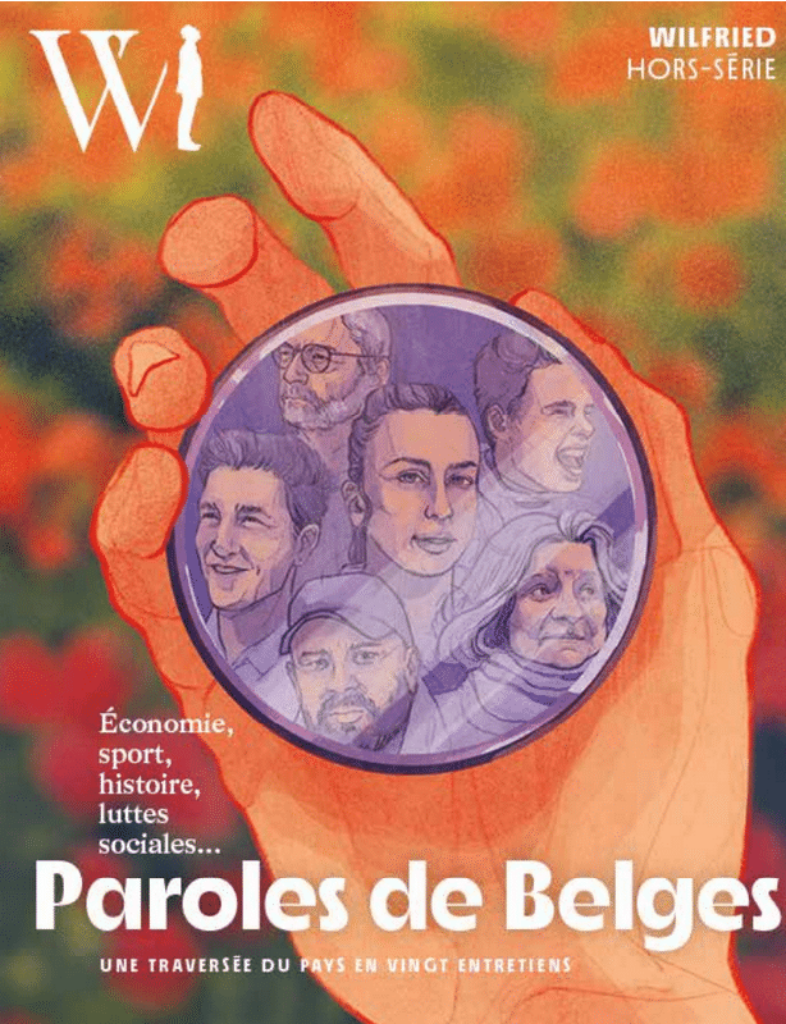Avec son film « Les Barons », Nabil Ben Yadir plaçait Molenbeek sur la carte de la comédie à succès. Le réalisateur s’est depuis considérablement éloigné du rire et de la légèreté. À l’entendre, son nouveau long-métrage, inspiré de l’affaire Ihsane Jarfi – trentenaire gay torturé et tué à Liège en 2012 – et toujours dans l’attente de pouvoir sortir en salles, est le plus violent et le plus dérangeant de l’histoire du cinéma belge. Chez Nabil Ben Yadir, la politique n’est donc jamais loin. Surtout si c’est pour étudier la Belgique, ce pays qui l’intrigue, et sa capitale, cette ville qu’il adore « par fainéantise ».
Ce matin-là, il porte sur le torse les lettres imprimées d’un sweat à capuche : Human Republic. Deux mots pour une doctrine politique, pour une ligne de vie. Ce pourrait être de la plate béatitude s’il n’y avait aussi dans la façon qu’a Nabil Ben Yadir de voir le monde, de le scruter, de le filmer, toutes les nuances d’une âme parfois sombre. En trois longs-métrages, le cinéaste bruxellois a construit un style propre, infusé de rires et de violence, à parts presque égales. Les Barons, en 2009, chroniquait les jours d’une clique de combinards imaginatifs, entre petites arnaques et tournicotis