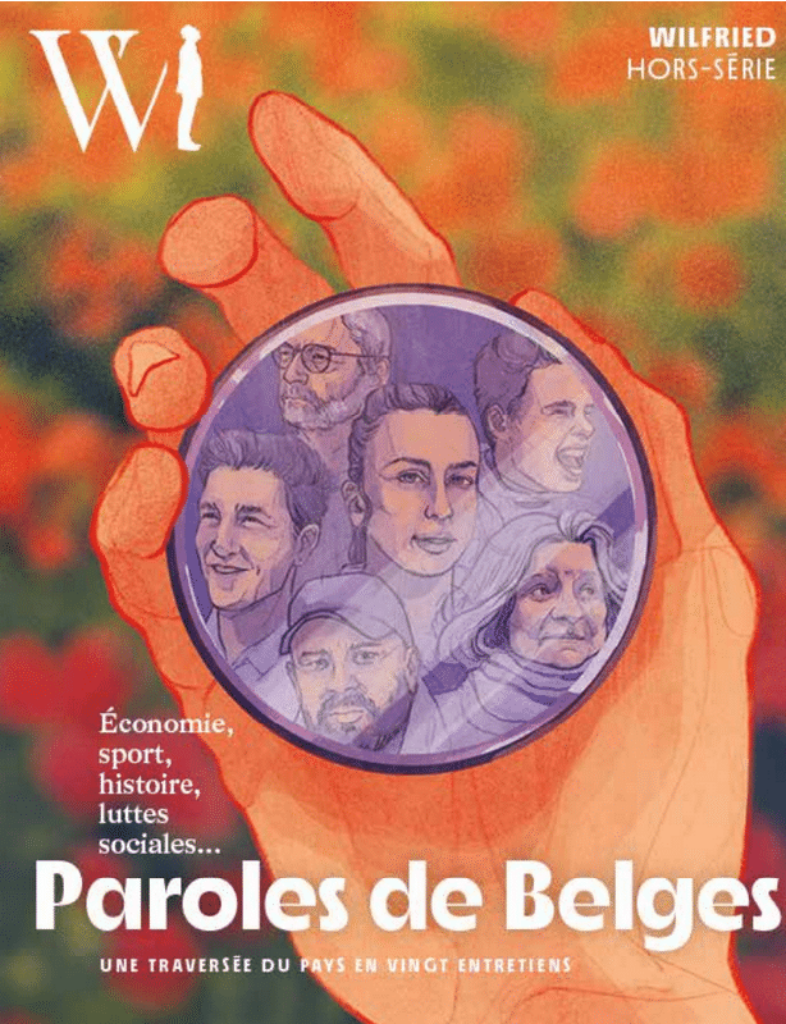Le roman national l’avait évacué, voilà que l’épisode surgit enfin du néant collectif. Entre 1914 et 1918, alors que la population belge subit les supplices de la guerre, le gouvernement de Charles de Broqueville trouve exil dans un palace de quarante-deux chambres avec vue sur mer à Sainte- Adresse, près du Havre. On boit du Château Laroze 1900, on mange des filets de sole, on joue au tennis et, de temps en temps, pour tromper l’ennui, on parle politique. Durant quatre ans, la station balnéaire normande devient belge, jusqu’à ce que le « manoir du Cluedo » déplore ses petits meurtres.
Pour l’élite de la nation, la Première Guerre mondiale a le goût d’un palace. Vue sur la mer, électricité à tous les étages et baignoires moussantes. Pour la grande majorité de la population belge, la période se déroule tout autrement, dans des logis pauvres en eau et en chauffage, dans des maisons parfois le ventre à l’air, trouées par la mitraille… Ce pan d’histoire est décadent. Les années d’exil du gouvernement de Charles de Broqueville, en Normandie, dans la commune de Sainte-Adresse, forment une parenthèse dorée et une tache gênante. Au point que les livres d’histoire préfèrent se concentrer sur