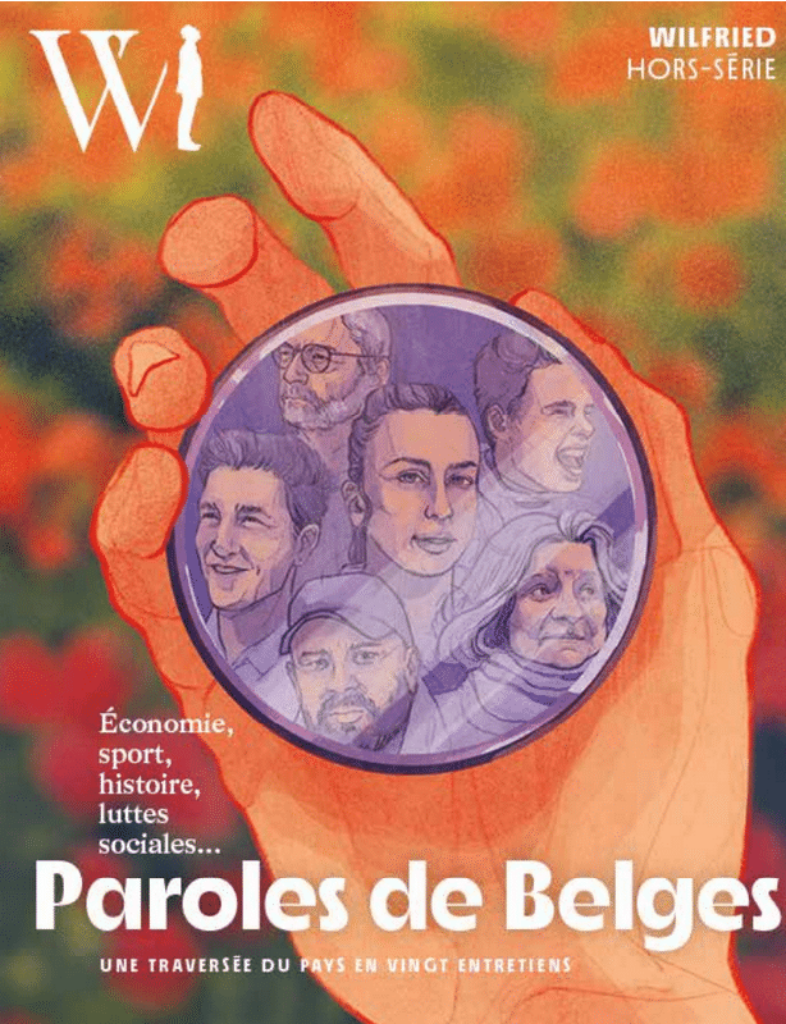‘Nous avons les mains rouges’ est un roman oublié qui, en 2021, n’a rien perdu de sa pertinence. Pour l’édito de son douzième numéro, Wilfried a rouvert cet ouvrage, récent lauréat du Prix Mémorable.
[:fr]Ce sont des montagnes où ruisselle une eau glacée, où les printemps sont éruptifs. Des montagnes recouvertes d’une forêt dense où l’on s’est battu à mort, où l’on s’est planqué, pour échapper à l’ennemi ou lui tendre une embuscade. Des montagnes où la vie a ensuite repris ses droits. À la scierie de M. d’Essartaut, on équarrit le bois. On fait bouillir l’eau pour la tisane. On astique le camion.
Le village se nomme Sainte-Macreuse. La rivière est le Dransot. Le bourg en contrebas s’appelle Rocheguindeau. Toponymie fictive. Pas d’autres indications géographiques. On imagine volontiers le Haut-Jura. On sent les reliefs d’un massif rigoureux. On devine que la frontière suisse n’est pas loin.
Il n’y a guère de dates dans le roman. De toute évidence, il est à peu près contemporain de sa première publication, en 1947 aux éditions Gallimard. Son auteur, là aussi, a semé quelques indices : les jeunes filles en fleur connaissent par cœur les paroles de Charles Trenet; dans les bals, les orchestres jouent des airs américains, pour faire moderne. La guerre est finie. Se pose la question du monde d’après. Quelle société nouvelle ? Va-t-on tout recommencer comme avant ? Épargnera-t-on les incapables, les profiteurs et les salauds ?
Ces questions hantent Nous avons les mains rouges, quatrième roman de Jean Meckert, réédité au début de l’année 2020 aux éditions Joëlle Losfeld. On y retrouve le style direct, souvent argotique, qui fera ensuite la patte de l’auteur à la Série noire, sous le pseudonyme de Jean Amila. Mais le polar prend ici des airs de tragédie, quelque part entre Sophocle et Simenon. Son héroïne, d’ailleurs, porte un prénom grec, Hélène, comme celle qui dans L’Iliade déclenche des flots de colère.
Hélène, 20 ans, est la fille aînée de M. d’Essartaut, le patron de la scierie. Autour d’eux, il y a Armand, l’ouvrier bourru, au tatouage de sirène sur le biceps droit, et Bertod, le pasteur protestant, et un garagiste, et le fils du château… Ce qui les unit, ce sont les liens de la Résistance, l’honneur d’avoir été maquisards, les mains rouges de sang. C’est peu dire que la tournure que prend l’après-guerre les déçoit. Tant de morts pour qu’en fin de compte, rien ne change ? Pour que les collabos dégoûtants se recasent sans gêne ? Pour que les comédiens et les habiles trustent les postes de pouvoir ? «On nous berne et on nous ensevelit», enrage Hélène. Dans un style plus fleuri, M. d’Essartaut fulmine contre «la vomissure jouisseuse et égoïste, la race hargneuse dans le quotidien, amorphe dans les grandes choses, vindicative et intéressée, souple, roublarde, larmoyeuse et méchante, d’où est issu directement le bourgeois moyen».
Noyés dans la masse des électeurs, M. d’Essartaut et son groupe d’ex-résistants savent n’avoir rien à espérer de la démocratie. Alors la petite clique se décide pour entamer à sa façon l’épuration du pays. Elle va verser dans l’action directe, des conduites clandestines à la lisière du banditisme. Une seule voix, dans ce cercle, met le holà. Celle de Lucas Barachaud, jeune homme aux sourcils broussailleux qui a fait des études supérieures, bien qu’issu d’une famille modeste. Lucas siège au Conseil général (l’assemblée des élus du département), sur les bancs du Parti communiste. Il met en garde ses anciens camarades contre une dérive qu’il juge sotte et criminelle: « Le principal est de travailler à un monde meilleur! Bien au-delà des rancœurs personnelles et des indignations sordides, il faut voir haut et loin ! »
L’attentisme de Lucas, son esprit stratégique, exaspèrent Hélène. Elle lui jette à la figure un monceau de reproches : le parti de la lutte sociale s’embourgeoise, il est devenu «un parti de gouvernement, distribuant la prébende». Hélène préfère «la force des purs, des originaux, des écœurés, des nobles». Elle prie pour «une aristocratie des âmes fières». Elle n’admet ni l’injustice, ni la demi-mesure. Elle veut l’absolu, comme Antigone, c’est pourquoi elle ne sera jamais en paix. « Le monde appartient aux voleurs ! Voleurs de puissance et voleurs de conscience ! C’est contre tous ceux-là que nous devons continuellement lutter; contre les dominateurs ! » Elles sont nombreuses, les raisons de relire, en 2020, un roman oublié de 1947. Les discussions sur le monde d’après sont aussi les nôtres. Les dominations n’ont pas été abolies. La frontière entre guerre et paix est plus ténue que jamais quand se pose la question de la survie des civilisations humaines. La démocratie n’est pas moins grippée que celle qui apparaissait invivable à Hélène.
L’impatience des écœurés et des âmes fières ne s’est pas calmée. Cela vaudrait la peine de s’arrêter, d’y réfléchir. Ce qu’Hélène condamne chez Lucas, ce qu’elle exècre dans la politique, c’est exactement ce que ne supporte plus une frange croissante de la population européenne: la tactique, les louvoiements, le baratin, les combines… Et, pire que tout: les compromis. Une impatience légitime, quand la vie vous fouette au quotidien. Mais les responsables politiques sont aujourd’hui pris en étau entre deux injonctions contradictoires. D’un côté, on leur ordonne d’en finir avec les conflits et les «petits jeux politiciens», on les presse d’œuvrer ensemble pour le bien commun. De l’autre, on leur reproche les arrangements en demi-teinte, on demande des décisions plus radicales. On veut tout, comme Hélène, mais à condition que ce «tout» ressemble à ce qu’on désire soi-même, en ignorant qu’une société n’est pas composée que de soi-même.
On ne dévoilera pas la fin du roman. Seulement la méditation qu’un Lucas bien amer laisse échapper dans les dernières pages. « La démocratie est au niveau le plus bas, sans doute; mais elle offre humainement plus de sécurité qu’un régime plus noble et plus tendu. »
Nous avons les mains rouges (Éditions Joëlle Losfeld) vient de recevoir le Prix Mémorable qui salue la réédition d’un auteur malheureusement oublié, d’un auteur étranger décédé encore jamais traduit en français, ou d’un inédit ou d’une traduction révisée, complète d’un auteur.[:]