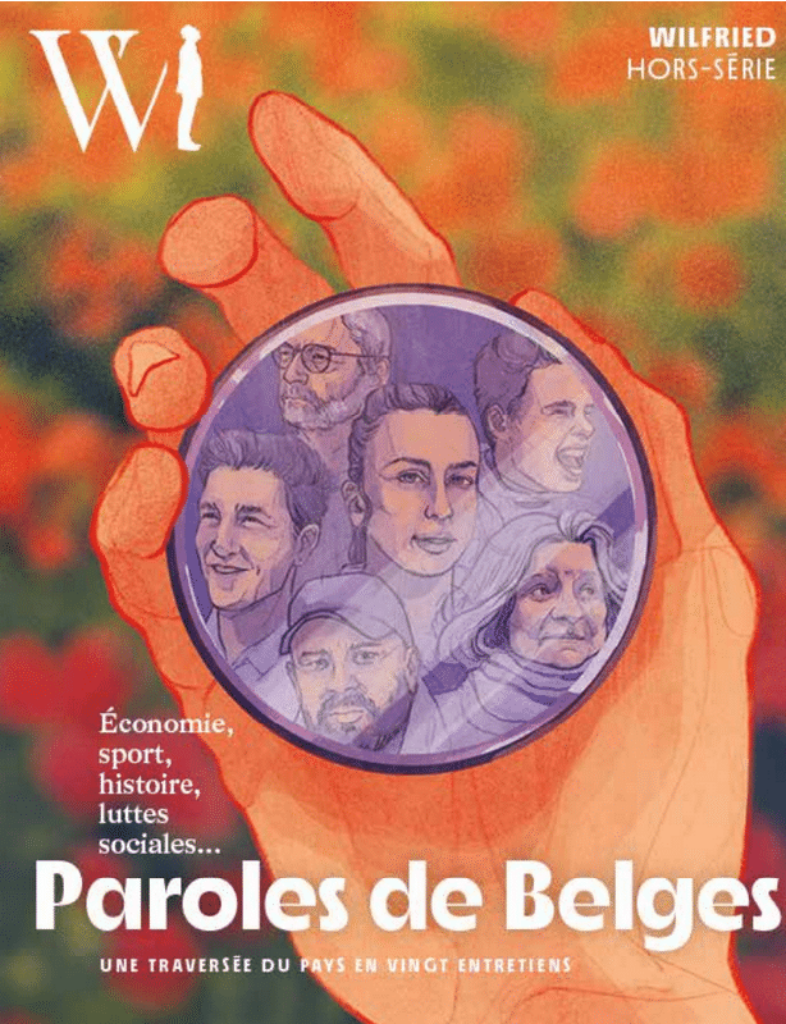Il se passe peut-être le début d’un truc. Après un demi-siècle de fermetures, le train local wallon semble doucement retrouver de l’élan. La SNCB ressuscite l’une ou l’autre petite ligne, raffermit par à-coups son offre dans les campagnes. Avec le monstrueux défi de la transition écologique et le nombre croissant de voyageurs ferroviaires, le vent de l’histoire lui souffle dans le dos. Mais la Wallonie, territoire éclaté par excellence, pourra-t-elle vraiment réussir un « modal shift», un transfert de la route vers le rail, dans la limite de ses moyens ? Entre laisser-aller français et destinée germanique, enquête sur les routes fantômes du chemin de fer wallon.
[:fr]
Le train roule en Belgique depuis cinq ans à peine lorsque paraît, dans les librairies du royaume, un Manuel du voyageur sur le chemin de fer belge. Un Routard avant l’heure pour l’étranger qui viendrait visiter le pays par le rail uniquement; qui voudrait expérimenter, les yeux écarquillés, ce réseau ferroviaire qui n’a alors aucun égal sur le continent européen.
Le livre est signé par un ingénieur parisien, le dénommé « A. Ferrier », qui décrit de la façon suivante les habitants du jeune État : « Les Belges sont en général simples, économes, patients et laborieux. On ne doit attribuer qu’à leur activité et à leur persévérance l’état florissant du pays et l’abondance de ses richesses. Ils ont su, par un travail assidu, vaincre la résistance de la nature; et il n’est pas de sol si ingrat et si stérile dont ils ne viennent à bout de tirer parti. […] L’amour de la patrie est héréditaire chez eux; les autres peuples leur reprochent même de le pousser trop loin et les accusent d’égoïsme national. »
En 1840, quand sort ce manuel flatteur, la Belgique compte déjà 225 km de voies ferrées et deux millions de voyageurs par an répartis sur trois lignes : Bruxelles-Anvers, Malines-Ostende et Malines-Liège. L’auteur s’est servi de ce découpage pour chapitrer son guide, en nommant « route » chacune des trois lignes. Ainsi, le premier chapitre s’intitule « Route no 1 : de Bruxelles à Anvers ». On lit juste en dessous: 43,8 km, 1 h 15 de parcours. Un itinéraire qui fait d’abord escale à Malines, épicentre ferroviaire des premières années de la Belgique. On s’acquitte alors de 50 centimes pour voyager en wagon découvert, 1 franc en char à banc, 1,5 franc en diligence et 2,5 francs en berline.
Bruxelles – Malines, la première ligne européenne
« Le public accorde à ce mode de transport une confiance inespérée », s’exclame le Manuel. Le 5 mai 1835, le roi Léopold Ier inaugure, à l’occasion d’une fête splendide, la première ligne de chemin de fer du continent, qui relie Bruxelles à Malines. La Belgique devient de facto le pays de la locomotive. Son réseau connaîtra un âge d’or entre 1880 et 1950, avant de rétrécir et flétrir inexorablement.
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les petites lignes, les unes après les autres, ont été fermées, abandonnées, souvent déferrées; les gares, comme des organes privés d’air, se sont lentement décomposées, quand elles n’ont pas été rasées par des promoteurs pressés d’en finir avec le vieux temps. La taille du réseau voyageurs est passée de 5 000 km en 1948 à 3 100 km de voies électrifiées ou à traction thermique aujourd’hui.
À quelques chantiers près, l’offre n’a plus vraiment changé depuis le plan IC/IR de 1984, qui a mis la priorité sur les métropoles et les grandes lignes au détriment des trains L et des gares locales. Le chemin de fer belge a sectionné les petites branches qui lui coûtaient trop d’argent, pour n’avoir plus qu’à entretenir les gros troncs. Obligeant ainsi une part de la population, rurale, provinciale ou transfrontalière, à recourir à la voiture pour les plus riches, au bus pour les autres.
Depuis quelques années, le réseau des trains L (pour « local ») semble toutefois sortir lentement de son hibernation. On dirait un éléphant bicentenaire qui s’ébroue, pataud, devant un danger — ici le réchauffement climatique, la destruction des écosystèmes, l’impossibilité d’un étalement urbain continu, l’épuisement annoncé des énergies fossiles, bref ces thèmes qui, depuis quelques mois, campent dans les médias belges.
Le chemin de fer en pleine mutation
Sans que l’on puisse prédire quel canal ce paquebot, si souvent conspué par le contribuable, va emprunter dans les prochaines années. « Ça pourrait bientôt basculer », assure Bernard Swartenbroekx, un observateur très attentif de la SNCB (l’exploitant public du chemin de fer, en situation de monopole national depuis près d’un siècle) et d’Infrabel (le gestionnaire de l’infrastructure). Soyons schématiques : deux possibilités s’offrent au chemin de fer belge. Il pourrait rattraper au galop le contingent germanique (Pays-Bas, Suisse, Autriche, Allemagne) qui a vigoureusement revitalisé ses petites lignes en moins de vingt ans.
« Dans ce cas de figure, il se passe quelque chose in extremis — les jeunes dans les rues, les patrons qui parlent enfin de climat —, ça permet de cristalliser une ambition et on culbute du côté germanique, poursuit Bernard Swartenbroekx. On entrerait alors dans un cercle vertueux : on réduit les coûts et on injecte les économies pour étoffer l’offre, qui elle-même dégage de nouveaux revenus pour encore étoffer l’offre. »
Le rail belge pourrait, plus probablement, poursuivre le chemin qui est le sien depuis trente ans, dans un modèle « à la française », en référence à l’état agonisant du train local chez notre voisin. « On laisse alors les comptables au pouvoir, on évite tous les sujets tabous et on continue de couper les bouts. Or, avec le réseau actuel, moins la population est desservie par le train, moins la légitimité d’y investir de l’argent public est grande. Faire un système de transports qui fonctionne bien, ça coûte cher, mais pas beaucoup plus cher qu’un système qui fonctionne mal. »
Au ministère fédéral belge, on s’empresse d’écraser du poing les idées reçues : non, contrairement à ce que raconte parfois la presse, l’État ne démantèle plus aucune petite ligne. Mieux, il en réanime certaines.
François Bellot et son Plan de transport
À pas très mesurés. « Depuis 2003 déjà, la SNCB ne peut plus vendre son assiette, autrement dit le tracé de ses lignes, recadre François Bellot, ministre fédéral de la Mobilité. Cette décision a donc été prise bien avant les défis climatiques et je ne sais tout quoi. » Le libéral insiste : avec un même sens de l’anticipation, il n’a pas attendu les marches des jeunes tous les jeudis pour renforcer l’offre sur les petites lignes. Sollicité en 2016 pour remplacer Jacqueline Galant au pied levé, il a validé, en décembre de l’année suivante, le Plan de transport 2017-2020, qui promettait une augmentation de l’offre ferroviaire de 5,1 %.
François Bellot se lance alors dans l’énumération de ses plus récents faits d’armes : restauration de la boucle du Sud-Luxembourg, diversification de l’offre sur l’axe Charleroi-Couvin, raccordement à venir entre Mons et Valenciennes via Quiévrain, etc. « Le rail est en redéploiement complet. » Redéploiement qui s’inscrit dans un contexte commercial favorable : la SNCB a enregistré 243,9 millions de voyageurs en 2018 — un record — soit 3,7 % de plus qu’en 2017, année qui avait déjà progressé de 3,1 % par rapport à 2016.
« Les zones rurales ont beaucoup d’importance pour la SNCB, confirme Vincent Bayer, porte-parole de la société. Nous venons par exemple d’augmenter l’offre sur les gares d’Yves-Gomezée et Ham-sur- Heure, tandis que nous avons créé de nouveaux arrêts à Seraing, Ougrée et Chaudfontaine. » Ce que les gouvernements d’autrefois ont détroussé, le gouvernement actuel le retrousse.
« J’ai bon espoir que le temps des fermetures de lignes soit révolu »
Quelque chose a changé, à n’en pas douter. L’ossature ferroviaire semble désormais bénéficier de la protection politique, telle une espèce en voie de disparition. « J’ai bon espoir que le temps des fermetures de lignes soit révolu, avance Juliette Walckiers, chargée de mission Mobilité pour Inter-Environnement Wallonie (IEW). Je ne connais pas beaucoup de dirigeants qui oseraient porter une telle décision publiquement. Par contre, le risque, c’est d’assister à un désengagement sur certains tronçons locaux, avec une dégradation progressive de l’infrastructure. Ce qui serait plus vicieux. J’ai souvent tendance à défendre la SNCB, mais je sens qu’en son sein, on porte peu d’attention sur la desserte fine. Je ne perçois pas encore une prise de conscience de la nécessité de relancer les trains L. On se demande plutôt si le rail est encore approprié à la campagne. Je sais qu’à la SNCB, ils ont une liste de lignes ferroviaires qu’ils ne s’interdiraient pas de remplacer par des bus. »
D’autant que le diable, en plus d’être dans les détails, ne se cache jamais loin. Priée par l’État de dégager des économies de bouts de chandelle, la SNCB, pas plus tard qu’en 2012, a diminué ses amplitudes horaires et supprimé près de deux cents trains dont le remplissage était inférieur à quarante passagers.
« Infrabel est à ma connaissance la seule entreprise dont l’ambition est de diminuer son périmètre d’activité plutôt que de l’augmenter. » – Une source anonyme
Des amputations que la SNCB nommait « adaptations » et qui devaient, selon la société, « offrir un meilleur service sur le réseau ». « Pire : aux yeux des gestionnaires d’Infrabel, on peut fermer la moitié du réseau, ils s’en porteront très bien, certifie une source de première main. C’est à ma connaissance la seule entreprise dont l’ambition est de diminuer son périmètre d’activité plutôt que de l’augmenter. »
Tandis que, nous confie un employé d’Infrabel, « même si elle ne le dira jamais comme ça, la SNCB n’en a plus rien à foutre de sa desserte rurale ». Si l’armature locale est souffreteuse, c’est aussi parce que ses gestionnaires lui ont attribué une fonction minimaliste, qui vise surtout les publics dits « captifs » — le scolaire et les étudiants. « Alors que nous, poursuit Juliette Walckiers, nous voulons qu’un train L soit une porte d’entrée vers un réseau plus vaste. C’est la seule façon d’offrir une solide opposition au transport routier. »
« En Wallonie, nous avons davantage investi dans l’offre rurale que sur les grandes lignes, ce qui contrarie parfois les gestionnaires des métropoles. » – François Bellot, ministre fédéral MR de la Mobilité
Le but du jeu consiste donc à opérer un modal shift, autrement dit un transfert de flux de la route vers le rail. Ce qui revient à dire que le train va devoir concurrencer un mode de déplacement qui nous facilite la vie depuis cent ans : la voiture. Bonne chance.
« La voiture sera d’autant plus difficile à remplacer que l’exigence de mobilité, de nos jours, est phénoménale, avance Yves Hanin, chercheur en urbanisme à l’UCLouvain. Nombreux sont ceux qui travaillent dans trois ou quatre lieux différents par semaine, quand par le passé on était cloué au même siège, du lundi au vendredi. La voiture est peut-être pleine de défauts, elle n’en reste pas moins la reine incontestée de la mobilité. C’est une pièce de ma maison qui circule — je téléphone, je me maquille, je prends mon café dans mon habitacle. Quand la voiture automatique inondera le marché, je pourrai même travailler à l’intérieur. Quand, à son tour, la voiture électrique se démocratisera, le bruit et la pollution en particules fines seront réduits à néant. Ce sera incroyable. »
Selon le chercheur, ce qui déséquilibre encore un peu plus le bras de fer entre la route et le rail, c’est la qualité du service proposé par la SNCB. « Le train, ce n’est plus l’endroit où l’on tape la carte, faut arrêter de rêver. C’est plutôt une affaire de ruptures de charge, ce qui est hyper pénalisant. » Une affaire de rupture de charge. L’expression n’est déjà pas très engageante. Dans le jargon, elle désigne l’obligation de changer de véhicule (train ou bus) pour poursuivre son itinéraire. Yves Hanin a passé vingt ans à subir des ruptures de charge entre Liège, où il habitait, et Louvain-la-Neuve, où il travaille. Il en a eu assez. Contre ses convictions, il se déplace à présent en voiture.
Sur trois champs de bataille, l’un transfrontalier, l’autre rural, le dernier périurbain, le train L tente déjà de racheter des parts de mobilité à la voiture. Tous sont situés en Wallonie, seule région de Belgique où les paysages ont encore par moments des allures de campagne profonde, ce qui rend d’autant plus ardu le financement d’une puissante desserte en transports publics. Territoire où, plus qu’ailleurs, des petits groupes soutiennent avec ardeur la réouverture de certaines lignes. Voici, en quelque sorte, la mise à jour du Manuel du voyageur, sur des routes fantômes désormais; il emmènera le lecteur dans la vallée de la Haute- Meuse, les reliefs ardennais et le plateau brabançon.
ROUTE NO 1 : DINANT-GIVET
Longueur : 22 km ; fermeture : 1988.
« Les trains roulant toujours sous les astres, la nuit, Emportent, dirait-on, des morceaux du pays.
Plombs, fer, étains, salpêtre, aciers, boulets, mitraille. »Émile Verhaeren, poète belge
Ce sont trois trajectoires aux courbes synchronisées, comme
les traînées aériennes d’un défilé du 21 juillet. La Meuse décide de l’orientation, la route et le chemin de fer suivent son dodelinement comme deux chiens fidèles. Le bitume vit, le rail est mort. Parfois la double voie disparaît sous la verdure, momifiée par le lierre, ou alors elle se réfugie sous un tunnel taillé dans la roche; çà et là elle s’éloigne, comme si le temps ne suffisait pas pour se faire oublier, comme s’il fallait fuir cette nationale 936 qui a signé sa fin ; plus tard elle passe par la gare d’Hastière, vide et parfaite comme un décor de cinéma prêt à l’emploi ; et ça dure pendant onze kilomètres à compter de Dinant. Une balade lugubre et archaïque qui donne quand même un peu le cafard. Au douzième kilomètre, on atteint l’un des anciens postes d’aiguillage de la ligne 154 Namur-Dinant-Givet, le seul du tronçon qui soit encore debout. Quelqu’un a pelleté du terreau de jardinage entre les rails, d’où germent les premières plantes potagères de la saison.
Un homme vit ici. Il s’appelle Andreï. Il est Roumain. Quinze ans plus tôt, il a racheté ce cube de briques, morceau de patrimoine ferroviaire, pour soixante mille euros. Il aurait volontiers utilisé le train pour rejoindre Bruxelles, du temps où il assurait le gardiennage d’un monastère à Boitsfort. Désormais il ne veille plus que sur ses pousses et son chien, un monumental berger du Caucase plus proche du poney que du canidé.
Le train, Andreï n’en aurait plus besoin, aujourd’hui. Surtout pas. Quand nous lui apprenons que les autorités belges et françaises envisagent de rouvrir le maillon transfrontalier entre Dinant et Givet, le long duquel se situe son petit domaine, il exécute un mouvement bizarre avec ses bras. Il ignorait. Ça gâcherait sa retraite, un truc pareil.
Un réseau tentaculaire en pleine expansion
En juillet 1862, la Compagnie française des chemins de fer du Nord (dont sa filiale belge) inaugure le prolongement, entre Dinant et Givet, de la ligne Namur-Dinant. La Belgique poursuit le maillage effréné de son territoire, sans commune mesure dans le monde. Cette expansion ferroviaire est dopée par la concurrence entre plusieurs sociétés privées, comme la Compagnie de Chimay ou le Chemin de fer de l’Entre-Sambre- et-Meuse. Elle répond aussi à des impératifs industriels et commerciaux.

En 1837 déjà, Léopold Ier déclarait, lors de la cérémonie d’ouverture du tronçon ferroviaire entre Termonde et Gand : « Dès mon avènement, j’ai eu l’impression que la Belgique ne pouvait pas exister sans l’établissement d’une communication facile et prompte entre la mer et le Rhin. […] On ne doute plus de la possibilité du succès; de grands travaux sont projetés ou commencés à l’étranger, et la Belgique doit devenir l’artère principale par laquelle s’effectuera le mouvement du commerce sur le continent. »
Avant d’être un transport de passagers, le train est un transport de fret. Il faut, très vite, acheminer les marchandises depuis les bassins industriels vers les grandes villes belges et étrangères. Les libéraux voient dans le chemin de fer un moyen de stimuler l’activité économique du pays, basée sur l’industrie lourde. Une
fois au pouvoir, les catholiques poursuivront l’œuvre, notamment à travers un réseau de plusieurs milliers de kilomètres réservé aux tramways, dans l’intention d’éparpiller encore un peu plus les masses ouvrières — de quoi s’épargner d’éventuels soulèvements collectifs —, de brasser davantage de travailleurs dans les bassins industriels et d’offrir au plus grand nombre un pré-carré à la campagne. La Belgique, déjà, cult
ivait un mode de vie ni urbain ni rural, mais étalé. Le segment Dinant-Givet, qui en définitive connectait la Wallonie au nord de la France, devait participer de cette logique de capitalisme paternaliste. Plus tard, la voiture trouverait, dans cet habitat belge éclaté, le terreau adéquat pour se rendre irrésistible et indispensable.
Machine arrière, rail en rouille
En mai 1988, le dernier train de passagers relie Dinant à la botte
de Givet, là où la frontière française semble vouloir discrètement phagocyter la Belgique. La Meuse et les coulées de voitures continueront de ruisseler d’un pays à l’autre. Le rail restera, rouillera. Quatre ou cinq friteries s’agglutineront à Heer-Agimont, dernière bourgade avant la France, comme s’il fallait inspirer avec appétence les vapeurs d’huile de tournesol avant d’entrer en apnée, dans cet immense Hexagone qu’on juge incapable de servir de bonnes french fries. Le crépuscule ferroviaire donc, jusqu’à l’éruption de « l’ancien volcan qu’on croyait trop vieux ».
En novembre 2018, la région française du Grand-Est (dix départements, 5,6 millions d’habitants) s’est déclarée plus que jamais favorable à la réouverture du tronçon Dinant-Givet, de façon à désenclaver cette pauvre botte coiffée d’une gare-terminus. L’enjeu est touristique, économique et écologique. « La France est prête à financer la moitié du chantier, proclame Claude Wallendorf, le maire de Givet. Cela dit, on peut aussi envisager un soutien européen. » François Bellot et son alter ego français ont signé un accord de principe pour examiner la faisabilité d’un dépoussiérage de ce chaînon manquant sur l’axe Paris-Reims-Namur-Bruxelles. Car c’est ainsi qu’il faut envisager le projet : un chantier non pas local mais européen, qui reconnecterait toutes sortes de capitales — de la Wallonie, de la Belgique, de la France et de l’Europe, sans oublier le passage par Charleville-Mézières, où transite le TGV.
Charleville-Mézières. Chez Arthur Rimbaud. Le poète est-il passé par Givet pour gagner la Belgique, où l’on sait qu’il s’est rendu à plusieurs reprises par le train ? Peu probable, dans la mesure où la route pour Charleroi et Bruxelles était plus rapide via Couvin, légèrement à l’ouest. Rien ne nous empêche cependant d’imaginer qu’il a pris un jour la ligne 154. Il aurait donc traversé la vallée de la Haute-Meuse, contemplé ses éperons rocheux, observé la collégiale Notre-Dame de Dinant s’approcher, de plus en plus colossale.
Si d’aventure le tronçon transfrontalier est réhabilité sur son antique tracé, les voyageurs verront bientôt cette partie inchangée du décor, immuable comme un poème, depuis l’exact même point de vue qu’Arthur Rimbaud. Il faudra baisser le regard pour s’assurer que cent cinquante ans se sont effectivement écoulés. En contre-bas, le long de la nationale 936, à côté des hôtels de maître du début du XXe siècle qui tombent en ruine, des immeubles à appartement en crépi clair sont occupés à champignonner dans une frénésie architecturale débridée. On a vu les mêmes à Bruxelles, Liège ou Paris. Le promoteur nous promet « le lieu de villégiature de vos rêves ».
ROUTE NO 2 : LIBRAMONT-BASTOGNE
Longueur : 29 km ; fermeture (« à titre provisoire ») : 1993.
« Le train glisse sans un murmure, Chaque wagon est un salon
Où l’on cause bas et d’où l’on
Aime à loisir cette natureFaite à souhait pour Fénélon. »
Paul Verlaine, poète français
Le chemin de fer belge n’est nulle part aussi chétif qu’en province de Luxembourg, la plus méridionale et la moins peuplée du pays. Sur la carte ferroviaire fournie par la SNCB, Bastogne est au milieu du désert. Le train ne la connecte plus ni à Liège via Gouvy, ni au grand-duché du Luxembourg via Wiltz, ni à la ligne 162 Bruxelles-Arlon via Libramont. Ces trois radiales ont été sciées l’une après l’autre. La connexion avec la Cité ardente laisse un héritage cycliste légendaire : Liège-Bastogne- Liège, la Doyenne des classiques. Les organisateurs de la première édition, en 1892, avaient choisi Bastogne pour que les commissaires de course puissent s’y rendre en train, où ils contrôlaient le passage des cyclistes avant que ceux-ci ne fassent le chemin en sens inverse (la course s’appelait d’ailleurs, à l’origine, Liège-Bastogne-retour).
La connexion avec le Luxembourg, elle, ne laisse rien d’autre que des souvenirs, quelques paragraphes dans les livres d’histoire. On se rappelle avec nostalgie que ce trait de train pittoresque d’une quinzaine de kilomètres longeait le ruisseau du Wiltz. Les habitants de Bastogne l’empruntaient pour s’abreuver non pas à l’eau de source mais en litrons de péket, moins cher à la campagne. Enfin, la connexion avec Libramont a été substituée par une desserte de bus, que la SNCB, sur sa carte, ferait presque passer pour du train en la légendant habilement « ligne non électrifiée ». Une ligne au demeurant bien cotée : s’il ne passe qu’une fois par heure en moyenne, le bus relie les deux villes presque aussi vite qu’en voiture.
Les Amis du rail d’Halanzy militent, depuis 2009, pour la réouverture des trois tronçons. En deux phases : d’abord Libramont-Bastogne et Bastogne-Wiltz, ensuite Bastogne-Liège. Galvanisés par la remise en marche de la section Virton-Athus-Arlon après vingt-trois ans de bataille, les Amis du rail veulent à nouveau triompher, cette fois dans la zone de combat autour de Bastogne. Ce sont onze hommes en colère, des cheminots, des navetteurs, des employés d’Infrabel en poste ou à la retraite qui luttent corps et âme pour un « rail pour tous ».
Des rêveurs pris au sérieux
« Ça peut aller très vite comme ça peut prendre encore des années, commente-t-on du côté de l’association. Nous avons de plus en plus de partenaires : la ville de Bastogne, le Grand-Duché… L’opinion change doucement. On nous a longtemps pris pour des rêveurs. Maintenant, avec les marches pour le climat, on nous reçoit autrement. Les jeunes à Bruxelles sont nos alliés. »
Les Amis ont une artillerie d’arguments à faire valoir : les villages qui se densifient le long de l’ancienne ligne, Bastogne qui se développe et attire toujours plus de touristes, les marchandises qui pourraient être transportées jusqu’aux trois zonings en pleine expansion autour de Bastogne… Pour Libramont-Bastogne, l’association a évalué le budget à cinquante millions d’euros, soit un million par kilomètre de voie et quinze millions pour la totalité de l’électrification. François Bellot, qui n’est pas favorable à ce projet, estime que le coût moyen au kilomètre avoisine plutôt dix millions d’euros. Entre les militants et le ministère, on passe du simple au décuple.
« À la SNCB, on se demande si le rail est encore approprié à la campagne. Je sais qu’ils ont une liste de lignes ferroviaires qu’ils ne s’interdiraient pas de remplacer par des bus. » – Juliette Walckiers (Inter-Environnement Wallonie)
François Bellot se considère comme rural. Il est originaire de Jemelle, où font escale les rames tractées à deux étages de l’autoroute ferroviaire Bruxelles-Arlon. Enfant, il accompagnait son père, négociant en produits agricoles, dans les dépôts des gares où le paternel réceptionnait les colis transportés par le train. Ce sont des souvenirs qui ne périssent pas. Quand il est arrivé au poste de ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot, bourgmestre dès lors empêché de Rochefort, a immédiatement porté son attention sur les petites lignes.
«J’ai lancé ce pari : on va doubler l’offre sur certains axes ruraux. En ville, on souffre de saturation; à la campagne, on souffre d’un manque d’offre. Les problèmes de mobilité ne sont pas uniquement urbains. Après, nous devrons mesurer le succès commercial de cette décision, parce que je ne veux pas d’un trop grand décalage entre le taux de remplissage des trains sur ces lignes-là et sur l’ensemble du réseau national. »
Restauration de la boucle Sud-Luxembourg !
Le pari de François Bellot a commencé par la restauration de la boucle du Sud-Luxembourg. Une ligne qui coûte deux millions d’euros par an. « En Wallonie, nous avons davantage investi dans l’offre rurale que sur les grandes lignes, ce qui contrarie parfois les gestionnaires des métropoles. » Pour autant, réhabiliter Libramont-Bastogne n’est pas à l’ordre du jour, encore moins Bastogne-Wiltz ou Bastogne-Liège via Gouvy. « En tout cas, plus dans le modèle ferré. Le potentiel n’est pas là. Je rappelle que les recettes voyageurs de la SNCB ne couvrent que 20 % des dépenses, alors bon. »
Un constat qui ne serait pas qu’économique : d’après un document interne du ministère, un train électrique de volume moyen qui transporte moins de vingt passagers est plus polluant qu’une voiture qui n’en transporte qu’un, tandis que le bus sera toujours le plus écologique. Ingénieur industriel de formation, François Bellot plaide plutôt pour une idée assez originale : la mise en service de véhicules autonomes semi-électriques ou semi-thermiques sur les voies de Ravel.
« On ne va pas mettre des trains qui coûtent 3 millions pièce entre des petits pôles d’habitants. Par contre, des véhicules légers qui suivraient, grâce à un câble de transmission, un tracé simple et rectiligne comme le Ravel entre Bastogne et Libramont, ça pourrait faire l’affaire : la capacité serait plus adaptée à la demande et les coûts réduits. Je prône le lancement rapide d’essais. »
Dans le même ordre d’idée, Yves Hanin se dit favorable à l’instauration de « Rapido Bus » depuis Bastogne vers Namur et le Grand-Duché. Ces bus fileraient sur une bande d’autoroute qui leur serait réservée, comme ça existe déjà entre Louvain-la-Neuve et Bruxelles, notamment. « Je ne suis pas sûr qu’on soit Germains, avance le chercheur de l’UCLouvain. La Wallonie, excepté le Brabant wallon, est au niveau du Portugal. On est une région pauvre, faut pas délirer. Dès qu’une entreprise s’installe, on lui déroule le tapis rouge !
Or, le train, c’est du luxe. Je suis pour un report modal vigoureux, mais adapté à nos moyens. Il faut chercher un effet démultiplicateur à partir des flux, du réseau et des budgets disponibles. Mais en Wallonie, on aime les projets mégalomanes, comme Liège-Guillemins, la gare des bus à Namur, le TGV à Charleroi… Ce sont des logiques d’ingénieurs qui œuvrent à la SNCB. On claque un fric monstre pour ça. »
Une voie unique et un Ravel, pas impossible ?
Parfois décrit comme « l’homme le plus intelligent de Liège », conseiller communal pour la coopérative politique Vega (Verts et à gauche) et instigateur, avec Bernard Swartenbroekx, d’un projet de réouverture de tronçons ferroviaires (voir « Route no 3 »), François Schreuer songe aussi à des infrastructures et du matériel roulant plus légers pour certaines petites lignes, mais toujours sur rail — auquel il faut rendre, selon ses vœux, une centralité spatiale et sociale. Il imagine par exemple une exploitation automatique à voie unique, ce qui serait nettement moins cher et autoriserait la cohabitation avec le Ravel. En certains endroits, des évitements permettraient aux trains de se croiser. «Techniquement, l’usage des deux voies ne se justifie qu’en cas de trafic très important », recadre-t-il.
« En Belgique, on prétend qu’il faut quatre voies continues pour faire rouler seize trains par heure, rappelle Bernard Swartenbroekx en faisant référence au RER. C’est absurde. Les Japonais font rouler jusqu’à cinquante trains sur deux voies grâce aux évitements en gare à intervalles réguliers. »
« Bastogne, c’est une gare qu’on ne fermerait sans doute plus aujourd’hui, estime le même Bernard Swartenbroekx, bien qu’elle ne soit pas orientée dans le sens des flux actuels, qui vont plutôt vers Marche ou Arlon. » Soit des tangentes qui n’ont jamais été assurées par le chemin de fer et qui le sont très bien par le réseau routier, par ailleurs rarement obstrué. « Est-ce que le train apporterait quelque chose ? » D’une façon générale, un certain nombre d’anciennes lignes ne correspondent plus aux zones d’activités actuelles. Elles sont l’héritage d’un aménagement du territoire lié, notamment, à l’essor des bassins sidérurgiques et d’une industrie en partie révolue.
« J’aime beaucoup la province de Luxembourg, mais objectivement, ce n’est pas là qu’il faut se précipiter pour rouvrir des lignes, concède François Schreuer. Je songe plutôt aux régions qui combinent deux facteurs : une certaine densité de l’habitat et une congestion du trafic automobile. Par exemple, autour de Liège et Charleroi, dans l’immense hinterland bruxellois, dans les périphéries de Lille et Luxembourg… » Avec, en amont, un objectif clair en matière de « part modale », soit de pourcentage de déplacements en train parmi tous les types de déplacements. Le gouvernement wallon aimerait ainsi passer de 9 % aujourd’hui à 15 % en 2030.
« Mais il ne se donne pas les moyens d’y arriver et ce n’est pas un objectif de la SNCB, donc c’est un peu abstrait, poursuit François Schreuer. On lance des chiffres et puis plus rien. C’est dramatique, car ça dévalorise complètement la parole politique. » Idéalement, une fois l’objectif fixé, les autorités devraient ensuite réfléchir à l’exploitation d’un réseau, pas seulement aux infrastructures. « Le grand problème, chez nous, c’est qu’on rouvre des gares sans penser à la ligne et aux trains qui passent par ces gares. » Après quoi seulement, les autorités pourraient se lancer dans de grands travaux qui obéiraient à une stratégie globale. « Et donc cesser d’ouvrir des lignes en fonction d’un lobby local ou d’un bourgmestre influent. »
On donnait à la ligne 163 le surnom de « ligne des Crêtes », en ce qu’elle suivait en partie la limite de séparation des eaux entre les bassins de la Meuse et du Rhin. Il n’en reste que quelques signaux, le ballast d’origine et l’un ou l’autre passage à niveau. La fermeture, au départ dite « provisoire », est toujours mentionnée comme telle dans les documents administratifs officiels. Les Amis du rail d’Halanzy pourraient lire ce statut avec une ironie amère ; ils préfèrent l’appréhender comme un signe du destin. Un jour la ligne rouvrira.
ROUTE NO 3 : WAREMME-SOIGNIES
Longueur : 94,5 km ; fermeture : années 1950 (tronçon Court-Saint-Étienne-Nivelles).
« Imaginez quel serait notre enthousiasme si le train avait été inventé après l’auto… Chacun s’extasierait : quel progrès ! Pouvoir transporter mille personnes au lieu de quatre ! »
Jacques de Launay, historien
La douceur malsaine du mois de février s’est retirée pour laisser la place à un temps banal, sombre et frais. On a goûté, avec culpabilité, dans une sorte de flash-forward illégitime, à la fougue du printemps; le retour à la normale rassure autant qu’il déprime. Trois jours plus tôt, peut-être que la gare d’Arquennes nous aurait semblé sympathique, sous un ciel azur. Ici elle se dresse sinistrement, délabrée le plus souvent, ceinturée d’un côté par une végétation nue et clandestine, de l’autre par un parking où seul le vent aime se promener.
Dans une voiture à l’arrêt, deux garçons fument un joint. On aperçoit, par les fenêtres encrassées de la gare, des montagnes de chaises, des affaires en tout genre qui pourrissent calmement. La poste a installé ses quartiers dans la plus petite aile de l’édifice, restaurée à cet effet. Cellule vivante dans une coquille morte et inamovible, isolée du réseau de chemin de fer encore en activité. Dans un rayon de dix kilomètres autour d’Arquennes, un village situé entre Nivelles et Écaussinnes, il ne reste rien du passé ferroviaire de la région. Plus de gare, plus de rails, plus de train.
Deux hommes rêvent, depuis une quinzaine d’années, d’élancer une «Transbrabançonne ferroviaire ». Le projet de François Schreuer et Bernard Swartenbroekx est très ambitieux : il s’agirait de relier Waremme à Soignies, en passant par Hannut, Jodoigne, Wavre, Ottignies, Court-Saint-Étienne, Genappe et Nivelles. De traverser, d’est en ouest, la province du Brabant wallon.
Une ligne inédite entre Waremme et Wavre
Translation en train qui nécessiterait de construire une ligne inédite entre Waremme et Wavre à l’est; et une autre entre Nivelles et Braine-le-Comte ou Soignies à l’ouest, pour laquelle il faudrait, à cause de son orientation défavorable, fendre les vallées plutôt que les longer, traverser le bois de la Houssière et déranger les riverains qui se sont installés trop près de l’assiette. Entre les deux, il s’agirait de referrer le tronçon Court-Saint-Étienne- Nivelles de l’ancienne ligne 141, qui jadis piquait ensuite vers le sud en passant par Arquennes. Le tracé est toujours disponible : c’est une piste de Ravel.
Comme ses consœurs de l’époque, la ligne 141, désaffectée à partir des années 1950, était victime de la croissance phénoménale de la voiture durant les Trente Glorieuses, alors que la Belgique proposait encore le réseau ferroviaire le plus dense au monde.
« Le train, ce n’est plus l’endroit où l’on tape la carte, faut arrêter de rêver. C’est plutôt une affaire de rupture de charge, ce qui est hyper pénalisant. »
Yves Hanin (UCLouvain)
Dans le Brabant wallon, le train n’était plus bon qu’à déverser son flot de voyageurs dans la capitale, suivant l’artère, de plus en plus sanctuarisée, entre Gembloux et Bruxelles. Vingt ans plus tard, la nationale 25/27 viendra épouser, à quelques chicanes près, l’ancien tracé de la 141. « Aujourd’hui, cette fermeture, on s’en mord les doigts», assure Bernard Swartenbroekx.
Notamment pour une raison très simple : avec le développement de pôles économiques comme Louvain-la-Neuve, Bruxelles n’est plus le seul aimant à navetteurs de la province. Dilution des flux du nord au sud et de l’est à l’ouest; rééquilibrage de la rose des vents. « Le potentiel du réseau existant est fabuleux, soutient François Schreuer. La première chose à faire, c’est de l’exploiter correctement. Voilà l’objectif de la Transbrabançonne : en lui ajoutant quelques pièces manquantes, on revalorise l’ensemble du réseau. Et on attire les bassins de main-d’œuvre de Liège et Mons vers les bassins d’emplois situés dans le Brabant wallon. C’est la seule ligne d’envergure dont je défends la réouverture immédiate ».
La proposition, jusqu’à présent, est restée lettre morte. Peut-être parce qu’elle coûte trop cher, qu’elle fait trop peur, qu’elle est anachronique ? François Schreuer n’en sait trop rien. « N’hésitez pas à poser la question aux stratèges des grands partis, je serais curieux de connaître leur réponse. »
D’après les calculs de Bernard et François, la Transbrabançonne coûterait à l’État plusieurs centaines de millions d’euros. « Face au défi climatique, à la pollution de l’air et à la saturation urbaine, un pays richissime comme la Belgique, qui génère 450 milliards d’euros de PIB par an, n’est même pas capable de mobiliser 250 millions pour une ligne de train ? s’interroge François Schreuer. Quand je pense qu’on laisse filer chaque année près de 20 milliards en fraude fiscale et que la voiture de société coûte à l’État 3 milliards par an pour des véhicules qui font surtout un trajet pendulaire domicile-travail… »
L’État, lui, s’est offert avec le RER bruxellois un jouet à trois milliards d’euros, il compte bien en profiter. Les navetteurs trop éloignés de cette épine dorsale encore en gestation seront invités à la rejoindre par des perpendiculaires réservées aux cyclistes, aux bus voire aux voitures partagées. Pas de train, donc. Trop cher.

« On n’a pas besoin de chantiers, renchérit le chercheur Yves Hanin. Entretenons plutôt l’offre existante, comme les voies de Ravel ou la desserte TEC. Améliorons le service en train et en bus autour de Liège. Densifions l’urbanisme autour d’une quarantaine de gares désignées. Mais rouvrir une ligne, non ! » La philosophie de la Transbrabançonne, pourtant, consiste précisément à viser les cœurs urbains, où le train doit pouvoir pénétrer. « Plutôt que de desservir des gares autoroutières à Rhines, Daussoulx ou Gosselies, ajoute François Schreuer, on veut miser sur les villes de taille moyenne pour contrer l’étalement urbain. »
Malgré les nombreuses coupes opérées dans le réseau, 50 % de la population belge habite à moins de 2 km d’une gare. Ce qui n’empêche pas la voiture d’être plus efficace que le train dans la majorité des itinéraires, les correspondances étant partielles et trop souvent déterminées en fonction de Bruxelles. C’est l’un des dommages collatéraux d’un réseau dit « en étoile », avec la capitale dans le rôle de l’astre, par opposition au système des nœuds de correspondance.
Nœuds ou étoile, nouvelle ou vieille école. Dans la première discipline, les Suisses sont les maîtres absolus. Leur modèle d’organisation revient dans toutes les discussions ; c’est le « point suisse ». Le principe est très simple : il s’agit de faire se croiser en gare A, dans un intervalle de quelques minutes, les deux trains d’une ligne Y et les deux trains d’une ligne Z.
De même en gare B, C, etc. « Avec les nœuds de correspondance, on gagne en attractivité pour tous les types de flux, pas seulement les grandes lignes, mais aussi la desserte rurale, jusqu’aux bus TEC qui pourraient relier efficacement les extrémités du réseau en fonction des horaires de train, analyse Bernard Swartenbroekx. Mais en Belgique, à ma connaissance, il n’a jusqu’à présent jamais été question d’importer le système suisse, qui a pourtant fait école en Autriche, en Allemagne et aux Pays-Bas. On se focalise toujours sur le rail, pas sur l’horaire. »
Le rêve de François Bellot, le rêve…
Un système qui revitaliserait les petites lignes à moindres frais, ce qui ne serait pas du luxe pour un réseau dont les coûts d’exploitation sont deux fois plus élevés que ceux des voisins néerlandais et allemand. Il exigerait, d’une part, un respect rigoureux de l’horaire ; de l’autre, la nomination d’un planificateur fédéral, qui assurerait la cohérence entre l’horaire préalablement fixé, l’exploitation du matériel roulant et l’infrastructure. C’est ce que la nomenclature européenne appelle une « autorité organisatrice de transports » (AOT) et qui fait cruellement défaut à la Belgique écartelée entre une SNCB nationale et un réseau de bus, tram, métro et pistes cyclables régionalisé. François Bellot rêve de ça, une AOT. Jour et nuit.
Il affirme avoir essayé, à plusieurs reprises, d’instaurer une coopération entre les différents acteurs de la mobilité en Belgique. Vainement. La Flandre et Bruxelles, dit-il, l’ont envoyé promener. « Résultat, quand on a par exemple doublé l’offre de transport ferroviaire sur des lignes rurales comme Namur-Bertrix, la TEC a diminué l’offre de bus. Les gens arrivent maintenant dans une gare sans savoir comment rejoindre leur village. »
C’est un peu faux, ce qu’on écrivait plus haut. La gare d’Arquennes n’est pas le seul élément ferroviaire du paysage dans cette sorte de trou, entre Nivelles et Braine-le-Comte, que Bernard et François aimeraient combler. Plus ou moins à équidistance des deux villes, le no man’s land est traversé par le canal Bruxelles-Charleroi. De part et d’autre, des chapelets de maisons quatre façades s’étirent à l’infini dans cet arrière-pays que notre « brique dans le ventre » a bousillé. Une industrie pétrochimique, signalée par la puanteur des gaz qu’elle rejette, prospère sur la rive ouest du canal, à hauteur d’Écaussinnes. Derrière de hautes grilles sous surveillance, des wagons acheminent diverses substances, «plombs, fer, étains, salpêtre, aciers, boulets, mitraille ».
Ces wagons quittent l’enceinte de l’entreprise, passent par le réseau ferroviaire interne de la voisine Total avant de récupérer la petite ligne 117 entre Braine-le-Comte et Luttre. Ils peuvent alors promener leur contenu partout sur le continent. C’est de là, sur ces minuscules tronçons de rails à l’abri des regards, le long d’un canal où ne passent que quelques joggeurs au visage fermé, que le train local pourrait renaître. Grâce au fret.
Un nombre croissant de pays et d’entreprises réclament ainsi, à cor et à cri, un effort financier des autorités compétentes pour redéployer le transport ferroviaire de marchandises, notamment parce que les camions, en plus d’être polluants, sont beaucoup trop nombreux sur les routes. Le rail pèse aujourd’hui 18 % du transport de marchandises sur le marché européen, contre 75 % pour les camions et 7 % pour les bateaux. François Bellot s’est donné pour objectif de porter le trafic de fret ferroviaire en Belgique à 30 % d’ici 2030, soit le double du trafic actuel. Renouant, deux siècles plus tard, avec la mission initiale du chemin de fer.
***
Jamais, dans notre histoire, l’homme n’a eu la capacité de bouger aussi vite, aussi loin et aussi facilement ; jamais, avec l’avènement de l’Internet à haut débit, il n’a eu la même capacité de s’affranchir du déplacement. Ce sont deux prouesses qui s’annulent. Les bouleversements climatiques à venir nous somment de préférer l’option la moins énergivore. Autrement dit, la nature nous dicte notre conduite, ce à quoi nous n’étions plus habitués. « L’enjeu, ce n’est pas le bougisme, plaide François Schreuer. Personne n’a envie de faire 300 km pour aller au boulot. À mon avis, la mobilité est plutôt un droit qui conditionne l’accès à plein d’autres droits — l’emploi, la culture, l’aide sociale… »
En décembre 2018, le gouvernement de Willy Borsus approuvait la prime wallonne des kots, qui vise à soutenir à hauteur de mille euros par an les étudiants qui logent dans la ville où ils suivent leur cursus, pour autant que celle-ci soit suffisamment éloignée du domicile de leurs parents. Le « budget mobilité », approuvé le 28 février dernier par la Chambre des représentants, permet notamment aux bénéficiaires d’une voiture de société de remplacer cette dernière par une intervention financière de l’État dans l’achat ou la location d’une maison plus proche de leur lieu de travail.
Cette façon d’encourager une forme de sédentarisme vient à rebours de deux mille ans de civilisation chrétienne, ou trois mille ans de civilisation biblique, millénaires au cours desquels il a fallu croître et coloniser les confins de la Terre. Non seulement nous n’avons plus besoin de nous étendre, en outre nous cherchons à nous replier territorialement. « On s’approche alors de l’un des débats les plus importants de notre temps, commente François Schreuer, qui est celui des gilets jaunes et de tous les enjeux de justice spatiale : comment défendre à la fois l’accès aux services pour tous dans des campagnes profondes auxquelles on choisit de donner de l’avenir, et une idée d’optimisation de l’espace qui vise à décourager l’étalement de l’habitat ? »
Dans cette équation complexe, rien ne certifie que le train représentera l’inconnue la plus déterminante. Le chemin de fer pourrait même se marginaliser. Les vélos électriques, les voitures partagées voire autonomes, les espaces de coworking près de chez soi sont autant de moyens de contourner le défi vertigineux du modal shift, du transfert de la route vers le rail, surtout en milieu rural. « On ne pourra pas retourner en arrière quant à l’individuation, prophétise Yves Hanin. Ça, c’est un gros problème pour le train, qui est par nature un transport de masse. »
« J’aime bien les grands trucs un peu fous, comme se mettre en tête d’aller marche sur la Lune. C’est ce qu’il faudrait pour le train. »
François Schreuer propose une autre grille de lecture. « Si on excepte l’Ardenne, la Wallonie est un territoire plat, dense et riche. Toutes les conditions sont réunies pour bâtir un formidable réseau de transports en commun. Je crois qu’il faut juste un déclic. J’aime bien les grands trucs un peu fous, comme se mettre en tête d’aller marche sur la Lune. C’est ce qu’il faudrait pour le train. »
Elio Di Rupo avait lui aussi son rêve, ou plutôt une vision, qu’il décrivait en 2011 dans un livre d’entretiens avec le journaliste Francis Van de Woestyne : une autoroute de Wallonie bordée, d’Eupen à Tournai, d’un vaste zoning industriel. En le lisant, on imaginait sur un plan horizontal des colonnes de voitures et sur un plan vertical des colonnes de fumée, avec dans les angles des kilomètres de parcs à conteneurs pour une infinité de jobs à pourvoir. Les rêves changent vite de nature.
En février, le ministre wallon de la Mobilité, le centriste Carlo Di Antonio, se confiait dans La Dernière Heure sur celui de son gouvernement : voir des pelotons de cyclistes se rendre au travail à l’heure de pointe, « et pareil le soir au retour ». Chemin de fer, cheval de fer. Jadis on dessinait le futur avec des voitures volantes, en 2019 on fantasme sur des bicyclettes et des rames tractées. Tout était là. —
Cet article a été réalisé grâce au soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles.
[:]