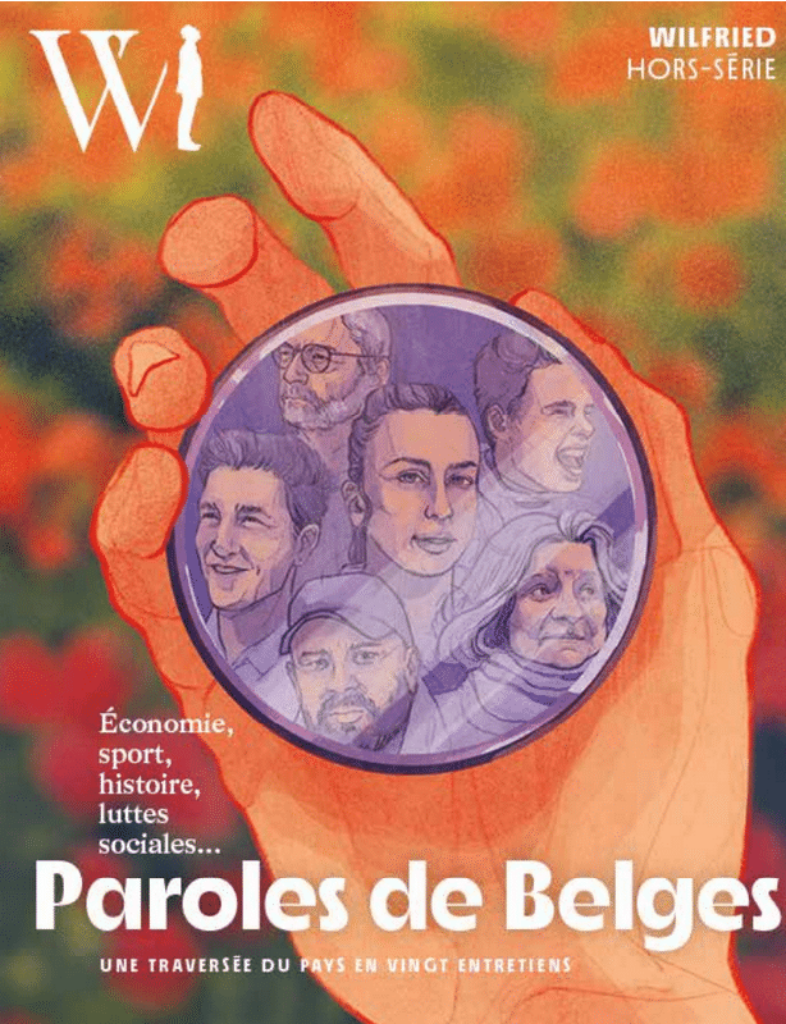Bourgmestre CDH de Fléron, ancien député fédéral, Roger Lespagnard traverse la vie politique par inadvertance, un peu, beaucoup, malgré lui. Sur sa route l’entraîneur de toujours de Nafissatou Thiam croise aussi bien le cigare de Jean-Pierre Grafé que le keffieh de Yasser Arafat.
[:fr]Elle se tord de douleur. À l’intérieur, la joie brûle et la dévore. Blessée au coude, la jeune heptathlonienne vient de lancer le javelot par-delà les cinquante mètres. Le stade olympique de Rio de Janeiro, au Brésil, applaudit des deux mains son nouveau record personnel. Nafissatou Thiam met une option sur le graal. Deux épreuves plus tard, à quelques encablures de son vingt-deuxième anniversaire, la Namuroise pare son cou du métal doré. Derrière ce succès: Roger Lespagnard. L’ado qu’il avait repérée à Seraing, au beau milieu de son quatorzième hiver, enchaîne tous les titres possibles. Championne olympique, d’Europe en salle, du monde et athlète de l’année 2017. Une première dans le royaume. Mais Roger, lui, reste tapi dans l’ombre. « Quand Nafi reçoit des félicitations, elle rougit. Roger est un peu pareil, il n’aime pas qu’on le mette en avant », atteste Elsa Loureiro, 26 ans, ingénieure industrielle et triple sauteuse, quatorze ans sous ses ordres.
Entre un stage à Tenerife et une compétition en bordure parisienne, il veille, de sa fenêtre, sur sa ville, sa campagne où tombe la neige. Fléron, en province de Liège, a le teint pâle. Lui, se dit « encore en pleine forme » et cite le nombre exact d’habitants – 16 491 – qu’il gouverne en tant que bourgmestre. « Il y a eu beaucoup de morts cette année-ci, malheureusement. On a une population assez âgée. » À 71 balais, l’ancien décathlonien jongle entre deux disciplines, le sport et la politique. Debout à six, sur la piste à dix-sept. Son « moment détente ». « Il sépare vraiment les deux mondes, poursuit Elsa Loureiro. Quand on le voit, c’est Roger le coach, en training. À l’entraînement, il oublie sa vie de bourgmestre. » Comme un amant s’offre sans sourciller à son amour véritable. « À la base, mon métier, c’est prof de gym, puis entraîneur. Je ne suis pas très bien payé pour ce que je fais. Si j’étais au foot ou au tennis ce que je suis à l’athlétisme, je ne serais même plus ici. En deux ans, je rachèterais Fléron. » Avant cela, Roger Lespagnard se retrouve un peu par hasard, cartes en main, dans le jeu politique. « Moi, j’étais juste un sportif. Sauf que j’enseignais dans la même école qu’Anne-Marie Hansenne, la sœur de Michel. Elle m’a dit que son frère devenait ministre et qu’il cherchait un conseiller pour le sport », rembobine celui qui remporte un premier concours de circonstances.
Le prof de gym et de biologie se mue en cabinettard, de 1978 à 1980. Deux à trois fois par semaine, il rallie la capitale pour soumettre ses idées au ministre, Michel Hansenne, membre du PSC d’alors, ancêtre de l’actuel CDH. « Du jour au lendemain, j’ai été catalogué calotin. J’étais chrétien, j’ai fait l’école catholique, mais je ne savais même pas ce qu’était la politique.» La trentaine tassée, la conscience politique qui ne s’éveille que par soubresauts, il prend une carte du parti, par défaut. Bref, il suit le mouvement. « Vu sa réputation d’athlète, c’était logique que je le recrute, rappelle Michel Hansenne, qui découvre, lui aussi, les couloirs d’un ministère. C’était une collaboration intéressante puisqu’il avait des connaissances dans le milieu et, surtout, des convictions sur le terrain .»
« Ouvert à tout »
Roger se fait les dents, doucement. En réalité, il ne sait pas trop où il a mis les pieds et on le lui fait remarquer. « C’est son sentiment, pas le mien, conteste Michel Hansenne. De toute façon, ce n’est pas d’un très bon militant politique que j’avais besoin, mais d’un gestionnaire sportif compétent. Et c’est ce qu’il était. » Aujourd’hui encore, Lespagnard se dit « ouvert à tout », ni de droite, ni de gauche. Au centre, mais « plus socialiste que les socialistes eux-mêmes ». En 1987, sept ans après avoir quitté son premier ministère, il réintègre un cabinet. Jean-Pierre Grafé, figure du PSC liégeois, s’installe, entre autres, à l’Enseignement et aux Sports. « Roger, c’était un technicien, pas un politique, souligne Jean-Pierre Grafé. Il était très peu politisé, mais il faisait preuve d’une fidélité extraordinaire. Je pouvais le consulter sans problème, même après mon départ. » Ils se rencontrent à Sclessin, où Lespagnard officie en parallèle comme préparateur physique du Standard. Ensemble, ils lancent une campagne anti-tabac. Le comble. « Je fumais comme un Turc », glousse l’avocat de formation, qui envoie son poulain au charbon. Lors d’un discours à Francorchamps, Lespagnard démonte tout ce qui touche à la nicotine. Les patrons du circuit de Spa rient jaune: des marques de cigarettes les sponsorisent; un fonds de commerce s’évapore. « Ils n’étaient pas contents. On parlait de dizaines de millions de francs belges, chiffre le principal intéressé, songeur. Je soupçonne mon ami Jean-Pierre de m’avoir envoyé là-bas parce que lui n’osait pas le dire. »
Finalement, deux arrêtés royaux, en 1990 et 1991, interdisent de fumer dans les lieux publics. Roger Lespagnard quitte le cabinet un an après. Chez les Rouches, il côtoie Michel Foret, secrétaire général du club. L’ex-sénateur et gouverneur MR lui glisse ces mots, à moitié ironique: «Fais attention, tu vas devenir député. » Troisième sur la liste du PSC, persuadé de ne jamais entrer à la Chambre, Lespagnard se présente, naïf, en 1994. Le voilà député, en pleine affaire Agusta. Six ans plus tôt, plusieurs ministres socialistes sont accusés de corruption pour l’achat d’hélicoptères de combat. Il observe, encore: « J’étais dans l’hémicycle, tout était à huis clos. Chacun venait exposer avec ses avocats, et tout le bazar qui va avec. C’était d’un niveau supérieur au mien. » C’était aussi l’époque de la vache folle et d’un autre dossier épineux, celui concernant Marc Dutroux. Au terme de son mandat, en 1999, il accouche de son bébé : un projet de loi sur la reconnaissance juridique des empreintes génétiques, qui deviennent enfin des preuves légales. Roger avance en bon petit soldat du parti, avec un dévouement que rien ne laissait pourtant présager. Né au lendemain de la Seconde Guerre, il grandit à Boncelles, sur les hauteurs de Liège. « Le dernier village communiste, sourit-il. Le bourgmestre bossait à Cockerill, juste en dessous. Je voyais les fumées des hauts-fourneaux de chez moi. » Une enfance classique pour un marmot de son temps, entre la messe, l’école et le commerce du père, qui vend du beurre et du lait. Si loin des considérations du pouvoir. À ses vingt bougies, il se met au décathlon. Son pote Freddy Herbrand lui refile le tuyau, deux ans avant les Jeux de Mexico. Ils s’asseyent dans les travées de l’arène olympique quand Tommie Smith et John Carlos montent sur le podium. Les deux sprinteurs noirs lèvent un poing ganté pour protester contre la ségrégation raciale qui sévit aux États-Unis. « Je me suis demandé ce qu’ils étaient en train de faire, avoue le coach de Nafi Thiam. En 1968, dans mon esprit, la politique, ça n’existait pas. J’en avais rien à faire. Moi, c’était les Jeux qui m’intéressaient. »
Rien ne peut le détourner de cet objectif. Dix jours avant l’ouverture des Jeux, le 2 octobre, une fusillade éclate à Tlatelolco, quartier de la capitale mexicaine. L’armée ouvre le feu sur une manifestation étudiante et enlève la vie à près de 300 personnes. Roger Lespagnard poursuit sa préparation, sans trembler. « Je vois encore les centaines de militaires sur notre chemin vers le stade. Mais j’avais d’autres problèmes. J’étais toujours ce gamin de Boncelles qui faisait du beurre avec son père, avant d’aller à l’école et de revenir pour m’y remettre. En fait, j’ai fait ça toute ma vie: travailler jour et nuit. Je ne sais pas faire autrement. » Rebelote en 1972, à Munich. Au retour d’un entraînement, il apprend la prise en otage de onze athlètes de l’équipe israélienne par l’organisation palestinienne Septembre noir. Il loge à une centaine de mètres. Bloqué. Ennuyé, surtout. Son décathlon doit se dérouler deux jours plus tard… « Une nuit, il y a eu un sacré bordel dans les souterrains. Il y avait aussi plein de policiers, des hélicoptères, puis ça s’est mis à canarder. De loin, on voyait un peu ce qui se passait. » Les onze Israéliens sont assassinés, un policier allemand est tué, tout comme cinq des huit membres de Septembre noir.
Le lendemain, Lespagnard n’assiste pas à la cérémonie de recueillement, trop longue, qui repousse par la même occasion son épreuve. « Ça devait durer des heures. C’était le barnum, souffle-t-il. J’étais un peu embêté parce que normalement, je ne me repose que deux jours. Là, c’était trop. Mais bon, il y avait plus important…» Le 8 septembre, il se place au quatorzième rang, troisième Belge. Au Liban, l’année d’avant, il frôle un grave accident alors qu’il effectuait un stage à Beyrouth, non loin du quartier où viennent de s’installer Yasser Arafat et son Organisation de libération de la Palestine. Une Mercedes percute le coupé sport qui le ramène à l’hôtel. Le chauffeur d’en face termine en prison, tandis que Roger s’en tire avec les côtes choquées, le souffle coupé. Comme ce jour de 2000, où il échoue à l’élection communale de Fléron, après douze ans au poste d’échevin des Sports. Il se réveille dans l’opposition, sans mandat, et retourne à l’enseignement, faute de mieux. En 2010, après dix ans de disette, il renverse la majorité et s’empare du mayorat, grâce à une coalition avec le MR et une alliance avec Ecolo. Huit ans plus tard, il est toujours bourgmestre. Désormais, il connaît les règles. « C’est intéressant de voir qu’il est devenu une espèce d’acteur du monde politique. À croire que sa première expérience avec moi ne l’a pas trop dégoûté », ironise Michel Hansenne. « Il a mordu dedans, abonde Jean-Pierre Grafé, qui ne le croise que rarement au parti. La plupart des membres ne savaient même pas qu’il était le coach de Nafi Thiam. Il n’a jamais exploité ce statut .» Jusqu’à ce qu’elle explose, en 2016. Mis à part un titre d’ambassadrice de l’Unicef, Nafissatou Thiam, elle, se désintéresse de ce « monde ». Studieuse, discrète, modèle. Elle lui ressemble. « C’est notre papa sportif, illustre Elsa Loureiro, par ailleurs sparring-partner de Nafi. « Quand elle performe, c’est la Belgique entière qui est heureuse. Ce n’est pas qu’une Wallonne qui gagne, c’est plus que ça .» Une autre réussite de Roger Lespagnard, qu’il le veuille ou non. Produit du métissage, fille d’une mère namuroise et d’un père sénégalais, Nafissatou Thiam représente un symbole fort. « J’entraîne des Noirs, des demi-Noirs, des demi-Blancs, des Jaunes, des Verts… Je ne fais pas attention à tout ça », coupe-t-il, le regard trahissant sa méfiance. Les vipères guettent. « Je lui ai surtout dit de ne pas faire de politique, parce qu’on va se servir d’elle. Et si jamais, c’est elle qui doit s’en servir. » —[:]