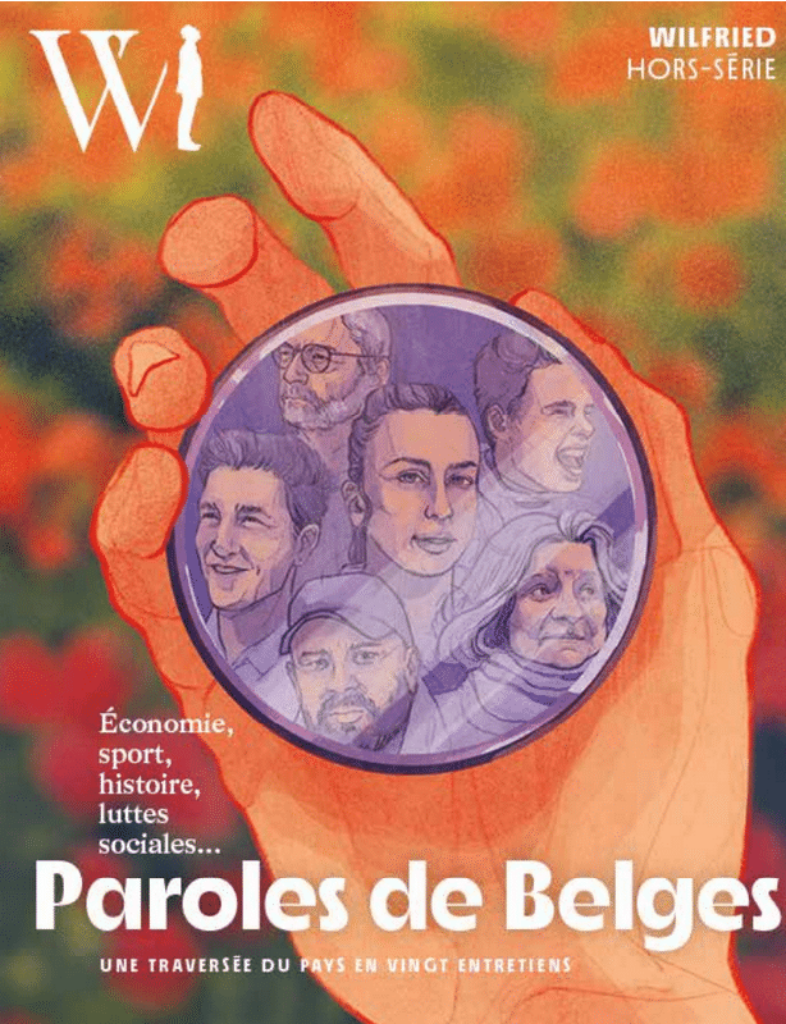Mouscron, le Far West wallon.
[:fr]
« – Ce serait alors un crime, monsieur Arsène. Le crime des crimes, un suicide.
– Possible, répliqua le maire de Fenouille. Que voulez-vous ? Je ne suis pas trop vaillant de nature, je ne me fais pas à l’idée de me détruire autrement. Sinon ! »
Georges Bernanos, Monsieur Ouine
C’était vers la fin de l’hiver. Pas le dernier, la sortie 2 et de là, le boulevard des Alliés, route nationale celui d’avant. Jean-Pierre Detremmerie s’est donné la mort. C’était le maïeur. Depuis quelques années déjà, on ne le voyait plus, sauf longer les murs, ombre de lui-même, isolé, accablé d’un terrible tremblement. C’était que le maïeur, pas de quoi se sentir orphelin. Bien que lui le fût. Enfant de l’assistance publique, dit-on. Quand même. Être le premier citoyen de Mouscron pendant plus d’un quart de siècle et finir au bout d’une corde sur la terrasse de sa petite maison, chaussée d’Aelbeke. « On n’arrive toujours pas à comprendre, hein », ressasse André Delhaye, ancien secrétaire fédéral de la CSC-Hainaut occidental, qui l’a fréquenté trente ans durant. Comme si, avec le temps, devait inévitablement surgir un élément qui éclaircirait le mystère, qui rendrait le geste – et sa violence – moins opaque.
Le jour même de ses funérailles était prononcé le non-lieu relatif à son inculpation dans le cadre des financements occultes de l’Excelsior, son club de foot, sa passion dévorante. On serait tenté de voir dans cette simultanéité un lien de causalité, de placer des parce que entre sa mort et les affaires. Mais les choses sont-elles si simples ?
On se souvient des mots de son avocat, Me Gérard Rivière. « Il était affligé par la trahison de certains de ses proches. » On se rappelle les larmes de Georges Leekens, l’entraîneur qui avait emmené la petite équipe de Mouscron vers la première division, au mitan des années 1990. « On était tous des frères, presque des enfants de Detremmerie, raconte aujourd’hui l’ex-coach des Diables rouges. C’était une ambiance terrible. Du jamais vu. » Petit dormeur, bon vivant, tyran, bourreau de travail, fervent catholique, excessif, homme de pouvoir, homme au grand cœur, Detrem était un personnage qui ne se laisse pas cerner en quelques mots quand deux suffisent à résumer son parcours. Rise. Fall.
Rares sont les hommes qui ont laissé sur leur ville une empreinte aussi colossale que Detrem à Mouscron. Une ville étonnante, Mouscron. Far West wallon – seule Comines-Warneton, ricochet de Wallonie, se trouve plus à l’ouest encore. Coincée entre la Flandre et la France, c’est le tracé de la frontière linguistique qui la jette, en 1963, dans le Hainaut. Avant cela, elle appartient à la Flandre occidentale et vue du ciel, elle fait incontestablement partie de la métropole lilloise. Peu importe donc les découpages administratifs.
Le Mouscronnois s’accommode de cette identité en creux, de n’être ni Wallon, ni Flamand, ni Français. Mouscron reste Mouscron tant que la bière y coule à flots au marché de Noël, à la fête des Hurlus, au Bœuf gras, aux 24 heures ou à n’importe quel soir de match au Canonnier.
On n’arrive pas dans cette ville par hasard. Ceux qui ont décidé de s’y établir avaient une bonne raison. Les paysans menacés de famine s’y sont installés pour accéder facilement aux emplois industriels français. Les grandes familles du textile du Nord y ont établi leurs usines, sûres d’y trouver, outre une fiscalité attrayante, une main-d’œuvre qualifiée et peu disposée à l’agitation sociale. Des entreprises agroalimentaires flamandes l’ont choisie en résultat de la politique des zonings. Les Français y font des incursions pour acheter des clopes à meilleur prix.
On n’arrive pas dans cette ville par hasard. Passé Tournai, l’E42 file vers Lille. Un peu plus loin, l’automobiliste qui a une bonne raison la quitte pour emprunter l’E403 jusqu’à comme il y en a tant, garnie de ce que l’American way of life a de meilleur à offrir : concessionnaires, pompes à essence, supermarchés, McDo, bowling. Plus loin, la route croise le boulevard Industriel. Le rond-point est encombré de camions mais il faut l’emprunter pour prendre la direction du centre. Si on passe sous le chemin de fer puis qu’on le longe jusqu’à la gare, on aperçoit les vestiges épars de l’industrie textile, comme la manufacture Vanoutryve et sa cheminée, remarquable dans un paysage urbain où rien ne dépasse. Les quartiers frontaliers vont à vau-l’eau, gangrenés de night shops aux enseignes tapageuses qui rompent un peu la monotonie des façades mitoyennes. Celles-ci ne sont pas très grandes, mais on peut y loger sa famille et Pierre Bachelet.
On n’arrive pas dans cette ville par hasard et pourtant on y recense quelques épisodes insolites, dont personne ne veut chercher à savoir s’ils appartiennent à la légende ou à l’histoire. Jimi Hendrix y aurait donné son seul concert belge. Madonna y aurait séjourné l’année de ses vingt ans, tandis que le Chanteur s’imaginait allant les boire, ses vingt ans, avec l’ami Jojo et avec l’ami Pierre, dans le quartier de Mont-à-Leux, chez l’Adrienne.
C’est aussi une ville qu’on quitte, qu’on délaisse, dont on s’extirpe. En chevauchant les mots, comme Raymond Devos, « qui a compris le malheur trop tôt », dira-t-il, quand les affaires textiles de son père comptable ont été comme tant d’autres balayées par la crise de 1929. On la quitte à bicyclette, parce qu’il faut que le destin, si tragique soit-il, s’accomplisse. La mort a dit non à Frank Vandenbroucke à trois reprises. Elle s’est ravisée sur la côte sénégalaise. On la quitte à la faveur d’une faille juridique, comme les frères Mpenza, parce que le contrat mal ficelé avec l’Excelsior permet d’aller poursuivre sa carrière au Standard de Liège. On la quitte tout simplement, comme Jean-Marc Nollet, Thomas Gadisseux ou Stéphane Pauwels parce que le monde est vaste et qu’elle ne fait que 40 km2.
Boston et New York dépendent encore de la couronne britannique que Mouscron s’occupe déjà de textile. Des familles quittent Tourcoing et Roubaix pour s’installer dans ce qui n’est alors qu’un village agricole, sur le territoire des Pays-Bas autrichiens, afin de poursuivre leur activité que des corporations lilloises sont parvenues à faire interdire par arrêté royal pour s’en réserver la pratique exclusive.
En mode homeworking, elles filent et tissent à domicile la laine et le lin pour fabriquer le molleton, que le marchand reprendra. On est encore loin du fracas des usines, de la chaleur des ateliers, des mains avalées par les machines et du sifflet qui signe la fin de la journée. Néanmoins, cette industrie balbutiante marque pour Mouscron le début de l’ère textile. Celle-ci durera plus de deux siècles.
Fin du XIXe siècle, les grandes familles industrielles du Nord installent à Mouscron des extensions de leurs usines qui feront de la ville un centre réputé de filature de laine peignée et de tissage de tapis. Au milieu du siècle dernier, la soixantaine d’entreprises textiles mouscronnoises occupent quelque six mille ouvriers. Deux mille personnes franchissent quotidiennement les portes des filatures Motte. À ces chiffres, s’ajoutent les onze mille frontaliers mouscronnois qui partent chaque jour travailler en France, dans le textile aussi.
Dès les années 70, ça devient coton. La concurrence internationale force les entreprises à fermer, les unes après les autres. L’incidence sur l’emploi est considérable. À la manière d’une rouille, la misère commence à ronger les porte-monnaie et le moral. Il faut y apporter une réponse sociale, économique, politique. Les temps sont mûrs pour l’entrée en scène d’un leader aux épaules larges et au pedigree unique. Ce sera Jean-Pierre Detremmerie. Mais patience.
On dit de Raymond Devos qu’il est le Hurlu le plus célèbre. Il n’est pourtant pas le Devos le mieux connu des Mouscronnois. Robert Devos sera le premier bourgmestre du grand Mouscron, après la fusion en 1977 avec Luingne, Herseaux et Dottignies. Dans cette agglomération où le pilier social-chrétien domine, sa plus belle intuition est d’avoir unifié politiquement les deux principaux cénacles d’obédience catholique : le petit cercle, issu du monde ouvrier, lié aux syndicats et aux mutualités, et le grand cercle, plutôt ancré à droite, proche des classes moyennes. L’opération propulse le Parti social-chrétien (PSC) au rang de première force politique, reléguant le Parti socialiste à la deuxième place pour bien des décennies.
Parmi les jeunes loups qui évoluent dans l’ombre de Robert Devos, se détache un trentenaire bonhomme à la tête rassurante de prof de néerlandais, bordée d’un collier de barbe et piquée d’un nez tombant : Jean-Pierre Detremmerie. Son enfance ressemble à du Dickens. Il dit avoir vécu dans la rue quand son père, invalide, respirait encore. Privé de ses deux parents avant l’adolescence, il restera marqué à jamais par un bref séjour à l’orphelinat d’Aartrijke, près de Bruges, suivi de l’heureuse prise en charge par un oncle paternel. Il partage ses années d’adolescence entre le salon de coiffure de celui-ci et l’internat du collège Saint-Joseph, à Mouscron. Renfermé, complexé, il est alors loin de l’animal politique qu’il va devenir. Mais, en secret, il nourrit de grandes ambitions pour sa ville. Detremmerie s’estime redevable envers elle puisqu’il a longtemps vécu à sa charge. « Revenait régulièrement dans son discours le fait qu’il avait une dette vis-à-vis de Mouscron. Il devait travailler sans cesse pour payer cette dette », rapporte Guy Depauw. C’est à ce dernier que Devos remet, en 1980, son écharpe maïorale élimée par vingt années au service de Mouscron. En 1982, Detrem renforce le score déjà excellent du PSC.
En 1986, le bourgmestre crée l’intercommunale d’étude et de gestion (IEG), structure agile au périmètre d’action limité et débarrassée de l’encombrante Tournai. Municipaliste en diable, il n’est pas prêt à confondre les intérêts de sa ville avec ceux de ses écrasantes voisines. «Il mangeait du Tournaisien à peu près à tous les repas », se marre encore Patrick Declerck, président du Royal Excel Mouscron et patron d’une entreprise de béton architectonique. Bien vite, l’IEG devient l’instrument privilégié de la stratégie de reconversion industrielle mouscronnoise. À travers elle, Jean-Pierre Detremmerie se lance dans une entreprise de séduction du patronat de Flandre occidentale.
Le bouche-à-oreille fonctionne rapidement. Detrem va frapper à toutes les portes, va chercher tous les subsides, se décarcasse pour trouver des solutions. Il peut régler en deux jours des problèmes que d’autres mettent deux mois à entendre. L’histoire des deux Roger, Mylle et Dick, l’illustre assez bien. Roger Mylle, négociant en patates, décide de se lancer dans la frite surgelée. Éconduit par le bourgmestre de Courtai qui reste sourd à ses demandes, il se tourne vers Detrem qui lui fixe rendez-vous le lendemain, à 7 heures du matin. Le soir même, le contrat est signé et Mylle installe Mydibel à Mouscron. L’entreprise emploie aujourd’hui plus de 400 personnes. Quand l’usine de légumes surgelés de son ami Roger Dick brûle, il le met en relation avec Detremmerie. Il faut impérativement qu’un site de production soit opérationnel dans les plus brefs délais, au risque de perdre la récolte de l’année. L’IEG relève le défi et l’engagement est tenu : Dicogel s’installe à Mouscron. Les deux amis s’associeront plus tard à travers Roger & Roger pour créer les chips Croky.
Au sein de l’IEG, Detremmerie s’appuye sur Guy Depauw, pour qui il a créé une fonction sur mesure, « animateur économique ». Celui-ci joue le rôle de rabatteur et c’est au Cristal, restaurant gastronomique en face du cimetière du Risquons-Tout, que les contrats se signent et que les mains se serrent. Roland, le patron, n’a pas son pareil pour mettre le client à l’aise. Farceur invétéré et grand amateur de vin, il laisse rarement un client traverser le bar, passage obligé pour accéder à la salle, sans lui servir quelques pintes. Certains jours, Detrem invite jusqu’à trois industriels au même déjeuner. Le bourgmestre fait le tour des tables. Entrée avec l’un. Poignée de main. Plat avec le suivant. Signature. Dessert avec le troisième. Promesse. Cette stratégie va permettre de quintupler, le portant à 500, le nombre d’entreprises présentes sur le sol mouscronnois.
Disponible pour les investisseurs, il l’est aussi pour ses administrés, qui savent où le trouver. Depuis les cafés de la Grand-Place, les noceurs aperçoivent la lumière de son bureau à l’hôtel de ville s’éteindre, vers 23 heures. Ensuite, il fait la tournée des estaminets, où il paye des coups à boire, parfois jusque tard dans la nuit. Le lendemain, il est à pied d’œuvre dès 7 heures. Il tient aussi permanence à domicile. Sa femme, Françoise, ouvre la porte et sert le café. Le samedi, on est presque sûr de le retrouver au Rallye, chez Paula, juste en face de chez lui. C’est là aussi que le bourgmestre emmène ses échevins, après les réunions du collège, pour des palabres qui se prolongent longtemps après la tombée du jour. Les dimanches d’après-match, ce sont les apéros corsés suivis de longs banquets à La Cloche, restaurant tenu par son ami « Double-Gras », Ghislain Coussement pour l’état-civil.

The Moody Blues et Madonna.
Ce dévouement total à sa ville repose sur une sorte d’impatience ontologique, le pressentiment qu’il n’aura pas le temps de faire tout ce qu’il doit. La hâte le pousse à actionner tous les leviers, à réunir en un temps record tous les acteurs impliqués dans une décision. Lorsqu’il apprend, un samedi soir de match, que l’abattoir des frères Goemaere, à Wevelgem, est parti en fumée, il saute sur la balle et leur propose de se rencontrer le lendemain à 10 heures. À 15 heures, il a réuni tous les intervenants concernés, communaux, régionaux, pompiers, services de l’eau. Le mardi expire le premier cochon Goemaere d’une longue série, rentabilisant ainsi un abattoir qui, depuis des années, tournait en sous-régime.
En se rasant en ce matin diaphane de l’automne 1996, Jean-Pierre Detremmerie voit face à lui un homme comblé. Il est député-bourgmestre. L’intercommunale qu’il a sortie du néant fête ses dix ans et son efficacité ne se dément pas. Les entreprises se pressent pour obtenir un terrain dans les zonings des environs. Un businessman égyptien associé à des hommes d’affaires de Waregem s’apprête à acheter quatre hectares à Mouscron pour y bâtir une usine de tapis. Il exige que le compromis soit signé au Caire. Flingues, gardes du corps, suite avec vue sur le Nil, salons privés… Detrem prend la parole devant un aréopage d’industriels et de ministres égyptiens puis revient avec 5 millions de francs belges pour les caisses de l’IEG. L’usine ne verra pas le jour, l’Égyptien s’étant disputé avec ses partenaires, mais l’IEG gardera l’argent. Detrem peut jubiler. Mais ce qui étire le plus son sourire sous la mousse à raser, c’est un exploit impensable : avoir permis à son club de football, l’Excelsior, de se hisser en D1, au terme de la saison 1995-1996.
Le stade du Canonnier n’est pas n’importe quel stade. Sous la tribune, trois vitraux un peu grossiers protègent une demi-douzaine de vierges, en bois, en plâtre, en pierre, en verre. Disposées en ronde, en alternance avec des bougeoirs, la lueur vacillante des flammes donnerait presque l’impression qu’elles dansent, étrange sabbat, autour d’une sphère posée sur des galets et coiffée d’un chapelet. Le globe renferme le mécanisme d’une fontaine. L’ensemble évoque une crèche de Noël vaguement folklorique, plutôt qu’un lieu de recueillement. Il faut croire que le bourgmestre défunt y a vu le réceptacle adéquat de ses prières. Soucieux d’œcuménisme, l’abbé Jean-Yves Pollet avait proposé d’y ajouter une fontaine pour symboliser l’idée universelle d’un Dieu source de vie. Mais les symboles catholiques et la figure de Marie ont pesé plus lourd que les conseils de l’ami abbé.
« Jean-Pierre était très pieux. Beaucoup plus pieux que moi, qui suis prêtre », relève Jean-Yves Pollet.
Detremmerie qui, dans ses jeunes années, a couvert pour Nord Éclair les matchs de l’Excelsior quand le club n’était qu’en promotion, qu’on voyait circuler dans sa Coccinelle verte, président du comité des jeunes, a installé son club dans la cour des grands. Début des années 2000, ministres et patrons se pressent au Canonnier. « Si tu es un Mouscronnois frappe des mains », entonnent-ils bras dessus, bras dessous. Il règne à Mouscron une ambiance unique, familiale, dont peut témoigner le chroniqueur télévisé Stéphane Pauwels.
Ce dernier, recruté par Detrem en qualité de conseiller marketing, a vécu de près l’ascension fulgurante. « Si on gagnait le samedi soir, qu’il y avait entraînement le dimanche matin, on mangeait à La Cloche jusqu’à 5 heures. Et on rigolait. On riait plein notre panse. On buvait des chopes et on riait, on riait. C’était Mouscron, quoi. C’était la fête. En fait, ça n’a jamais été un club de foot, c’était des buveurs de mousse qui aimaient bien le football. » Alex Teklak, qui a usé neuf saisons durant ses crampons dans le Canonnier, garde pour sa part le souvenir d’un Detrem subtil psychologue. « Il ne s’intéressait pas qu’au joueur de foot mais aussi à l’homme qu’il y avait derrière, à sa famille. Il avait mis en place des personnes annexes qui s’occupaient de trouver des maisons aux joueurs qui venaient chez nous. Il avait instauré les cours de langue Berlitz qui étaient suggérés aux joueurs étrangers. »
Jean-Pierre Detremmerie attribue-t-il au dessein divin les réussites flamboyantes de l’Excelsior ? Se croit-il récompensé de ses rendez-vous furtifs – et quotidiens – avec la fascinante Vierge, à l’église Notre-Dame de la Marlière, juste de l’autre côté de la frontière, à Tourcoing? Peu importe si, dans son dos, les médisants l’appellent le sacristain, tant qu’il la voit, toute petite et drapée de noir à l’entrée, immense pourtant, vêtue d’or derrière l’autel. Couronnée. Énigmatique toujours. Comment fait-elle pour être partout, plus pâle à Beauraing, sans couronne à Lourdes, multiple mais une au bout du compte, quand sa mère à lui n’est nulle part, n’est aucune ?
L’ascension de l’Excelsior, l’impatience de Detremmerie et son rapport à l’argent forment un cocktail explosif. « L’argent, il ne connaissait pas. Il disait que les banques étaient pleines d’argent. On trouvera l’argent, disait-il sans cesse », relate Guy Depauw. Quand le club se hisse en première division, il devient une obsession pour Detremmerie qui «conditionne presque tout aux succès de l’Excel, de façon toujours plus irrationnelle », indique André Delhaye. « Il avait quasiment déplacé l’administration communale au stade. Ils travaillaient tous là », complète Michel Franceus, échevin de la culture et actuel président de l’IEG.

Il faut sans cesse nourrir la bête. Toujours plus gourmande, elle réclame des festins pour les joueurs, pour les maisons des joueurs, pour les entraîneurs et les nouvelles tribunes. Au début, l’IEG est un garde-manger bien rempli et les sponsors privés se laissaient traire de bon cœur. Mais ça passe. Bien vite, l’argent vient à manquer. Il faut insister auprès des patrons installés à Mouscron, leur faire comprendre que le sponsoring n’est qu’un juste retour des choses pour les bonnes conditions dont ils ont bénéficié. Jusqu’à ce que certains se sentent rackettés.
Detrem prétend qu’il s’agit de difficultés passagères, de problèmes de liquidités, le temps qu’on finalise la vente d’un joueur. En fait, l’argent s’évapore dès qu’il approche du Canonnier. Les montages financiers sont de plus en plus confus, de plus en plus faramineux. Detrem est un joueur incapable de quitter la table.
Il avait fait campagne avec ce slogan : «Detrem, qui d’autre ?» Comme un boomerang, la réponse lui revient, cinglante, lors des élections communales de 2006.
En 1997, il répétait qu’il devait trouver pour le club un million de francs belges par jour. Cinq ans plus tard, il annonce aux journalistes, devant un Hugo Broos médusé, qu’il ambitionne de doter le club d’un budget d’un milliard.
« Un tel projet demandait du temps, analyse l’entraîneur avec le recul. Dix ans, quinze ans, étape par étape, mais si on finit troisième lors de la première année en première division, ça fait rêver. Quand tout est très facile, on perd la réalité de vue. On manque des étapes clés et ça se paie après. »
Il avait fait campagne avec ce slogan: « Detrem, qui d’autre? » Comme un boomerang, la réponse lui revient, cinglante, un soir d’élections communales, au mois d’octobre 2006. Le scrutin se solde par une déculottée. Pour chaque citoyen qui a coché son nom, deux ont glissé dans l’urne un bulletin en faveur d’Alfred Gadenne, son fidèle échevin des travaux. Au bout de la nuit, le décompte des voix est cruel : 2 874 pour Detremmerie, 7 083 pour Gadenne. Ce n’est pas un problème dont devrait se soucier un despote éclairé. « Les élections, je n’ai pas le temps pour ça », se plaisait à dire le patron du CDH mouscronnois, constamment affairé. Le suffrage universel a pourtant scellé son destin. En vertu d’un nouveau décret wallon, les clés de la ville reviennent automatiquement au candidat qui totalise le plus de voix sur la liste la plus importante de la majorité. Ce sera Gadenne, donc.
« Vous n’aurez jamais à rougir de votre papy »
Difficile de trouver deux hommes plus dissemblables. Alfred Gadenne est un buveur d’eau. Il ne va pas au stade. Il rentre manger chez lui à midi. Chaque jour que Dieu fait, il ouvre à 8 heures précises la grille du cimetière de Luingne, emprunte l’allée principale et salue par leur prénom certains de ses électeurs retournés à la poussière. Chez les Gadenne, on s’appelle Alfred de grand-père en petit-fils et Henri quand on est fils d’Alfred et père d’Alfred. Les deux Henri qui l’ont précédé ont été bourgmestres de Luingne – son père le restera pendant plus de trente ans. Petit agriculteur et prisonnier de guerre, il aurait été porté en triomphe par la population cleugnotte à la Libération pour avoir partagé les maigres récoltes avec ceux qui avaient faim. La tactique du fils, électoralement payante depuis de nombreuses années, est d’occuper en permanence le terrain. « Les petits scouts du Risquons-Tout se réunissent l’après-midi ? Ben, si le bourgmestre ne passe pas, ils sont pas contents. » Pendant vingt-quatre ans, Gadenne a veillé à régler les petits problèmes de chacun, à envoyer quelqu’un tailler une haie qui dépasse ou résoudre un problème d’égouttage, accroissant ainsi sa popularité auprès d’une population de plus en plus exaspérée par la folie des grandeurs de Detremmerie.
Detrem s’est ménagé une porte de sortie. Deux mois après les élections, il prend la présidence de l’IEG. Avec ce poste, il est assis sur le coffre-fort de la Ville, se gargarise-t-il.
En 2006, Philippe Dufermont, un homme d’affaires proche de l’Excelsior, rachète à la Ville un bâtiment, rue de Menin, ayant abrité un magasin Sarma. Le produit de la vente est versé sur le compte du club, pas sur celui de la Ville. Le système de vases communicants entre la ville, l’équipe de foot et l’intercommunale apparaît au grand jour. Une enquête est ouverte, des perquisitions sont menées, au domicile de Detrem notamment. Qui s’épanche dans les médias : « Quand je suis rentré hier, j’ai dit à mes enfants et à mes petits-enfants : Vous n’aurez jamais à rougir de votre papy, de votre papa. Je le redis en public aujourd’hui. »
Fin janvier 2009, les échevins CDH prient Detrem de démissionner de tous ses mandats. Il refuse. Le 1er février, une procédure d’exclusion du groupe centriste au conseil communal est engagée contre lui. Le surlendemain, à l’antenne de No Télé, Jean-Pierre Detremmerie apparaît flegmatique. S’il est démontré qu’il a commis une faute, il en assumera pleinement les conséquences, détaille-t-il sur un ton presque patelin. Mais il refuse de se retirer pour des combines. Il a la conscience tranquille, assure-t-il, au contraire d’autres pour qui « le silence sera lourd à porter ».
Deux semaines plus tard, dans la salle du conseil communal, ils sont tous là, face à lui, ceux qu’il connaît depuis si longtemps, qu’il a conseillés, guidés, couvés dans leur parcours politique. Mathilde Vandorpe, Michel Franceus, Damien Yzerbyt… Damien, son suppléant aux dernières régionales.
Ce soir-là, l’agitation est extrême. Jean-Pierre Detremmerie tremble. «Je vous demande simplement d’avoir la correction de répondre par oui ou par non et de me dire si je fais encore partie du groupe des élus CDH de Mouscron. » « Non », répond Alfred Gadenne. Alors, il s’assied tout au bout, à côté des écologistes. Il demande la parole quand vient à l’ordre du jour la question des mandats à attribuer. Ses mandats. Ceux qu’on lui retire. Le micro est trop haut et ses premiers mots sont perdus. Il abaisse le micro puis tape deux fois dessus pour s’assurer qu’il fonctionne. Les gestes d’un étranger.
Une voix sarcastique s’élève de l’assemblée. « C’est le micro de l’opposition, il va falloir s’y habituer ! » De partout, les banderilles fusent. Il se donne en spectacle, il n’est pas digne de ce qu’il a été, s’indignent en chœur les élus mouscronnois. Ça commence à bien faire! Qu’il s’en aille ! Faut-il dire merci, sourire et partir sur la pointe des pieds quand vos partenaires vous jettent dehors ? A-t-on encore le droit de cracher son dégoût d’avoir été tout bonnement trahi ?
On l’apercevra encore quelques fois, conseiller sans étiquette. « Je vais siéger sans famille, mais comme j’ai été sans famille à mes débuts, être sans famille n’est pas quelque chose à me surprendre. »
Fin 2009, l’Excelsior se met en liquidation volontaire. Dès 2010, il apparaît que les caisses de l’IEG sont vides. Le coffre-fort sur lequel Detrem disait être assis cachait un puits sans fond, un déficit de 4,5 millions d’euros pour les seuls secteurs de la ville de Mouscron.
Detrem est à genoux et la douleur est intense, bien plus que celle causée par les écorchures sur le marbre portugais de ses pèlerinages à Fatima. Il réalise peut-être que la politique lui a tout pris, sans rien lui donner en échange. Au détriment de ses enfants par exemple, pour qui il n’a peut-être pas été présent comme il aurait voulu et qu’il a par la suite essayé maladroitement d’aider, de pousser, de placer, d’imposer dans les structures auxquelles il avait accès, accroissant encore l’ire à son égard. C’est son fils cadet qui se retrouve désormais dans la tourmente. Lettre anonyme. Harcèlement. Emplois fictifs. Faut-il être acharné pour chercher à l’atteindre à travers ses enfants ? Va-t-on faire payer à ses fils le fait qu’il est leur père ? Son fils cadet a-t-il déconné ?
En décembre 2011, Detremmerie est inculpé de faux, usage de faux et abus de biens sociaux, suite de l’enquête sur les financements occultes de l’Excelsior.
Orphelin, il s’était sans doute inventé des parents, et des démons un peu plus grands que ceux des autres. Et pour les combattre, peut-être s’était-il dit que le seul moyen était de vivre parmi les hommes, de leur accorder sa confiance, de les aider comme il le pouvait, en bon chrétien. Mais le temps a passé et, de la même manière qu’il s’est résolu, sur la fin de sa vie et à la surprise générale, à ne plus consommer d’alcool, il décide alors qu’il peut très bien se passer de la compagnie des hommes. On ne le voit plus, dès lors, que s’éclipsant de l’église avant la fin de la messe, se rendant à la Marlière, qu’il approvisionne en cierges, longeant les murs pour aller chercher ses petits-fils à l’école et, peut-être, les emmener à la ferme Saint-Achaire, la structure de réinsertion des sans-abri de l’abbé Pollet, par lui rendue possible.
Est-ce la vieillesse ? L’usure ? Les nerfs, qui à leur tour trahissent ? Est-ce qu’à vivre à 200 km/h, on arrive au bout du chemin avant les autres? Est-ce que l’âge tient inévitablement le bras de la maladie ? Tant de ceux qui comptent ont déjà levé l’ancre. Jacques Fervaille. Ghislain Coussement. Damien Yzerbyt, emporté en quelques semaines par le même fléau que celui contre lequel sa femme lutte depuis si longtemps. Mourir, la belle affaire.
Chaussée d’Aelbeke, le Rallye aurait bien besoin d’un coup de peinture. Il est désormais loin le temps où les murs résonnaient des rires des plus vaillants échevins. La maison familiale est en vente. Les fils Detremmerie, orphelins à leur tour, l’ont vidée. Ils ont offert à l’abbé Pollet les statues, les icônes, les livres de piété dans lesquels Detrem soulignait les passages où il était question de pauvreté, et cinq ou six bibles.
Sur la Grand-Place, les noceurs guettent en vain désormais. Ce n’est pas le genre Gadenne de venir mettre un verre, la nuit. Et surtout, le bourgmestre est maintenant installé dans le nouveau centre administratif, au bout d’une esplanade Damien Yzerbyt, piquée d’une très improbable œuvre d’art, hommage maladroit au poulain disparu trop tôt, au M. Kurtz d’Au cœur des ténèbres ou à Vlad l’Empaleur, on ne sait trop. Pas de square Detremmerie ni de statue pour l’instant, dans une ville pourtant prompte à baptiser ses lieux publics du nom de ses illustres personnages.
Que reste-t-il de l’ère Detremmerie ? Des entreprises dans les zonings, et des gros camions qui y entrent ou en sortent. Là où on faisait pousser des patates, à présent, on les pèle, on les coupe, on les cuit, on les frit, on les écrase, on les surgèle, on les emballe. Call it progress. —
[:]