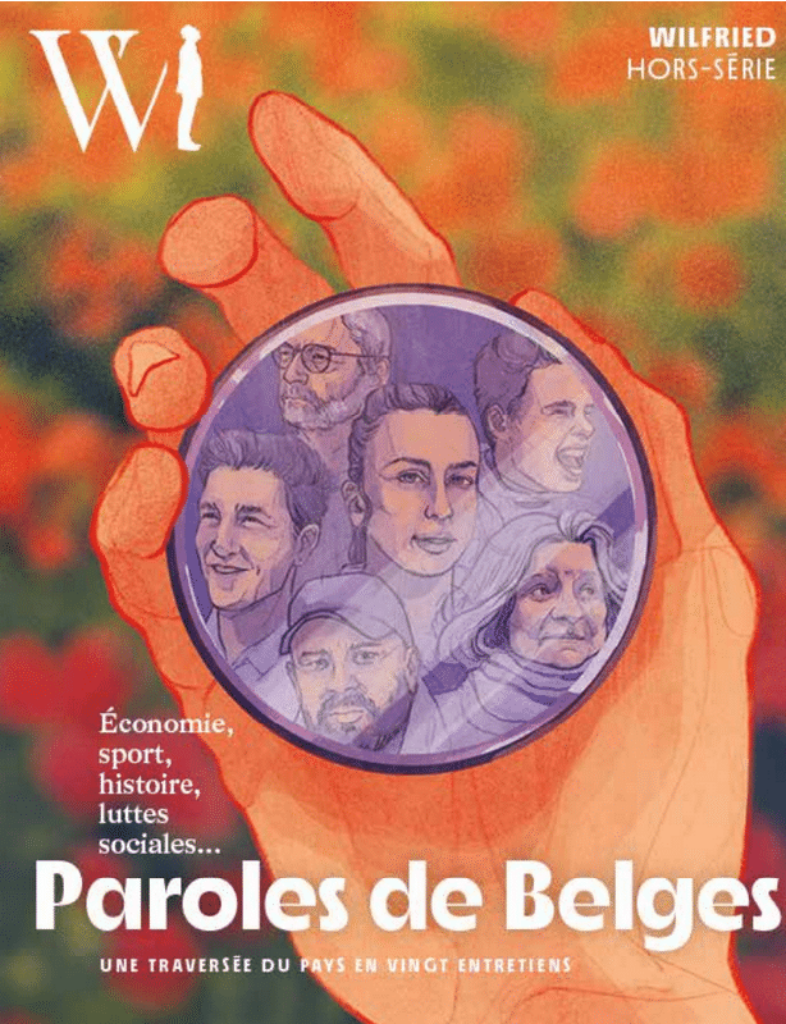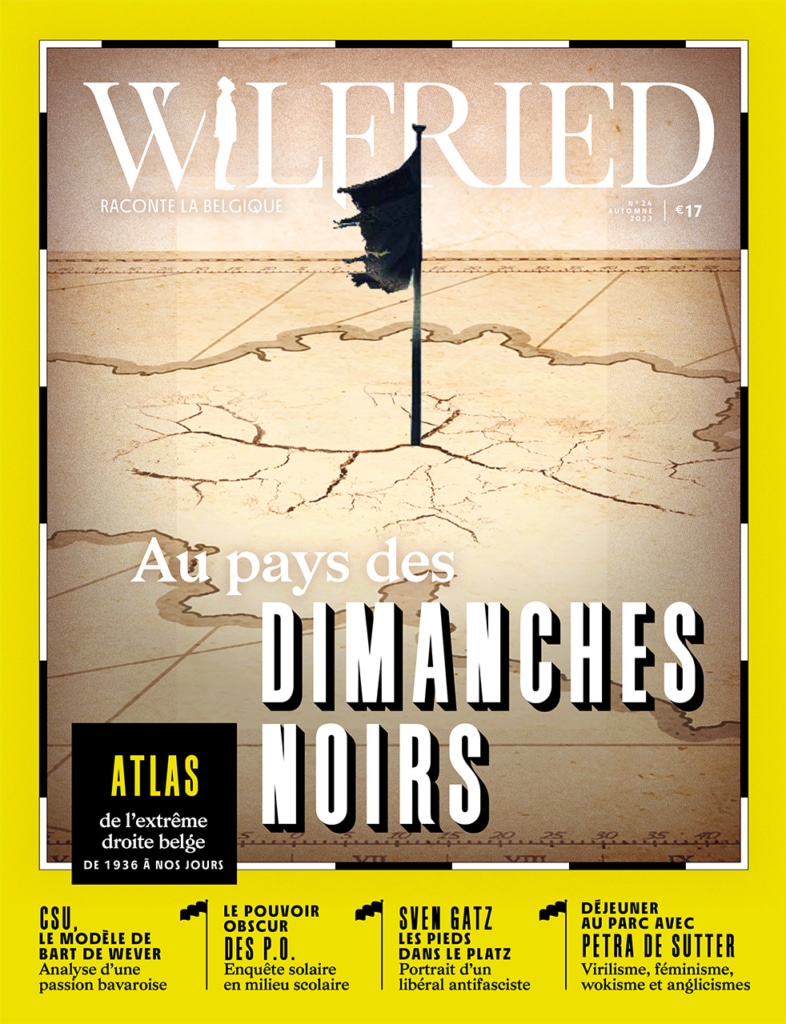Pour l’entendre citer du Platon ou du Heidegger, il faudra repasser. Pour la verve et la spontanéité aussi. Par contre, Charles Michel s’épanche enfin en matière d’écologie. D’habitude peu bavard sur la question, le Premier ministre est invité à parler d’aviation, de pailles en plastique et de biodiversité. Son mantra n’a toutefois pas changé : des jobs, jobs, jobs, la clé de voûte du développement (durable). Lui qui est de la génération de Rio 1992, le premier sommet mondial sur l’environnement, maintient sa totale confiance dans la capacité du « génie humain » à relever le défi du réchauffement climatique. Un entretien en toute prudence, où l’on ne saura pas si, oui ou non, Charles Michel a bu du vin de Moselle avec Emmanuel Macron.
[:fr]
Le Premier ministre s’en souvient-il ? C’était en 2006. Dans la salle des fêtes d’une école secondaire d’Ottignies, en Brabant wallon, des représentants de chaque grand parti francophone – PS, MR, Ecolo et CDH – sont appelés à débattre devant les rhétoriciens de l’établissement. C’est Charles Michel, fraîchement émoulu bourgmestre de Wavre, qui défend l’écurie libérale. Au cours des échanges, la représentante d’Ecolo se lance dans une tirade en faveur d’une forme de décroissance.
Du haut de ses 31 ans, le fils de Louis la coupe sèchement : « Si on suit votre raisonnement, on devra bientôt pédaler sous sa douche pour avoir de l’eau. » Déluge de rires dans la très jeune assemblée. Charles Michel savoure sa réplique en se resservant une rasade de Spa gazeuse. Son adversaire avale de travers. Dans les derniers rangs de la salle se trouvait l’un des futurs journalistes de Wilfried, qui n’a jamais oublié la chiquenaude anti-Ecolo du futur Premier.
L’anecdote semble l’attester : Charles Michel n’était pas, à l’époque, le plus fervent supporter de programmes visant à préserver l’environnement et à lutter contre le réchauffement climatique. Les temps ont changé. Charles Michel est désormais Premier ministre. Quand il s’exprime, il ne s’adresse plus à des rhétoriciens d’un collège brabançon, mais à l’ensemble du peuple belge. Le spectre d’un réchauffement dévastateur est devenu obsédant. Révolue, l’époque où l’on badinait avec le climat. Charles Michel s’est donc offert une timide mue écologique. Par opportunisme, par obligation, par conviction ?C’est ce qui a guidé cet entretien : l’entraîner sur un terrain qu’il arpente, à nos yeux, très rarement.
La rencontre avec le Premier ministre a eu lieu peu après le décès de Mawda, 2 ans, tuée accidentellement par un tir de la police belge, laquelle poursuivait une camionnette transportant une trentaine de migrants kurdes. Ce drame place les questions migratoires encore un peu plus au centre des débats. Comment, dès lors, ne pas interroger le Premier ministre sur sa conception des frontières ? Notion de plus en plus connectée au réchauffement de la planète : l’ONU annonce 250 millions de réfugiés climatiques à l’horizon 2050.
Rien, dans le bureau de Charles Michel, au 16 rue de la Loi, ne révèle la personnalité de l’homme qui y séjourne. Hormis une peinture du surréaliste belge Pierre Alechinsky. La présence d’un tableau surréaliste dans le bureau de Charles Michel peut sembler elle-même surréaliste, tant le personnage use d’un discours calibré. Certains de ses prédécesseurs (Jean- Luc Dehaene, Guy Verhofstadt, Herman Van Rompuy…) s’exprimaient avec davantage d’éclat et de spontanéité.
Charles Michel s’inscrit dans la filière de l’extrême prudence et de la parole formatée – le canal Wilfried Martens, Yves Leterme, Elio Di Rupo –, masquant pourtant une violence froide, contrôlée. À l’opposé de son père, l’ancien ministre Louis Michel, le Pantagruel de Jodoigne à la verve chaleureuse, qui confiait au Vif/L’Express en 2014 : « Charles fonctionne à l’analyse, pas à l’instinct. C’est une différence assez fondamentale avec moi. En fait, il est beaucoup plus le fils de sa mère, qui est une personne hyper rigoureuse. »
Une carrière en politique était difficilement contournable pour le jeune Charles. Enfant, il assistait, dans la maison familiale de Saint-Jean-Geest, au ballet des citoyens qui venaient présenter par dizaines leurs doléances au bourgmestre de Jodoigne. La mère Michel ravitaillait les troupes en faisant couler des jattes de café. À 17 ans, Charles est nommé président de la fédération des Jeunes Réformateurs libéraux de Jodoigne. Pas de temps à perdre pour le « fils de ».
En 1999, il entre à la Chambre en tant que député. Sur son pupitre, il découvre une lettre manuscrite signée par son père, dans laquelle ce dernier lui souhaite une heureuse carrière. Lui-même fils de maçon, Louis Michel en profite pour administrer au fiston une sorte de testament philosophique, l’encourageant à garder à l’esprit la dimension sociale du libéralisme. Il faut être du côté des faibles, écrit-il, ne jamais oublier d’où l’on vient.
Cette mise en garde recelait, peut-être, une part prémonitoire. Charles, à la droite du Père ? Pour de nombreux observateurs, l’ancien bourgmestre de Wavre s’est éloigné du libéralisme social prôné par Louis. Éloignement qui a nettement gagné en substance après l’accord de gouvernement signé avec la N-VA en 2014, consacrant Charles Michel au poste de Premier ministre à 38 ans – le plus jeune de l’histoire de la Belgique.
— L’enjeu climatique semble fort absent de vos priorités, de vos préoccupations. on n’a pas le souvenir que vous ayez prononcé un discours marquant sur le sujet. Le président français Emmanuel Macron, avec lequel vous entretenez une certaine proximité politique, semble faire preuve de bien plus de volontarisme sur le sujet. Il a nommé Nicolas Hulot ministre de l’Environnement. Il a lancé le hashtag #MakeourPlanetGreatAgain après la décision de Donald Trump de se retirer des accords de Paris.
C’est vraiment dingue, ce que vous me dites là, parce que la formule Make our planet great again, je l’ai utilisée avant Emmanuel Macron.
— Ah, il vous l’a chipée ?
C’est plutôt les grands esprits qui se rencontrent, à mon avis… Non, plus sérieusement, la presse internationale ne regarde pas l’expression du Premier ministre belge sur les accords de Paris comme elle regarde celle du jeune président français qui vient d’entrer en fonction. Et puis, ce sont les accords de Paris, pas de Bruxelles.
— On sent quand même chez Macron, ou chez Angela Merkel, une volonté plus nette de mettre l’écologie à l’avant-plan.
C’est vrai qu’on ne peut pas collectionner dix identités à la fois, et que la première d’entre elles, pour moi, ce fut d’abord les jobs. Dans développement durable, il y a durable, mais il y a aussi développement. Si on veut pousser le développement, on a besoin de jobs. C’est peut-être cette ambition-là qui a davantage retenu l’attention.
Ensuite, la réalité sécuritaire s’est imposée à nous suite à la tragédie qu’ont été les attentats de Paris et de Bruxelles. Mais je peux vous garantir que le pacte énergétique, directement connecté aux questions environnementales, est un sujet de préoccupation permanent. Je n’assiste pas à une seule rencontre bilatérale avec un autre chef de gouvernement sans que la question du climat ne soit abordée parmi les quatre ou cinq points principaux.
— Vous pensez sincèrement, en votre for intérieur, qu’on parviendra à limiter le réchauffement climatique à l’échelle planétaire au fameux seuil des deux degrés, au-delà duquel la planète basculerait dans un état d’instabilité incontrôlable ?
Je pense qu’on doit en tout cas être ambitieux.
— Mais vous qui êtes de la génération du sommet de Rio, qui fut en 1992 le premier cri d’alerte mondial, vous savez pertinemment qu’on dit ça depuis bientôt trente ans. on voit où on en est…
La différence, même par rapport aux années 2000, c’est que la responsabilité humaine n’est plus niée. J’observe un consensus sur le diagnostic. En outre, qu’on soit de gauche ou de droite, le réchauffement climatique n’est plus vu comme une contrainte mais comme une opportunité pour le développement économique et l’innovation. Je me distancie par contre de certains environnementalistes radicaux, qui sont prêts à assumer une stratégie de décroissance.
— La décroissance des émissions de CO2, cela dit, est jugée indispensable par tous les experts sérieux. Comment la concilier avec la croissance économique ?
Je crois que les sciences et l’innovation sont une des clés très importantes. Elles nous permettront de réconcilier la question du développement et de la durabilité. Prenez la problématique du stockage d’énergie, ou celle des batteries : il va falloir des bonds technologiques pour les résoudre. Quand j’étais enfant, on utilisait de gros téléphones à touches ATT ; aujourd’hui, ma fille de deux ans et demi chipote avec aisance sur une tablette. Ces bonds, je crois, vont s’accélérer. Mais c’est une mutation qui prendra tout de même des années.
— Le problème, c’est que le réchauffement climatique appelle des réactions très rapides. N’est-ce pas pécher par excès de naïveté de penser qu’on pourra respecter les accords de Paris grâce aux progrès technologiques – sans changer fondamentalement nos modes de vie par ailleurs ?
Si vous avez trouvé la baguette magique qui va nous faire passer du jour au lendemain d’un monde avec plein de carbone à un monde sans carbone, donnez-la-moi, je l’utiliserai avec plaisir. Mais ça ne se passera pas comme ça. Je vous donne des faits. La Belgique est le deuxième pays d’Europe, après la France, à avoir mis en place les green bonds, pour cinq milliards d’euros.
Il s’agit d’obligations vertes, qui consistent en réalité à investir dans le cadre de projets respectueux des accords de Paris. Autre exemple, les éoliennes : ce fut un sujet extrêmement difficile, on a pris nos responsabilités. Même chose avec le rail, puisqu’on a libéré le milliard d’euros dit vertueux pour relancer le RER. C’est très concret, ce n’est pas simplement dire: j’attends béatement que les innovations technologiques règlent le problème.
— Cela dit, la Belgique régresse dans certains domaines.
Par exemple ?
— Le trafic aérien. Il n’est pas intégré de façon chiffrée dans les accords de Paris. Or, le trafic aérien international représente déjà 5 % de l’impact humain sur le climat, et ce chiffre n’arrête pas d’augmenter. La Belgique, pendant ce temps, s’enorgueillit de l’essor de ses aéroports.
Je compte sur les ingénieurs pour rénover l’aéronautique.
— Mais demandez à des ingénieurs. Ils vous diront qu’il n’existe pas de solution technologique, malgré de multiples expériences. Selon eux, dans vingt ans, l’avion propre ne sera toujours pas sorti d’usine.
Les ingénieurs que je consulte sont plus optimistes que les vôtres, alors. Maintenant, je ne veux pas être populiste sur un sujet pareil. Le développement des aéroports est aussi lié à la vitalité économique, aux échanges, aux connexions… Je ne crois pas dans un futur où chacun serait replié sur lui-même. Je décèle par ailleurs de nombreuses avancées positives. La révolution à laquelle on assiste en une génération est assez spectaculaire. L’acte de consommer, par exemple, est devenu un acte politique.

— À la marge, peut-être.
Non, pas du tout. Je vais vous en faire la démonstration. En Belgique, un secteur est en grande difficulté : la grande distribution. Il n’a pas vu l’accélération du changement dans le comportement des consommateurs. Ce secteur doit maintenant se transformer. Regardez les réformes chez Carrefour, chez Mestdagh… Le citoyen demande de la transparence sur les prix, des produits locaux, des circuits courts. C’était marginal voici dix ou quinze ans, c’est généralisé aujourd’hui.
Sur ces sujets-là, la population est en ébullition. Je suis donc moins pessimiste que vous. Je pense que l’histoire du monde a révélé sa capacité à affronter les défis grâce à de soudaines accélérations de l’innovation. Mais la transition énergétique, c’est un processus long et compliqué. On nous reproche par exemple de manquer de détermination sur la sortie du nucléaire, mais l’alternative va mettre en péril nos engagements environnementaux. On ne peut pas plaider tout et son contraire.
— Vous voulez dire qu’entre réduire les émissions de CO2 et sortir du nucléaire, il faut choisir ?
Non, je ne dis pas ça, je dis simplement…
— Parce que c’est ce qu’affirme la N-VA.
La N-VA a voté la loi qui prévoit la sortie du nucléaire en 2025, donc la N-VA peut affirmer ça, mais elle a voté la loi. Non, la réalité, c’est qu’il existe des principes qui ne sont pas spécialement concordants. Les tarifs, par exemple. Parce qu’on peut soudain déclarer : c’est parti, on respecte dès à présent les accords de Paris, comme ça (il claque des doigts), et on impose des normes très strictes pour y arriver, comme ça (il reclaque des doigts). Mais qui va le plus souffrir des factures d’électricité qui ne manqueront pas de flamber ? Les moyens et bas salaires. Voilà la différence entre ma vision en tant que Premier ministre et celle de ceux qui hurlent dans l’opposition : moi, je suis en responsabilité. On doit donc avancer de manière balancée.
« Si vous avez trouvé la baguette magique qui va nous faire passer du jour au lendemain d’un monde avec plein de carbone à un monde sans carbone, donnez-la-moi, je l’utiliserai avec plaisir. Mais ça ne se passera pas comme ça. »
— Autre domaine où la Belgique fait figure de mauvaise élève : la sauvegarde de la biodiversité. Fin mai dernier, dans La Libre Belgique, 270 scientifiques belges appelaient le gouvernement à se mobiliser pour la protection des animaux et des végétaux. Notre pays serait-il insensible à la « sixième extinction de masse », comme la définissent les scientifiques ?
Pour être tout à fait franc, ce sujet n’est pas du ressort principal du gouvernement fédéral. Il appartient d’abord aux entités fédérées.
— Mais un Premier ministre peut donner l’impulsion.
Oui, d’ailleurs, dès qu’on peut mettre quelque chose en œuvre, on le fait. Récemment, on a interdit les pesticides totaux de façon immédiate, purement et simplement; et de façon progressive, les pesticides dits sélectifs, c’est-à-dire composés d’assemblages de molécules qui posent problème.
— Pourquoi n’agissez-vous pas plus vigoureusement pour réduire la production de plastique, qui s’avère être un désastre environnemental ? Même si la compétence relève des régions, le gouvernement fédéral dispose, lui aussi, de certains leviers.
Le plastique est extrêmement polluant, c’est un vrai problème. Vous parlez de la Belgique, mais il faut se rendre en Afrique subsaharienne, et même au Maroc, pour comprendre visuellement ce que ça représente. Quand on sait les délais impressionnants de désintégration du plastique… Heureusement, des start-up sont en train de développer des contenants dans des matériaux totalement biodégradables.
— Sept restaurants McDonald’s en Belgique viennent d’interdire les pailles en plastique. Que le secteur privé prenne des mesures environnementales avant que les autorités publiques ne les lui imposent, n’est-ce pas le signal que là aussi, nos gouvernements sont à la traîne ?
Moi, je trouve ça bien que certaines entreprises adoptent une vision avant-gardiste.
— Pour le coup, c’est peut-être l’État qui est arrière-gardiste.
Franchement, la vérité est au milieu. Ma vision du monde, ce n’est pas l’idée d’un plan quinquennal du parti communiste qui détermine ce qui est bien et ce qui ne l’est pas. Je compte sur la conscience individuelle et la liberté d’entreprendre pour jouer ce rôle d’aiguillon. Ce n’est pas l’État qui est responsable de tout et l’initiative privée de rien. Quand j’allais à des festivals dans ma jeunesse, les gobelets étaient en plastique. Aujourd’hui, je constate qu’ils sont réutilisables. Je ne suis pas naïf, mais je pense que le génie humain, la force créatrice de l’humanité, ont souvent réussi à relever des défis qu’on croyait insurmontables.
— Même avec un Donald Trump à la tête des États-Unis, qui doute encore de la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique ?
Le danger, avec les États-Unis, c’est qu’ils risquent de pratiquer du dumping environnemental vis-à-vis de l’Europe depuis leur sortie des accords de Paris. De nouvelles alliances sont donc nécessaires.
— « Nous devons forcer la création d’un label “made in Europe”, pour sensibiliser les citoyens au thème du patriotisme économique », déclariez-vous en mars 2013. À l’époque, vous jugiez intolérable que « des pays émergents, avec cynisme, inondent notre marché de produits qui ne remplissent pas les mêmes exigences sociales et environnementales que les produits européens ». Vous semblez avoir déserté ce terrain du « made in Europe » comme enjeu écologique.
Absolument pas. Je suis pour la réciprocité, je suis contre un monde protectionniste. Le libre-échange a entraîné, sur le plan mondial, un recul de la pauvreté, une progression de l’accès à l’éducation… Par contre, on doit arrêter de permettre, là où se pratique le libre-échange, que d’autres ne le pratiquent pas, de manière directe ou déguisée. Pendant que nous, en Europe, nous ouvrons notre marché public aux entreprises extra-européennes, les États-Unis ferment presque totalement leur marché public aux entreprises non américaines. Ce n’est pas correct.

— Restons sur cette notion de frontière. En septembre 2015, votre père, Louis Michel, estimait dans La Libre Belgique qu’il est « difficile pour un libéral de ne pas considérer que tout être humain sur terre a un droit inaliénable à aller où il veut ». Et il poursuivait : « La liberté qui vit au cœur de chaque être humain ne se laissera jamais contraindre durablement par des frontières, quand bien même on tenterait de les protéger par tous les moyens. Je pense que les frontières sont des notions totalement artificielles. (…) Imaginons qu’on ouvre toutes les frontières du monde, où iraient les flux ? Là où il y a des besoins. Cela aboutirait à une régulation plus naturelle des flux migratoires. » Le même questionnement vous anime-t-il parfois ? Comment, sur le plan philosophique, peut-on interdire à un être humain d’aller où il veut sur la terre ?
Je conçois parfaitement que, quand on est universaliste, on estime que tout homme, toute femme a les mêmes libertés fondamentales intrinsèques.
— Y compris la liberté de circulation ?
Oui. C’est d’ailleurs ça, l’Europe, avec l’espace Schengen.
— Les frontières externes de l’Europe, elles, sont durement contrôlées. Certains parlent d’une Europe forteresse.
C’est un slogan d’une absurdité totale. La Belgique figure dans le top 7 des pays européens qui accueillent le plus de migrants. Au moment où je vous parle, 6 000 places d’accueil sont disponibles, dans la minute, dans le réseau Fedasil. Si un candidat à l’asile vient en Belgique pour s’établir dans notre pays car il est persécuté dans le sien, il introduit une demande et il est aussitôt pris en charge par le réseau Fedasil – contrairement aux fables, je dis bien aux fables, répandues par certains responsables associatifs et politiques. J’entends bien la question philosophique, mais en tant que Premier ministre, je ne me contente pas d’être un philosophe, je suis confronté aux questions de sécurité, de séjour irrégulier et donc de la protection de nos frontières. Le débat sur les migrations en Europe est très difficile. Pas seulement parce que les Hongrois et les Polonais ne veulent pas assumer leur part de responsabilité – quand bien même on aurait un accord avec eux, ça ne mettrait pas un terme aux crises qui sévissent au sud de l’Europe – mais parce qu’il faudrait mettre en place des canaux de migration légaux et organisés depuis l’autre côté de la Méditerranée. Plutôt que de permettre un modèle qui laisse des passeurs et des trafiquants prospérer en envoyant à la mort des migrants sur des rafiots pourris… Ça, c’est un vrai sujet qu’il faut oser aborder.
— Vous parlez de crises migratoires au sud de l’Europe. Dans votre analyse, de quoi résultent-elles ?
Le cocktail explosif dans cette région mélange croissance démographique exponentielle en Afrique, réchauffement climatique, et en de nombreux endroits, insécurité, manque de démocratie, faiblesse de l’État de droit et absence de certaines libertés fondamentales. Ce cocktail va faire pression sur l’Europe. Le premier enjeu à mes yeux, c’est le développement de l’Afrique. Il faut qu’émerge sur ce continent une classe moyenne. Dans beaucoup de pays africains, on observe soit des super-riches, soit des super- pauvres. Or, une classe moyenne garantit une certaine stabilité et une certaine cohésion de la société. C’est important pour l’Afrique, c’est important pour l’Europe : en l’absence de classe moyenne, l’insécurité persistera, offrant un terreau favorable au terrorisme et aux conflits.
— Selon l’écrivain et philosophe français Régis Debray, le souci des droits de l’homme a curieusement pris la forme, ces dernières années, d’une arrogance occidentale. Les grandes puissances européennes ne manquent-elles pas, parfois, d’humilité ?
Ma conviction intrinsèque, en tant que libéral, c’est que la liberté individuelle – qui suppose une responsabilité – constitue le moteur le plus sûr pour améliorer le projet collectif. Partout où nous avons voulu nier ou écraser cette liberté individuelle, hier ou aujourd’hui, cela a engendré davantage de pauvreté, de misère, d’insécurité. La question, c’est plutôt : comment atteindre ces objectifs ?
Je crois qu’en effet, dans l’histoire, certains gouvernements ou certaines ONG, animés par les meilleures intentions du monde, ont glissé vers une forme d’arrogance. Notre modèle démocratique en Europe, très imparfait car en permanence remis en question – si j’en crois le président de la Ligue des droits de l’homme en partance (Alexis Deswaef, ndlr), la Belgique est une dictature, et je caricature à peine –, notre modèle démocratique, donc, est le fruit de plusieurs siècles, depuis Montaigne, Voltaire, le siècle des Lumières, d’un processus fait de pas en avant et de pas en arrière.
Certains, à tort, ont suivi un raisonnement selon lequel existerait un modèle de perfection démocratique. Quand je regarde la situation dans des pays qu’on dit « en développement », où la notion de respect des aînés ou de solidarité par exemple est très forte, je me dis qu’on a des choses à apprendre de ces sociétés sur le plan culturel. On est trop peu nombreux, dans notre pays, à faire preuve de cette ouverture d’esprit. Je pense être parmi ceux qui tentent d’avoir cette remise en question de notre manière de faire, voire de notre manière d’être.
— C’est un secret de polichinelle : vous vous entendez très bien avec Emmanuel Macron, ainsi qu’avec le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel.
C’est vrai. D’ailleurs nous nous sommes déjà vus à six avec ma compagne Amélie, Brigitte Macron et Gauthier Destenay, le mari de Xavier Bettel. Une première fois à Paris, une seconde au Luxembourg.
— Le tout arrosé d’un bon vin de Moselle ?
Oh, je ne sais plus de quoi il s’agissait…
— Qu’est-ce qui vous lie, tous les trois, tous les six ?
D’abord, nous sommes globalement confrontés aux mêmes défis : la sécurité, la lutte contre le terrorisme, le développement économique, la protection de notre modèle de sécurité sociale, l’avenir de l’Europe, les défis technologiques comme l’intelligence artificielle… Aussi, nous sommes de la même génération, ce qui contribue à nous rapprocher. Le courant passe bien, tout simplement.
Et puis, nous exerçons des fonctions dont la pression engendre un impact sur nos vies privées. Il nous arrive donc, avec Xavier Bettel et Emmanuel Macron, d’avoir une dimension plus intime. Quand je dis plus « intime », je ne dis pas voyeuriste. Je veux parler de la recherche de l’équilibre entre des fonctions tellement exigeantes et la capacité à entretenir notre jardin privé, qui est un ressourcement dans lequel on puise notre énergie pour affronter les tempêtes. —
[:]