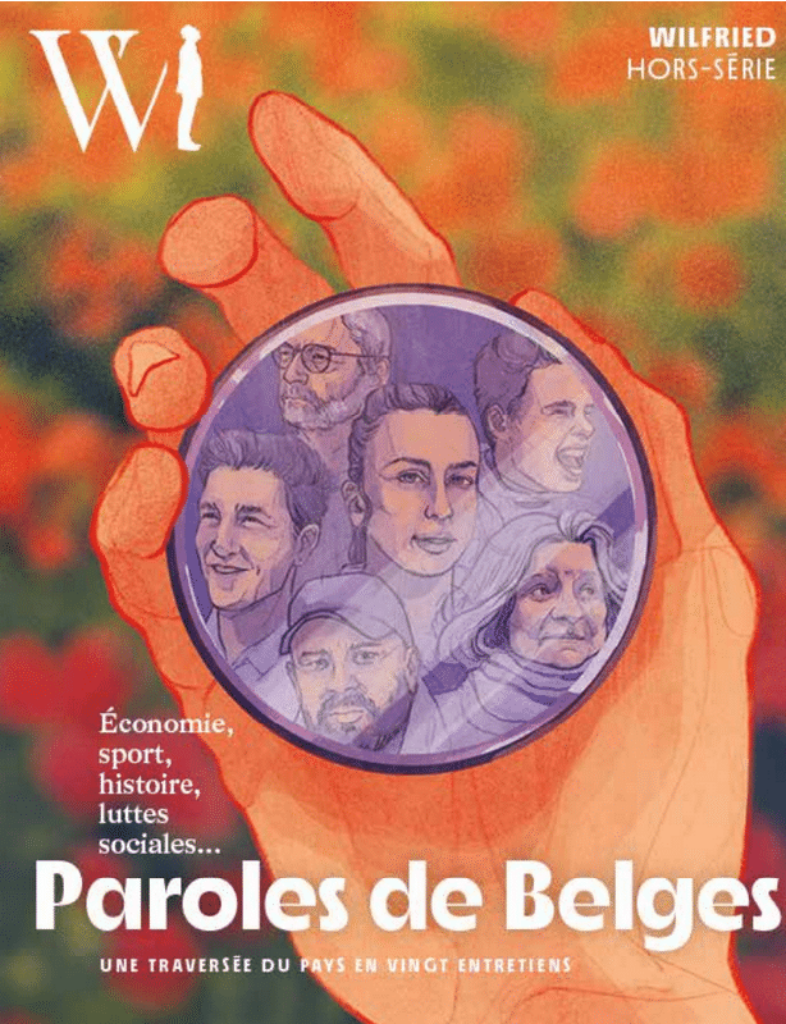Quatre mille âmes, une rue principale, une gare, deux églises et une usine. Bienvenue à Charleroi ! Pas la ville wallonne fondée sur les rives de la Sambre. Non, la bourgade nord-américaine traversée par la route 88, dans la vallée de la rivière Monongahela. De Charleroi à Charleroi : l’hiver dernier, Paul Magnette a entrepris, avec quelques amis, un parcours à travers la « ceinture de l’acier », dans le nord-est des États-Unis, pour observer le redressement d’une région meurtrie depuis la fermeture des hauts-fourneaux et des aciéries. Pour « Wilfried », qui ne recule pas devant le talent de jeunes pigistes, le bourgmestre socialiste en a tiré un récit de voyage, balade étonnée dans une contrée où de nombreux ouvriers ont voté Trump. Cette déambulation impressionniste est aussi une méditation sur une question aujourd’hui parmi les plus débattues de la sociologie politique : pourquoi les pauvres votent-ils à droite ?
[:fr]
Nous ne devions nous arrêter qu’une heure à Charleroi. Une brève halte au cours de notre long périple sur les routes de la Pennsylvanie, de l’Ohio et du Michigan. Voyager léger, entre amis, sans les contraintes des visites officielles.
Nous ne voulions avoir de compte à rendre à personne, être libres de bifurquer à tout moment, au gré des rencontres. Un seul point du programme n’était pas négociable : nous irions voir Charleroi, Pennsylvania, la seule ville au monde qui porte le même nom que la nôtre, fondée en 1890 par des verriers carolos. Quatre mille âmes, deux kilomètres carrés, une rue principale, une gare, deux églises et une usine. Pas de quoi remplir une journée, pensions-nous. Mais on ne plaisante pas avec l’hospitalité des Carolos, pas plus en Pennsylvanie qu’en Wallonie.

À Pittsburgh, nos interlocuteurs avaient paru sceptiques. Nous étions venus pour comprendre comment les grandes villes de la Rust Belt se relèvent après la fermeture des hauts- fourneaux et des aciéries. Pittsburgh était la réponse parfaite, pourquoi se perdre dans la vallée ? Nous ne le savions pas nous-mêmes. Mais nous ne pouvions simplement pas passer à 30 miles d’une ville nommée Charleroi sans faire le détour.
Nous étions arrivés pleins d’espoir, nous repartions vaguement déprimés.
Sur papier, Pittsburgh est en effet la réponse parfaite. Elle a redécouvert ses rivières, rasé les usines désaffectées, sans en conserver le moindre vestige, pour bâtir des parcs, des places et d’immenses tours de parking. Le monde des affaires s’est rassemblé, formant avec les maires démocrates successifs une alliance sacrée, pour attirer les fleurons des nouvelles technologies, et subventionner la création du Cultural District. Sous la neige, nous avons parcouru les immenses campus des deux grandes universités. Nous nous sommes réchauffés dans les Starbucks et Shake Shack, attablés entre deux étudiants absorbés par l’écran de leur Mac. À la poursuite de Jennifer Beals, dont les danses rageuses avaient tourmenté notre adolescence, nous avons marché dans les quartiers où fut tourné Flashdance.

Sur les lieux des anciennes fabriques, nous n’avons croisé que lofts et bars cosmopolites, et plus personne qui se souvienne de Jennifer. De l’autre côté de la rivière, au Musée Warhol, l’enfant du pays qui a cédé l’essentiel de son œuvre à sa ville natale, nous avons croisé d’autres touristes, attirés comme nous par la légende du nouveau Pittsburgh.
Tom Murphy, l’ancien maire, nous a tout montré. Les villas patriciennes des ingénieurs rénovées avec soin. Les logements neufs, imitant les anciennes rues du Midwest prospère, là où dominaient naguère les fonderies et les laminoirs. Les immenses stades de base-ball et de football, posés sur les berges où trônaient les aciéries. Les anciens squats où Google a installé l’un de ses principaux centres de recherche, entraînant dans son sillage les hipsters-bikers. Tous les clichés de l’Amérique qui gagne. Pittsburgh a gagné sa bataille, et définitivement tourné la page. Seule la tour d’acier du puissant syndicat de la métallurgie rappelle qu’elle fut, un jour, une ville d’industrie lourde.
Nous étions arrivés pleins d’espoir, nous repartions vaguement déprimés. Contrairement à Pittsburgh, notre Charleroi n’est pas la métropole d’une aire urbaine de cinq millions d’habitants. Nous n’avons pas d’université. Pas de Downtown où se massent les tours des grandes compagnies historiques. Il y a beau temps que les fortunes faites ici sont parties fructifier ailleurs. Magritte a grandi au bord de nos terrils et canaux, mais le musée est à Bruxelles.
Nous étions impatients de prendre la route pour Detroit. L’ancienne capitale de l’automobile a perdu, comme Pittsburgh et beaucoup d’autres shrinking cities, plus de la moitié de sa population après la crise de l’industrie. Mais là-bas, pas de smart decline. Un chômage massif et tenace, de sombres affaires politico-financières, des milliers d’hectares à l’abandon.
Detroit ne fascine que les pionniers de l’agriculture urbaine et les néotouristes parcourant les usines désaffectées, un Canon autour du cou, comme les romantiques sillonnaient les friches antiques le carnet de croquis à la main. Mais, avant d’arriver dans la Motown, nous étions attendus de pied ferme à Charleroi. Pour qu’ils n’apprennent pas après coup que nous étions passés sans les saluer, nous avions prévenu les autorités de notre ville sœur de notre bref passage. Nous pensions ne nous arrêter qu’une heure. L’accueil carolo en a décidé autrement.

Suivant le conseil de Tom Murphy, nous avons délaissé l’autoroute et parcouru les 30 miles qui séparent Pittsburgh de Charleroi sur la route 88, longeant la rivière Monongahela. « It’s quite devastated down there.» La zone est sinistrée, nous avait prévenus Tom, avec dans le regard le regret de n’avoir pu propager le miracle de la grande ville jusque dans la vallée. Nous avons vu les petites fabriques, plus ou moins en activité. Les belles villas aux façades de bois blanc et les vastes jardins, rappelant que la vallée fut riche. La peinture lépreuse des petites maisons ouvrières, confirmant qu’elle ne l’est plus. Nous aurions pu être dans la Basse-Sambre, du côté de Moustier, ou en bord de Meuse, quelque part entre Andenne et Seraing.

Ici, pas de « smart decline ». Un chômage massif et tenace, de sombres affaires politico-financières, des milliers d’hectares à l’abandon.
Au bout de la route 88, un panneau accueille fièrement le visiteur : Welcome to Historic Downtown Charleroi, More than 100 businesses to serve you. Une voiture de la police nous attend, fumante dans l’air enneigé. Portant sur les flancs l’inscription Charleroi Regional Police et le matricule 911, elle semble sortie d’un épisode de Starsky et Hutch. Elle entre dans la ville à pas d’homme, pour nous laisser voir, en un long travelling, tous les signes de l’urbanité de Charleroi. Excités comme des adolescents en voyage scolaire, nous photographions tout ce qui porte le nom de la ville, le nom de notre ville. United States Post Office, Charleroi PA, 15022. Charleroi Pyrex Company. Charleroi Second Chance Community Church. Charleroi Masonic Hall. L’escorte marque un temps d’arrêt quand elle entre dans le Historic District. Une longue rue, parfaitement rectiligne, bordée de petites échoppes à un étage bâties à la fin de l’avant- dernier siècle. Nous sommes dans un album de Lucky Luke, première planche, quand le lonesome cowboy entre dans une ville nouvelle. La séquence ne dure que quelques secondes. Viennent les marchands de voiture d’occasion et les parkings, la ville se termine déjà. L’escorte tourne deux fois à gauche, franchissant les feux rouges suspendus au-dessus de la chaussée, peut-être pour montrer son autorité, peut-être parce qu’il n’y a personne en ville un jour de neige. On n’est plus dans Lucky Luke, on est dans Fargo.
Sur le perron de la mairie, la délégation officielle nous attend sous une bâche imprimée à la hâte : Welcome to our Sister City. Charleroi Belgium. Ils sont tous là, le maire, les conseillers municipaux et leurs épouses, les officiers de police et quelques quidams prévenus par Facebook de la visite du Mayor of Charleroi BE. Notre brève visite privée est devenue une rencontre officielle. Je reconnais le maire, Ed Bryner, je l’ai googlé avant d’arriver. Ancien ouvrier verrier, 63 ans, élu quelques mois plus tôt sous les couleurs des démocrates, sans rival. Barbiche blanche, regard azur, veste de cuir noir et casquette de base-ball, il me serre longuement la main. Puis tout le monde serre la main de tout le monde, dans de grands sourires et de franches accolades. Il n’y a pas cinq minutes que nous sommes entrés à Charleroi, mais nous sommes à la maison. On comprend vite que nos cousins américains ne vont pas nous laisser repartir de sitôt. La dernière fois qu’un Mayor of Charleroi BE a visité Charleroi PA, c’était il y a trente-six ans, me dit une conseillère en me montrant, tout en gravissant les escaliers, les coupures de journaux de l’époque qu’elle a conservées dans un grand classeur. « Ce n’est pas rien pour nous, vous savez. » Et pour nous donc.
Il faut tout visiter. La salle du conseil, ornée d’un plan du Charleroi des origines. La vaste pièce voisine où nos hôtes ont rassemblé, en notre honneur, les photos de tous les anciens maires et tout ce qu’ils ont trouvé d’images du Charleroi pionnier, celui qu’avait visité le président Roosevelt en 1905. Nous montons au dernier étage, voir la salle de spectacle. Depuis que le toit laisse passer la pluie, c’est là qu’on amasse les archives, mais les travaux sont pour bientôt. Nous descendons au rez-de-chaussée, visiter les locaux de l’administration fiscale et de la police, le bureau du shérif et la geôle. Il faut déjà repartir. Le timing est serré. Les représentants de la business community nous attendent au River House Cafe. Nos amis sont arrivés avant nous. Ils se sont installés le long de la grande table en U et nous ont laissé la place d’honneur, face à eux, comme dans un mariage. Ed Bryner invite ma First Lady à prendre place et s’assied sans un mot aux côtés de la sienne. Ce n’est pas un bavard. Il a laissé le rôle de maître de cérémonie à l’un de ses conseillers ; Larry Celaschi Jr porte le tee-shirt que son grand-père a rapporté de sa visite à Charleroi BE, il y a plus de vingt ans. Bombant le torse, il me montre le coq de Pierre Paulus, « You see, the rooster ? » Larry est à son affaire. Il a tout préparé. Un buffet de tacos, salades et doughnuts nous attend. Les bières sont servies, elles viennent de la brasserie Stoney, qu’un citoyen de Charleroi a gagnée au poker il y a plus d’un siècle. La recette n’a pas varié depuis 1907. Le maire trinque à l’eau, « I don’t drink anymore », explique-t-il sobrement. Personne ne semble surpris. Larry se saisit du micro et nous annonce le programme, avec l’intonation d’un meneur de music-hall. Nous écouterons d’abord les hymnes nationaux, puis il dira quelques mots au nom du maire. Nous recevrons la clef de la ville, et quelques cadeaux, tous made in Charleroi. Aux premières notes de La Brabançonne, tout le monde se lève et écoute les hymnes dans un silence d’école primaire.

Le lendemain, dans les éditions du Mon Valley Independent, c’est le discours du CEO de la Mon Valley Alliance que le correspondant retiendra. « We share more than a name », nous partageons plus qu’un simple nom. Nos histoires se ressemblent, malgré la distance et la différence de taille. Nous luttons pour survivre, après la débâcle industrielle, et préserver le way of life de nos petites communautés. Je n’ai pas grand-chose à ajouter. We share more than a name. Nous avons vécu la même crise, et nous résistons. Nous sommes les descendants des verriers qui ont quitté Charleroi BE il y a 128 ans, pour fonder Charleroi PA. Ils étaient pleins de peurs et d’espoirs à la fois. Ils savaient ce qu’ils quittaient, pas ce qu’ils trouveraient. The same for us. Le correspondant du Observer Reporter rapporte que plusieurs conseillers « avaient ressenti l’émotion de Magnette durant son discours». Georgios et Thomas, Carolos de naissance, Ben le Bruxellois et ma First Lady liégeoise étaient aussi émus que moi. Nous étions à six mille kilomètres de chez nous, dans une bourgade de quatre mille habitants, et nous avions en face de nous des Carolos. Ils nous parlaient d’eux et nous les entendions nous raconter notre histoire. Nous les regardions nous regarder. Nous leur disions nos difficultés, la fatigue d’entendre notre ville traitée avec mépris par les habitants des grandes villes voisines, ils croyaient entendre leur histoire.
Quand le grand magazine progressiste The Atlantic voulut comprendre, à la veille de l’élection présidentielle de 2016, pourquoi les ouvriers de l’ancienne Manufacturing Belt désertaient en masse le Parti démocrate, c’est à Charleroi qu’il envoya son reporter.
Quand le grand magazine progressiste The Atlantic voulut comprendre, à la veille de l’élection présidentielle de 2016, pourquoi les ouvriers de l’ancienne Manufacturing Belt désertaient en masse le Parti démocrate, c’est à Charleroi qu’il envoya son reporter. Il découvrit que les habitants de la Mon Valley, démocrates de toute éternité, avaient déjà tourné le dos à Barack Obama en 2008. Le jeune sénateur de l’Illinois avait eu le tort de déclarer que si quelqu’un voulait construire une centrale au charbon, il irait droit à la faillite. Ici on ne plaisante pas avec le charbon. Tous les jours, des trains longs d’un mile et demi traversent la Mon Line, passant sans jamais s’y arrêter à côté de la gare de Charleroi. Ils transportent l’or noir des mines de Pennsylvanie du Nord vers les centrales électriques de l’Ohio. Un long mur d’acier mobile, qui pendant un quart d’heure chaque jour sépare la ville de sa rivière. Alors, quand Donald Trump a promis qu’il relancerait le charbon et l’industrie, pour protéger l’American way of life, les ouvriers de Charleroi ont senti que quelqu’un les comprenait enfin. Pittsburgh, ville modèle dans la lutte contre le réchauffement climatique, cité phare de la nouvelle économie, n’est qu’à trente miles, mais une frontière invisible sépare la métropole de sa vallée.
Nous avons suivi jusqu’au bout le programme que nos amis nous avaient préparé. Au pas de charge, nous avons visité la verrerie centenaire. Sans le maire, pourtant ancien ouvrier de l’usine. « I’m not welcome there », nous dit-il. Nous n’en saurons pas plus. La fabrique a compté jusqu’à mille ouvriers, quand la ville, au sommet de sa gloire, abritait douze mille habitants. Elle en conserve trois cents, dans une ville de quatre mille citoyens. Les proportions sont respectées, la ville a fondu avec l’industrie qui lui a donné naissance.
Charleroi a-t-elle vraiment été fondée par des verriers wallons ? Après la grande crise de l’industrie du verre dans les années 1880, des milliers de verriers ont quitté la Wallonie, embarquant d’Anvers pour les États-Unis sur le Red Star. Parmi eux, Oscar Falleur, condamné avec son ami Xavier Schmidt à vingt ans de travaux forcés pour incitation à la révolte après les émeutes de Roux de 1886, où une douzaine d’ouvriers tombèrent sous les balles de la gendarmerie. Libéré deux ans plus tard à condition de quitter le pays, il gagna la Pennsylvanie, où il fonda les premières coopératives verrières.

Mais Falleur n’est jamais venu à Charleroi. La ville fut fondée au même moment, non par des verriers carolos, mais par d’authentiques entrepreneurs américains. Détenant les secrets de fabrication du verre plat, que leur avaient transmis des ingénieurs venus de Belgique, ils acquirent un terrain d’un mile sur un mile le long de la rivière et fondèrent deux sociétés : l’une pour gérer l’usine, l’autre pour valoriser le foncier. Le terrain était raide, mais il était bordé de bois qui fourniraient les poutres et planches nécessaires à la construction des habitations. La Charleroi Land Co. traça les plans de la ville au cordeau, en réduisant autant que possible la taille des parcelles pour augmenter les bénéfices. Les maisons des ouvriers occupe- raient une parcelle, celle des ingénieurs en compteraient deux. Toutes seraient de style Queen Anne, copiant les grandes demeures bourgeoises de Washington, elles-mêmes inspirées de l’Angleterre victorienne. Tout serait simplement plus petit, topographie et rente foncière obligent. La ville nouvelle fut baptisée Charleroi par référence à la cité sambrienne, alors capitale mondiale du verre et métropole prospère. Le nom était une marque, un argument de vente. Quand les Carolos arrivèrent, la ville était déjà fondée. Tant pis pour la légende.
Charleroi avait été conçu pour que ses habitants n’en sortent jamais – où seraient-il allés, d’ailleurs ? Chaque bloc comportait vingt-cinq maisons, un bureau de tabac, une épicerie et une mercerie. Quelques parcelles étaient réservées aux bâtiments publics et au business, elles comptaient toutes un nickelodéon, un petit cinéma de quartier. Une plaque de bronze rappelle que l’une des premières salles des États-Unis fut bâtie à Charleroi, en 1905. On pouvait travailler, habiter, acheter et se divertir sans jamais sortir de la ville. La communauté, blottie autour de l’usine, entre la rivière et la forêt, était unie dans le repos comme dans le labeur. Charleroi a échappé aux grandes opérations immobilières de l’Urban Renewal Era. Tout est encore là. Les petites maisons en bois des ouvriers, avec leur terrasse couverte à l’avant et leur pignon pointu. Les magasins début de siècle, et les bâtiments publics comme la Charleroi National Bank and Trust, bâtie en 1922 sur les plans d’un architecte de Washington. Des fonctionnaires avaient imaginé, il y a vingt-cinq ans, classer la moitié de la ville, 1 200 immeubles d’époque, concentrés sur un kilomètre carré, pour attirer les touristes. Certains y repensent. Demain, si les hipsters de Pittsburgh veulent voir à quoi ressemblait une ville américaine au temps des fondateurs, ils n’auront qu’à descendre la route 88, destination Charleroi. Peut-être certains d’entre eux viendront-ils s’y établir, il ne manque pas de maisons à vendre.

Ici on ne plaisante pas avec le charbon. Tous les jours, des trains longs d’un mile et demi traversent la Mon Line, passant sans jamais s’y arrêter à côté de la gare de Charleroi. Ils transportent l’or noir des mines de Pennsylvanie du Nord vers les centrales électriques de l’Ohio.
Les citoyens de Charleroi y croient-ils encore ? Larry, lui, est fatigué. Cela fait bientôt cinq ans qu’il est conseiller municipal, il salue chacun des rares passants par son prénom, mais il ne se représentera pas lors des prochaines élections. Il me montre ses lieux préférés, « the best pizza in town, an amazing BBQ, it’s a shame you don’t have enough time to try them ». Un club de boxe, des boutiques de seconde main et un marchand d’armes. Larry confie ses doutes. La moitié des magasins sont vides, et beaucoup de maisons à l’abandon. On ne sait pas où sont les propriétaires, ils sont partis. Le dernier hôtel a été fermé sur ordre de police, il attirait trop de trafics. La politique, c’est difficile. Trop de plaintes, de résignation, de Charleroi bashing dans les bars et sur Facebook. Pas assez d’argent. Le comté aide la ville mais le gouvernement fédéral ne semble pas savoir qu’elle existe.
Larry me présente le propriétaire du BBQ, qui est en train de construire une nouvelle brasserie. Quand on demande au jeune entre- preneur pourquoi il investit ici, il nous répond :
« I believe in Charleroi. » J’ai déjà entendu ça quelque part. Larry, lui, a retrouvé le sourire. Il veut que nous montions sur le toit de la mairie, d’où on a la plus belle vue sur la ville, et où il rêve d’ouvrir une grande terrasse pour emmener les enfants des écoles. Il faut partir. Le jour tombe et nous avons encore cinq heures de route pour Detroit. En saluant nos amis, j’aperçois sur une vitrine vide un vieil autocollant, qui arbore notre coq. Je m’approche pour lire l’inscription. Charleroi, The Magic City. C’est le slogan inventé par la deuxième génération, au temps où la croissance de la ville était si rapide qu’elle était citée en exemple dans tout le Midwest. Nous avons gardé le surnom, me dit Larry. Dans la vallée, tout le monde nous appelle The Magic City. Certains en se moquant. « But believe me, we’ll make Charleroi a Magic City again ! » —
[:]