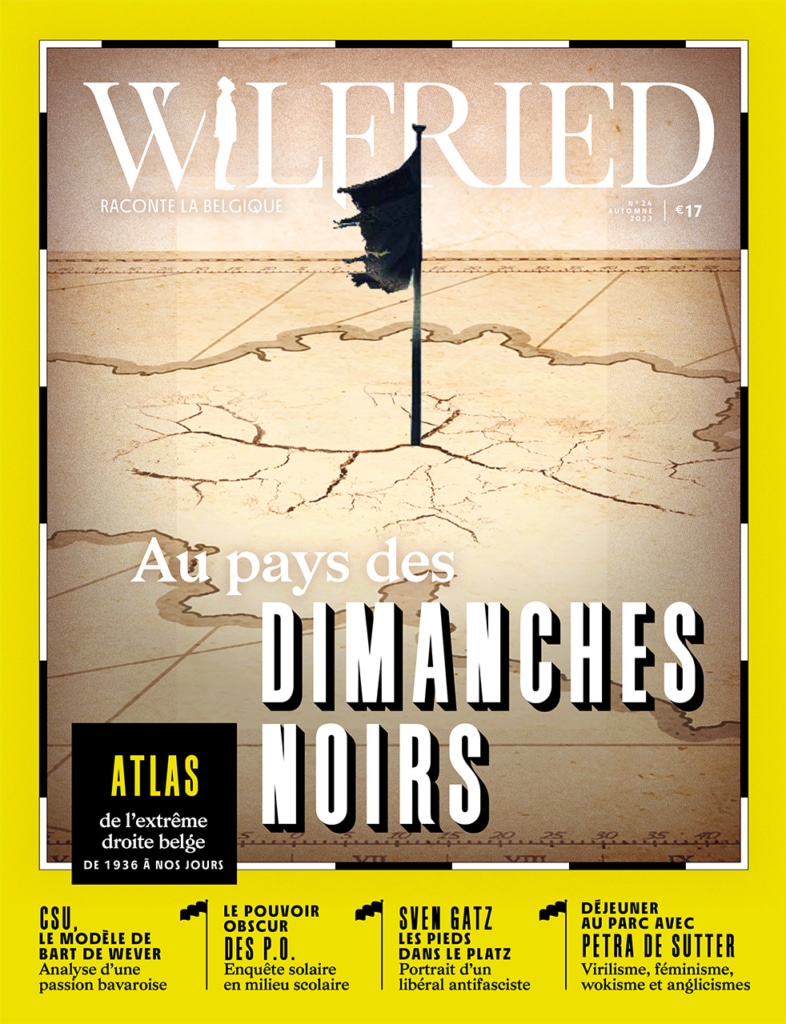Avec son livre « Woke », le président de la N-VA entend dénoncer un péril grave : des revendications victimaires qui sapent selon lui les fondements de la civilisation occidentale. Il cible en particulier les activistes écolos, féministes ou décoloniaux. Cette offensive s’inscrit dans une stratégie théorisée de longue date par Bart De Wever : profiler la N-VA comme un parti conservateur et répandre en Flandre un « nationalisme banal » comme il en existe en Bavière, son modèle. Avant le rendez-vous électoral de 2024, le bourgmestre d’Anvers a longuement rencontré « Wilfried » pour livrer sa vision de « la bataille des idées », une formule associée au philosophe communiste italien Antonio Gramsci, aujourd’hui récupéré par la droite.
Antonio Gramsci est le philosophe préféré de Paul Magnette. C’est aussi un théoricien incontournable pour déchiffrer Bart De Wever. Non en raison de ses orientations politiques : toute l’œuvre de Gramsci a été écrite dans une perspective marxiste révolutionnaire. Mais pour son analyse des rapports de pouvoir et des luttes idéologiques. Les écrits de Gramsci au début du XXe siècle, comme ceux de Machiavel au XVIe siècle, ont ébranlé pour toujours la manière de penser la politique. Rançon du succès : les deux philosophes italiens ont souvent été simplifiés, déformés, instrumentalisés. Réduits à quelque formule trop vite ramassée. « La