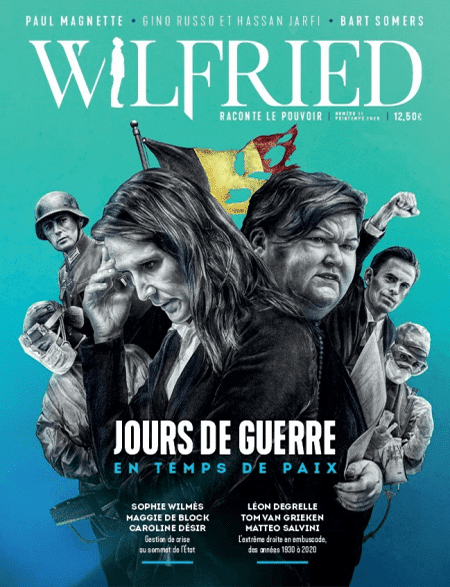En 2019, on était plus chauds que le climat. En 2020, on se lève et on se casse. De l’affaire Polanski à la loi sur l’IVG, du féminicide à l’intersectionnalité, Wilfried a voulu cerner la ligne politique défendue par le président du plus grand parti belge francophone sur le sujet incontournable de l’année : les droits des femmes et les violences qui leur sont faites. Où l’on apprend que le bourgmestre de Charleroi envisageait la construction d’un centre de prostitution, que Pasolini se souvenait de sa vie intra-utérine et que la lutte des classes, quand même, il y a des limites.
C’est un jeudi 5 mars, on a rendez-vous avec Paul Magnette pour un entretien en tête-à-tête sur les féminismes et les droits des femmes. Pendant ce temps-là, Bruxelles se noie. On l’entend gargouiller par tous les pores du macadam. Coulées noires sur ciel blanc sale, et le numéro 13 du boulevard de l’Empereur qui peine à dérider les rares passants, malgré beaucoup d’effort et de plexiglas rouge. On est en avance; on nous laisse aimablement égoutter devant un verre d’eau pendant que notre photographe peine à trouver un semblant de lumière correcte dans cette atmosphère d’aquarium. C’est finalement Paul Magnette