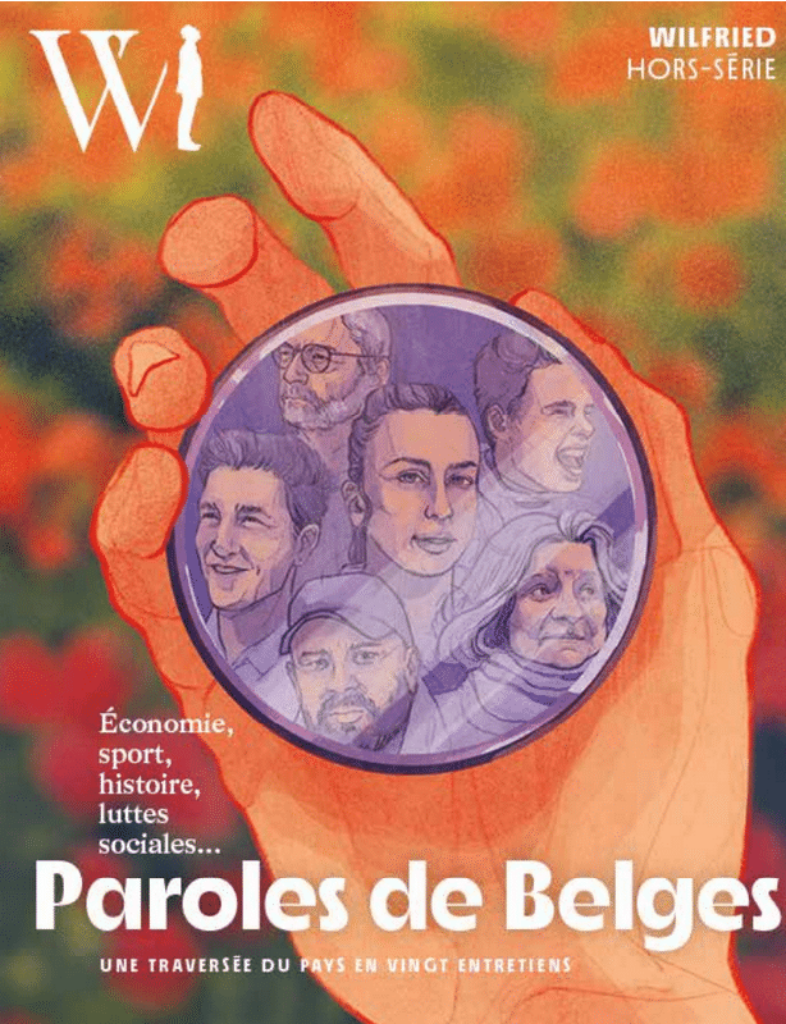Avec la révision de la loi de 2018, l’avortement s’est imposé au centre des débats parlementaires, jusqu’à devenir un enjeu central pour la formation d’un gouvernement fédéral. Huit femmes politiques partagent avec Wilfried leurs réflexions sur ce sujet sensible, où les idéaux croisent le fer avec les zones grises de l’intime. Huit femmes qui, comme dans la bande originale du film de François Ozon, nous parlent de ce que c’est que de vivre libre (Nicoleta), de vivre seule (Dalida), de vivre à pile ou face (Corynne Charby), des papas qui ne sont plus dans l’coup (Sheila), des messages personnels (Françoise Hardy) et de l’amour heureux (Barbara).
[:fr]Isabelle Durant, 65 ans, Ecolo, Ex-vice-Première ministre

— Dans les années 1970, vous militiez pour le droit à l’avortement. Quel était le climat à l’époque ?
On venait d’arrêter le gynécologue Willy Peers pour avoir pratiqué des avortements. C’était l’époque des aiguilles à tricoter, des réseaux secrets. J’ai participé à de grandes manifestations, notamment en 1977, mais il a fallu attendre 1990 pour que la loi soit votée. Aujourd’hui, ce n’est pas fini : il reste toujours à sortir l’avortement du Code pénal pour en faire un acte médical.
— L’hypocrisie demeure ?
Je vois dans beaucoup de pays des situations que j’ai connues il y a trente ou quarante ans en Belgique. Cette hypocrisie qui consiste à croire que parce qu’on n’en parle pas, ça n’existe pas. Chacun a sa morale personnelle et c’est très bien, je le comprends. Mais je considère que le monde politique ne peut pas faire de l’avortement une question morale : il doit en faire une question de droit. Le mélange entre les deux me paraît très préjudiciable : on n’a pas à dire à quelqu’un ce qu’il a à faire. Toute femme qui a été enceinte ne fût-ce que de douze semaines sait que c’est un choix difficile. C’est précisément parce que c’est un choix difficile qu’il faut rendre l’accès facile.
C’est parce que c’est un choix difficile qu’il faut rendre l’accès facile
— Vous êtes infirmière de formation. Est-ce que cela a influencé votre combat en faveur de l’IVG ?
C’est plutôt ma mère. Elle fut une des premières femmes médecins diplômées de l’ULB. Elle était extrêmement ouverte et libre, au-delà des conventions morales et religieuses.
Els Van Hoof, 50 ans, CD&V, Députée fédérale.
 — Vous avez été présidente des femmes CD&V (Vrouw en Maatschappij) pendant treize ans, jusqu’en 2017. Peut-on se revendiquer féministe et s’opposer à l’élargissement des conditions d’accès à l’IVG ?
— Vous avez été présidente des femmes CD&V (Vrouw en Maatschappij) pendant treize ans, jusqu’en 2017. Peut-on se revendiquer féministe et s’opposer à l’élargissement des conditions d’accès à l’IVG ?
Je suis vraiment féministe ! Même au temps où le parti était opposé à la dépénalisation partielle, du temps d’Herman Van Rompuy, le mouvement des femmes CD&V, lui, a toujours été favorable à l’IVG jusqu’à douze semaines de grossesse.
— Lors des débats en commission, vous avez dit : « jeter un fœtus, ce n’est pas comme jeter un préservatif ». Vous sentez-vous obligée de tenir ce genre de propos choc pour faire entendre votre point de vue ?
Oui. Je le fais pour ouvrir les yeux de ceux qui ne veulent pas voir les faits et qui ignorent qu’en Belgique, une IVG coûte 3,5 €. Même les préservatifs sont plus chers.
— Ce n’est pas pour autant que les femmes prennent cette décision à la légère.
Le dernier rapport officiel sur l’IVG, qui date de 2011, indique qu’une femme qui avorte sur trois le fait pour la deuxième fois. Ce rapport dit aussi que les femmes des pays de l’Est voient l’IVG comme un moyen de contraception : ce n’est pas moi qui l’invente. Je souhaite un débat fondé sur les faits et pas sur l’idéologie.
Or, je trouve qu’on est beaucoup trop dans l’idéologie, surtout du côté francophone. Les socialistes pensent que c’est nous qui en faisons une question idéologique mais c’est faux : ce sont eux les idéologues. Le contenu du rapport de 2011, ils ne le connaissent pas ! Et on voudrait en plus modifier la loi avant d’avoir des statistiques plus récentes… Moi, je demande des évaluations sérieuses qui serviront de base pour prendre des décisions et améliorer la pratique.
Une loi conçue avec de bonnes intentions n’engendre pas que de bonnes intentions
— Sur Twitter, vous avez laissé entendre que certains futurs parents pourraient se servir de l’allongement du délai à dix-huit semaines pour avoir recours à l’avortement au cas où le sexe de l’enfant à naître ne leur conviendrait pas.
Une loi conçue avec de bonnes intentions n’engendre pas que de bonnes intentions. Je suis féministe et je peux accepter l’exception… à titre d’exception. Mais en faisant une règle générale des dix-huit semaines, on va trop loin : on banalise l’avortement.
— Est-il opportun que la révision de la loi sur l’IVG, une loi qui concerne les droits des femmes, soit devenue un enjeu central pour la formation du gouvernement ?
Il est vrai que nous avons mis cette question au centre, mais ça ne veut pas dire qu’on ne veuille aucun accord. Simplement, nous voulons un vrai débat, d’autant que l’opinion publique, en tout cas en Flandre, n’est pas du tout favorable à cette nouvelle loi. Ce qui me semble inopportun, c’est de faire passer une loi à propos d’un sujet qui n’a même pas été débattu pendant la campagne électorale.
Christiane Vienne, 68 ans, PS, Ex-ministre wallonne de la Santé.

— Quand avez-vous entendu parler pour la première fois de l’avortement ?
Quand j’étais jeune fille, une de mes amies proches avait consulté pour un avortement. Nous savions que c’était interdit, mais des noms de médecins circulaient. Pourtant, mon amie n’était pas enceinte. Mais comme elle avait eu un rapport sexuel, elle pensait qu’elle l’était nécessairement. Cela vous donne une idée de notre ignorance ! Les femmes connaissaient très peu leur corps. Nous allions dans des écoles de filles. Nous fantasmions beaucoup. C’était un autre monde. Tenir la main d’un garçon était déjà un engagement extraordinaire.
— Vous avez grandi à Mouscron, avec un père pasteur. Était-ce possible de parler de l’avortement dans ce milieu ?
Ma famille était mormone. L’avortement était totalement tabou. La contraception l’était à peine moins. Mais, contrairement à ma sœur, cela me révoltait. Je sentais à quel point il s’agissait d’une contrainte injuste imposée aux femmes au nom de la religion. C’est pourquoi j’ai toujours été favorable à l’avortement. J’ai moi-même eu neuf enfants, mais c’étaient des enfants choisis.
— Votre maternité superlative vous a-t-elle valu des regards suspicieux en politique ?
Bien sûr. Quand j’ai débuté, il m’arrivait fréquemment de m’entendre dire que je n’avais qu’à m’occuper de mes enfants. Quand je suis devenue ministre, cela s’est empiré. La situation des femmes est compliquée… Quand on n’a pas d’enfants, on est une ambitieuse qui sacrifie tout à sa carrière. Quand on en a, on est une mauvaise mère si l’on n’est pas à la maison. J’ai quatre filles, dont deux ne veulent pas d’enfants. Je trouve ça très bien et je ne leur ai jamais dit qu’elles allaient le regretter : pas du tout ! Mais à côté de ça, une femme doit pouvoir avoir le nombre d’enfants qu’elle veut et faire carrière en même temps.
C’est très rare d’être à 100% sûr d’une décision
— Vous, vous vouliez des enfants… beaucoup.
J’avais une vision très romantique de la vie : beaucoup d’enfants, être heureux tout le temps et vivre dans un cocon. Finalement, tout n’a pas été facile et j’ai fini par divorcer. J’ai attendu que mon dernier ait dix-sept ans. Par la suite, mes enfants m’ont dit qu’ils n’avaient pas compris pourquoi je n’étais pas partie plus tôt. Je leur ai répondu : « Mais pour vous ! » Et là, mon fils aîné m’a fait remarquer qu’ils ne m’avaient jamais rien demandé. Parfois, on s’impose de ces scénarios ! Mes filles, elles, ont divorcé quand elles estimaient devoir le faire, enfants ou pas.
— Dans le choix de poursuivre ou d’interrompre une grossesse, il y a souvent aussi de l’ambivalence, non ? On veut l’enfant mais on n’est pas amoureuse du père, on est amoureuse du père mais on ne veut pas l’enfant, on a trompé, on s’est trompée…
Je le pense, absolument. Dans la vie, on est souvent dans le brouillard. C’est très rare d’être à 100% sûr d’une décision. On est souvent à 50%, 70%… Mais, comme je l’ai toujours dit à mes enfants, il faut s’efforcer de ne pas avoir de regrets. Si j’avais dû avorter à cause des circonstances, je l’aurais fait. J’aurais essayé de me dire que c’était un cadeau que je faisais à cet enfant : le cadeau de ne pas venir au monde avec une mère qui n’aurait pas été prête.
— L’avortement vous semble-t-il exclusivement une question de femmes ?
Profondément. À mon sens, la décision revient entièrement à la femme. Bien sûr, de plus en plus de jeunes hommes se sentent pères. Ils veulent la garde alternée, ils s’occupent beaucoup de leurs enfants: c’est le cas de mes deux fils qui ont divorcé. Je m’en réjouis, cela me rend fière : ils n’ont peut-être pas toujours été de super maris mais ce sont de bons pères. Mais ça, c’est pour l’enfant qui est né. Tant que l’enfant n’est pas né, on n’est pas père. Être père, c’est un acte social.
Sofie Merckx, 45 ans, PTB, députée fédérale
 — Vous êtes médecin généraliste. L’IVG fait-elle partie de votre quotidien ?
— Vous êtes médecin généraliste. L’IVG fait-elle partie de votre quotidien ?
Le quotidien des généralistes, c’est plus exactement les grossesses non désirées, qui peuvent ou non aboutir à une IVG. Maîtriser sa fécondité, ce n’est pas une évidence.
Maîtriser sa fécondité est un grand travail pour les femmes
— Vous estimez qu’il y a encore des problèmes d’accès à la contraception ?
Oui, il y a encore du travail à faire, notamment au niveau du coût. Mais, même avec la contraception, nous n’évacuerons jamais la question de l’IVG. N’oublions pas que six femmes sur dix qui avortent sont sous contraception. Il ne s’agit pas que de jeunes filles peu prévoyantes ! Maîtriser sa fécondité est un grand travail pour les femmes.
De l’âge des premiers rapports jusqu’à 50 ans, on risque treize fois par an de tomber enceinte alors qu’on souhaite généralement entre une et trois grossesses, au maximum. Vous imaginez ? Il faut arrêter l’hypocrisie. Qui n’a jamais pris la pilule du lendemain ou ne connaît pas une amie qui a dû la prendre ? Quelle femme n’a jamais été soulagée après un test de grossesse négatif ou l’arrivée des règles ?
On peut vomir avec la pilule ou simplement ne plus être sous contraception parce qu’on n’avait plus de partenaire et avoir un rapport sexuel quand même. Quand j’entends certains dire « elles n’ont qu’à se protéger », j’ai envie de demander : qui dans la salle n’a jamais eu un rapport non protégé ? Personnellement, je me suis fait ligaturer les trompes il y a deux ans et, depuis, j’ai une vie plus tranquille.
— D’un point de vue médical, que pensez-vous de l’allongement du délai de douze à dix-huit semaines de grossesse ?
À dix-huit semaines, il y a zéro chance de survie. Ce n’est qu’à partir de vingt-deux semaines qu’on peut pratiquer des soins intensifs pour les bébés désirés. On est encore à quatre semaines de différence. Et pour les bébés de vingt-deux semaines, les chances de survie ne sont que de 50 %, avec un risque de handicap important.
Kattrin Jadin, 39 ans, MR, députée fédérale
 — La question de l’IVG vous a-t-elle toujours mobilisée ?
— La question de l’IVG vous a-t-elle toujours mobilisée ?
Oui, parce qu’elle relève de la liberté de décider de son destin en tant que femme. Je pense que le législateur n’est pas un juge.
— Cela vaut-il dans tous les dossiers ?
La première fois que je me suis fait cette réflexion, c’était au sujet de l’euthanasie des enfants. Il faut se documenter, il faut approfondir, oui, car le sujet est extrêmement délicat. Au final, je me dis : qui suis-je pour ne pas octroyer une liberté à celui qui estime être dans une souffrance insupportable ? J’ignore ce que je ferais face à une grossesse non désirée mais qui suis-je pour dire à une autre qu’elle ne peut pas avorter si elle le veut ?
Le législateur n’est pas un juge
— Voici le corps des femmes remis au centre des négociations gouvernementales. Qu’est-ce que ça vous inspire ?
L’IVG déchaîne encore les passions. C’est un sujet qui renvoie chacun à soi-même. Il y a de l’irrationnel, des fausses informations qui circulent. Cela me gêne quand la presse en parle uniquement comme d’un fait politique : c’est un sujet de société.
Marie Nagy, 62 ans, Défi, députée bruxelloise
 — Quel est votre premier souvenir lié à l’IVG ?
— Quel est votre premier souvenir lié à l’IVG ?
Celui de Simone Veil. Cette femme très déterminée, au milieu d’une assemblée d’hommes. Sa force, mais aussi sa douceur : ce mélange capable de faire avancer la société.
— Vous êtes née et avez grandi à Bogotá. Votre mère est colombienne, votre père hongrois. Quelle éducation avez-vous reçue sur ces questions ?
Je me souviens d’avoir un jour parlé de l’avortement avec ma mère, qui est très croyante. J’étais révoltée par la position de l’Église et ma mère me disait : « Tous ces curés, tu sais, ils ne peuvent pas comprendre… ». Elle pensait que ce n’était pas de l’hypocrisie mais que réellement il y avait là quelque chose que les hommes ne saisissaient pas. Mon père, lui, était très féministe. Nous étions trois filles et ils voulaient que nous soyons autonomes.
Il faut se mettre à l’abri d’une magistrature qui serait plus conservatrice
— La Hongrie, comme la Pologne, a fait demi-tour sur le droit à l’avortement.
Pendant toutes les années de communisme, jusqu’en 1989, l’avortement ne posait pas de difficultés dans les pays de l’Est. La législation protégeait totalement les femmes. C’est pourquoi, y compris en Belgique, il faut se mettre à l’abri d’une magistrature qui serait plus conservatrice. Je trouve qu’aujourd’hui déjà, il y a moins de liberté de ton. La religion, par exemple, est un sujet que je n’aborde pas volontiers si je ne suis pas dans un cercle que je connais. Or, ce qui va avec la religion, c’est un rapport aux femmes empreint d’inégalités, de soumission à l’homme et à Dieu.
— Vous parlez de toutes les religions ?
Il me semble que même chez le dalaï-lama, la femme n’est pas tout à fait l’égale de l’homme… En tant que femme, oui, je me méfie des mouvements religieux.
— Il y a aussi de nombreuses femmes parmi les militants anti-IVG.
Les femmes ont parfois été le bras armé des causes anti-femmes, dans une sorte de syndrome de Stockholm. Elles reproduisent l’oppression vis-à-vis de leurs filles, à l’image de celles qui pratiquent l’excision. Le moment magique, c’est quand une femme âgée libère les plus jeunes des règles des hommes.
Darya Safai, 44 ans, N-VA, députée fédérale

— Vous êtes née et avez vécu en Iran jusqu’à vos 25 ans. Parliez-vous de sexualité ?
Dans un régime totalitaire islamique, tout cela était tabou. Dans les années 1980, l’ayatollah Khomeini encourageait la natalité afin de renflouer les rangs des soldats de l’Islam. Les préservatifs étaient interdits. Ici, nous avons la contraception : c’est pourquoi il me semble important de sensibiliser à la prévention. Il faut prévenir car après, on parle d’une vie humaine.
— L’IVG et la contraception ne sont-elles pas complémentaires ?
Une femme peut oublier sa pilule. Ok : elle doit avoir le choix. Mais il ne s’agit pas d’enlever une dent. Je crois qu’il faut faire des efforts vis-à-vis des femmes qui viennent de pays où tout cela est tabou et qui arrivent chez nous sans être informées.
Qui sont les femmes qui veulent avorter après trois mois?
— L’IVG concerne aussi des femmes nées en Belgique et sous contraception…
Oui, mais pourquoi aller au-delà de trois mois de grossesse ? Qui sont les femmes qui veulent avorter après ce délai ? Est-ce que ce sont des femmes qui ont grandi ici ? Ou des femmes qui viennent d’arriver et ne connaissent pas les possibilités en matière de contraception ? Je ne montre pas du doigt : je demande une étude. Je veux savoir pourquoi elles ne l’ont pas fait avant et si, parfois, il n’y a pas un homme qui les pousse à le faire.
Vanessa Matz, 46 ans, CDH, députée fédérale
 — Quand avez-vous été confrontée pour la première fois à la question de l’IVG ?
— Quand avez-vous été confrontée pour la première fois à la question de l’IVG ?
Au début de mes études de droit, une amie très proche a avorté : je suis la première personne à qui elle en a parlé. À cette époque, j’avais un point de vue très théorique. Je pensais qu’il était souhaitable de réserver l’avortement à des cas de viol, de maladie. Une fois qu’on est confrontée à une situation qui n’entre pas dans ces cases, la réflexion évolue.
Pour cette amie, ce n’était pas l’histoire d’un soir mais ce n’était pas non plus l’histoire de sa vie. La poursuite ou non de cette grossesse conditionnait la suite de sa carrière. Nous avons partagé une soirée de réflexion et ce choix nous est finalement apparu comme une évidence. Plus tard, j’ai eu d’autres amies qui n’étaient ni légères ni complètement allumées et à qui c’est arrivé. Des femmes qui étaient dans des zones grises, qui avaient voulu un enfant pour sauver un couple qui battait de l’aile et se rendaient compte que ce n’était pas une solution. Des femmes dont le couple a d’ailleurs explosé quelques semaines plus tard.
— Ces situations singulières ont donc modifié votre point de vue?
Sans aucun doute. Je venais d’un milieu préservé et, comme beaucoup de Belges, d’un milieu chrétien, quoique ouvert sur ces questions. Car je voudrais quand même dire que je suis très blessée de cette caricature qui est faite aujourd’hui des « cathos ». Ce qui m’énerve le plus est cette idée qu’il y aurait d’un côté les progressistes et puis les autres. C’est absolument réducteur. Tout libre-penseur attaché à la vie humaine doit avoir cette réflexion sur l’IVG, qu’il soit catho ou pas catho.
On ne parle pas d’un bout de caoutchouc
— Il vous semble qu’on évacue le débat sous couvert de progressisme ?
Voilà. Je suis terriblement choquée par le fait que le CDH n’ait pas été associé au groupe de travail sur cette loi. Un député a dit que nous les aurions « tirés vers le bas » ! C’est une manière d’enfermer les élus et les citoyens dans des antagonismes dont ils ne veulent pas.
Les valeurs humanistes incluent le respect de chacun, avec ses orientations philosophiques, sexuelles. Pourquoi serions-nous les méchants qui ne voudraient pas évoluer sur l’avortement ? C’est faux. La réduction du délai de réflexion, Catherine Fonck l’avait déjà proposée en 2018. La levée des sanctions pénales, nous n’avons aucun problème avec ça. Nous ne sommes pas à mettre dans le même sac que le CD&V qui ne veut pas du tout de cette loi et en fait la condition de la formation d’un gouvernement.
— CD&V et CDH se rejoignent néanmoins sur le refus de l’allongement du délai de douze à dix-huit semaines de grossesse. Quelle est votre position personnelle ?
Je suis minoritaire au sein du parti car, contrairement à Catherine Fonck, je suis prête à monter un peu plus haut. Pas jusqu’à dix-huit semaines, mais jusqu’à quatorze. En allant jusque-là, on pourrait atteindre la majorité des femmes qui partent aujourd’hui aux Pays-Bas parce qu’elles ont dépassé le délai. C’est une position pragmatique. Mais je n’irai pas au-delà : jamais je ne voterai les dix-huit semaines. On ne parle pas d’un bout de caoutchouc.
— Vous avez eu de graves problèmes de santé au cours des dernières années, notamment une algie vasculaire de la face, appelée « maladie du suicide » en raison des douleurs intolérables qu’elle provoque. Cette grande souffrance a-t-elle fait évoluer vos positions sur certains sujets ?
C’est interpellant que vous me posiez la question. Cela paraît au départ sans lien, mais je pense que le lien existe. Non, en fait : j’en suis sûre. On ne voit pas les choses de la même manière quand on souffre. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi ce que j’ai et, pourtant, je considère que c’est une expérience très riche. Avec mon esprit de juriste, je pouvais me montrer un peu rigide.
Je suis toujours attachée à la rigueur, mais j’ai aussi compris que la détresse humaine ne se réglait pas par la loi. La souffrance physique m’a aidée à comprendre la souffrance morale des femmes et à la relayer de manière plus juste, notamment en matière de violences conjugales. Peut-être suis-je prête à monter à quatorze semaines dans le dossier IVG pour cette même raison. Au début, ça me vexait beaucoup qu’on me le dise, mais je dois l’admettre : la souffrance m’a rendue plus humaine.[:]