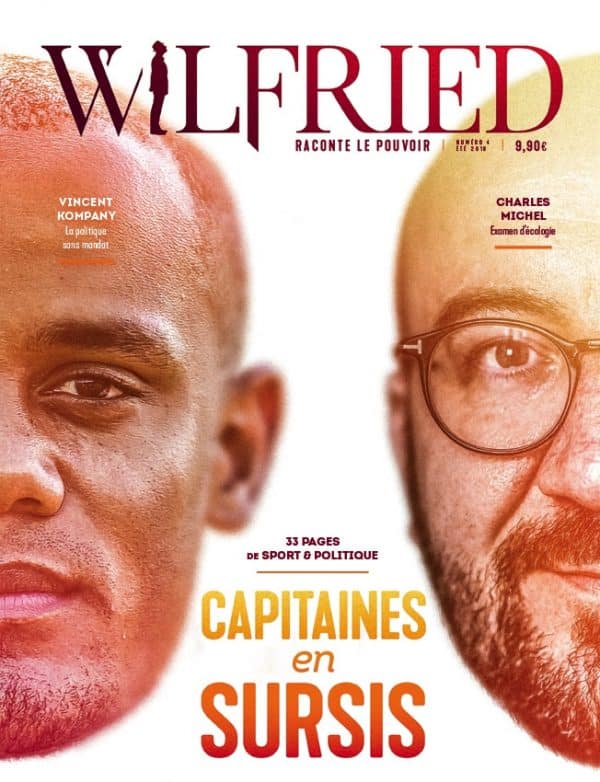Ce devait être une simple entrevue chez la gynécologue, la rencontre a dérapé en séance de cinéma dystopique, entre classiques de la science-fiction et palmarès cannois. Mais la confusion des genres, Petra De Sutter connaît, à la fois spécialiste européenne de la fertilité, Groen cooptée et première parlementaire belge transgenre. Un long entretien des salles obscures aux salles de travail, à la poursuite du pouvoir politique des utérus.
« On vous a déjà dit que vous ressembliez à Charlotte Rampling ? » La longue silhouette de Petra De Sutter tangue maladroitement devant les flashs du photographe. Elle répond par la négative. Son visage constellé et ses mèches vénitiennes s’amusaient déjà au jeu des sept erreurs, mais ce sont réellement ses yeux, bleus et en amande, qui citent presque par cœur la filmographie de l’actrice britannique : Embrassez qui vous voudrez, Swimming Pool, Melancholia du fameux Lars von Trier, Les Damnés, mais surtout ses incursions dans la science-fiction ; l’oublié Zardoz, Babylon A.D. de Mathieu Kassovitz ou Never let