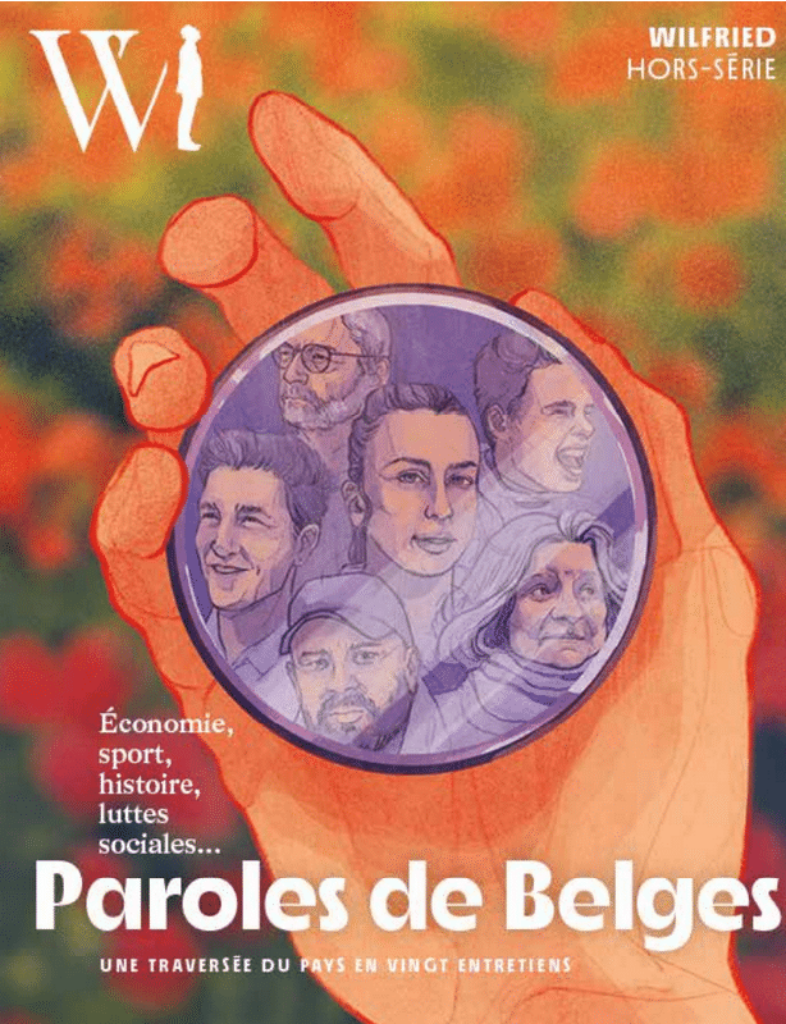Il est des contes où les princesses excellent à se soustraire à l’intrigue principale. Benjamine adorée de Léopold III et demi- sœur d’Albert II, issue d’un second lit politiquement explosif, Esmeralda de Belgique a grandi derrière les grilles d’Argenteuil avant de se muer journaliste en bord de Seine, puis épouse londonienne d’un Hondurien nobélisable. Son engagement écologiste et féministe, d’un progressisme à faire frémir Laeken, n’empêche pas un tact tout aristocratique.
[:fr]
Bon sang bleu ne saurait mentir. À l’interphone, les intonations mi-métalliques, mi-roucoulantes indiquent le quatrième étage, ascenseur ouvrant directement sur le vaste séjour presque nu, où les reliquats de l’accent Cobourg, caractéristique des premiers monarques belges, résonneront longtemps sur l’enregistrement.
En jeans Levi’s, perfecto bleu dur et col roulé noir, Esmeralda de Belgique, 62 ans, déplace sa silhouette de jeune fille avec quelques frissons — il neige dehors et elle arrive de Londres à l’instant — en quête de ce café qu’elle s’est proposé de préparer. C’est qu’elle n’occupe que par intermittence cet appartement sis, dirait l’agence immobilière, dans une résidence de standing, d’où l’on distingue les jardins de l’abbaye de la Cambre: depuis son mariage avec le scientifique d’origine hondurienne Salvador Moncada, en 1998, Esmeralda de Belgique vit pour l’essentiel dans la capitale britannique, même si elle a gardé la nationalité de son nom et vote ici même.
Il faut n’avoir jamais vu une photo de Lilian Baels — profil de danseuse andalouse et grâce un rien sévère — pour n’être pas frappé par la ressemblance de la princesse avec sa mère. Fille de la grande bourgeoisie ostendaise, Lilian Baels épouse Léopold III en l’an de disgrâce 1941, alors que la Belgique est occupée et que le gouvernement, réfugié à Londres, tente d’organiser la résistance autour du Premier ministre social-chrétien Hubert Pierlot. Le roi, resté en Belgique, se constitue prisonnier des Allemands, mais trouve le loisir de ce remariage d’amour. Hitler envoie fleurs et félicitations. Un temps tenues secrètes, les épousailles seront d’autant plus mal accueillies par l’opinion qu’elles semblent balayer le souvenir de la populaire reine Astrid, tragiquement disparue dans un accident de voiture, quelques années plus tôt.
Tel est le destin de certaines progénitures : devoir inlassablement rendre compte des faits de leurs parents, et jusqu’à leur moindre geste anténatal.
Lilian Baels, qui devient princesse de Réthy, est dès lors instaurée marâtre de la nation : séduisante effigie de l’aveuglement d’un roi face au nazisme, intrigante belle-mère de conte de fées, façonnant les futurs rois Baudouin et Albert II. Au sortir de la guerre, ce mariage sera l’un des ferments toxiques de la Question royale — Léopold III devait-il ou non rentrer en Belgique ? — qui divisa le pays entre gauche et droite, Flamands et Wallons, territoires ruraux et industriels. De soubresaut en soubresaut, le roi se résoudra à l’abdication en 1951, cinq ans avant la naissance d’Esmeralda.
« Ma mère m’a toujours dit que ce mariage avait été une erreur, mais qu’ils vivaient alors en pensant qu’ils allaient peut-être mourir, qu’ils ne verraient peut-être jamais la fin de la guerre. » Tel est le destin de certaines progénitures: devoir inlassablement rendre compte des faits de leurs parents, et jusqu’à leur moindre geste anténatal. Peut-être n’est-il alors pas insensé de prendre les devants, comme Esmeralda de Belgique le fit en collaborant à plusieurs documentaires et livres consacrés à l’histoire familiale. « Cela correspondait à une période de ma vie, mais cette page est tournée », résume-t-elle, jouant d’une main distraite avec sa boucle d’oreille fantaisie.
D’autres chevaux de bataille ont depuis envahi le champ. En 2010, la princesse, journaliste de son métier, fait paraître Terre !, plaidoyer environnemental dans lequel elle s’entretient avec des pointures telles que Mikhaïl Gorbatchev ou Mario Vargas Llosa, par la grâce des facilités diplomatiques. Elle publie quatre ans plus tard Femmes prix Nobel de la paix, où elle donne la parole à la Birmane Aung San Suu Kyi ou encore à Ellen Johnson Sirleaf, alors présidente du Liberia. En 2016, elle sollicite une rencontre avec le pape François, qu’elle juge «formidable, très ouvert » pour le sensibiliser au droit des peuples indigènes avant son voyage en Amérique latine. Son mari, qui l’accompagne alors au Vatican, a depuis intégré l’Académie pontificale des sciences, chargée d’informer le pape sur les grands sujets de ce monde. Pour autant, le couple n’est pas croyant : si leurs enfants sont baptisés, c’est, explique la princesse, « par respect » pour sa mère qui y accordait grande importance.
Les nobles causes ont beau avoir évincé l’enquête familiale, la figure du père demeure obsédante, en partie irréconciliable avec le personnage historique. Et ce n’est pas le testament officiel du roi, intitulé Pour l’Histoire et dans lequel son remariage est grossièrement passé sous silence, qui eût pu éclairer les choses. « Tout le monde sait que le mariage de mes parents était le nœud du problème. Si mon père était là aujourd’hui, avec tout ce que j’ai découvert, tout ce que j’ai lu, je lui aurais demandé de me raconter plus. »
Aurait-il commis des erreurs, il n’en serait pas moins aimé. « Qui suis-je pour parler de politique ? Moi, j’ai connu l’homme. Je pouvais tout dire à mon père, et parfois, nous n’avions même pas besoin de parler. » Quand naît Esmeralda, Léopold III a 55 ans. Avec Lilian de Réthy, il a eu précédemment deux enfants : Alexandre et Marie-Christine, en 1942 et 1951. Sa petite dernière sera la véritable complice de sa nouvelle vie, placée sous le signe des voyages, en Amazonie notamment, et de la photographie, qu’il pratique assidûment, jusqu’à constituer une collection d’importance. Esmeralda de Belgique mettra un point d’honneur à l’archiver, l’exposer et la publier. « J’ai eu la chance de connaître mon père à une période de sa vie où il pouvait s’adonner à ses passions. J’ai connu un homme apaisé. »
Étrange deuxième acte que celui entamé à Argenteuil en 1961, alors que Léopold III est prié par le gouvernement de quitter le château de Laeken, qu’il partageait jusqu’alors avec son fils, le roi Baudouin. Lequel, plus tard, sera l’objet de curieuses rumeurs remuées épisodiquement.
Leur dernière résurrection, des œuvres du Laatste Nieuws, date de mars 2019 : à en croire le quotidien flamand, l’ancien Premier ministre Achille Van Acker — dont les archives viennent d’être rendues publiques — aurait été témoin d’une prétendue idylle secrète entre Baudouin et Lilian, entre le beau-fils et la belle-mère, qui remonterait au début des années 1950. Comme si le conte de fée manquait de trash. Mais reprenons le cours officiel de l’histoire. Dans le domaine verdoyant du château de Laeken, au sud de la forêt de Soignes que prolonge au nord le bois de la Cambre visible depuis l’appartement de la princesse, émerge une cour royale parallèle, moins guindée, plus maligne, gentiment artiste.
On y reçoit Stanislas-André Steeman — qui fait rire la compagnie en imitant Baudouin —, Eddy Merckx ou le comédien Jean Piat, célèbre pour son rôle de Cyrano, une pièce que la jeune Esmeralda s’empresse d’apprendre par cœur. « Adolescente, je voulais être actrice. La possibilité d’être différents personnages me fascinait. » Soucieux de décourager cette vocation, ses parents lui dépeignent la concurrence impitoyable. Plongée dans la solitude crasse au milieu du beau monde — « Je ne côtoyais pas de jeunes de mon âge. Je ne savais pas ce que c’était que de partager, de discuter » —, elle doit pourtant penser à l’avenir. C’est qu’il faudra, toute princesse qu’on est, prendre un métier, car pas plus que son frère et sa sœur, Esmeralda n’est dynaste.
Contrairement aux enfants du premier lit, elle ne peut prétendre au trône et n’a droit à aucune dotation, cependant qu’elle échappe dans le même temps à tout devoir de réserve. La chance d’une vie, estime celle qui plaint ceux de ses apparentés soumis aux règles d’une monarchie qu’elle juge « anachronique ».
Si ce n’est la comédie, l’écriture pourrait faire l’affaire. Le journalisme n’est plus si loin. « J’avais aussi peur que l’idée déplaise à mon père, que la presse avait beaucoup malmené, mais il était tout à fait d’accord. Il disait que journaliste était le plus beau métier du monde, à condition qu’il soit exercé avec honnêteté. Mais bien sûr, il n’était pas question que je m’occupe de politique belge. » Pour cette jeune femme qui n’est jamais allée à l’école et n’a pour camarades que de vagues cousins, l’arrivée aux facultés Saint-Louis s’assimile à un « tremblement de terre». L’entrée dans l’arène est d’autant plus rude que les regards repèrent instantanément dans l’auditoire la fille de Léopold III.
Une jeune Canadienne, par son ignorance, lui sauvera la mise. Au départ de ce premier copinage, Esmeralda devient une étudiante comme une autre, qui sèche les cours pour battre les cartes à la cafétéria, s’ennuie un peu et ne brille que par intermittence. Son ascendance royale lui sert, quand il s’agit d’entrer en contact avec le baron Empain, à l’enlèvement duquel elle consacre son mémoire. Son ascendance amuse, lorsque ses initiales laissées dans La Libre Belgique, où elle est stagiaire, donnent au journal satirique Pan l’occasion de cette boutade : ces articles sont-ils signés par Emily Brontë, Emma Bovary ou Esmeralda de Belgique ?
Qu’elle ait de la première la fougue et de la seconde le petit rêve d’une autre vie n’est pas exclu. Diplômée, elle fait ses premières armes au Figaro Magazine, alors dirigé par Louis Pauwels, ami d’amis de la famille. Elle prend alors le nom de « de Réthy », donné à sa mère après son mariage et qu’utilisait déjà son grand-père Albert Ier lors de ses voyages. La rédaction parisienne, certes brillante, n’est pas exempte de miasmes machistes. Et son positionnement « très à droite » n’enthousiasme pas tout à fait la jeune journaliste, fille de roi certes, mais fille de sa génération, en quête d’égalité tous azimuts dans ces primes années 1980.

Esmeralda de Réthy devient alors pigiste dans la presse magazine, espagnole et italienne notamment, s’occupant de décoration, réalisant des interviews d’artistes et de scientifiques. Elle mènera plus de quinze ans cette vie de freelance, déménageant d’un arrondissement à l’autre de Paris, goûtant les plaisirs d’un relatif anonymat. Pendant ce temps, sa mère, veuve de Léopold III depuis 1983, se ronge les sangs. « Ma mère était obsédée par la question de mon mariage car elle voulait absolument des petits-enfants, que ni mon frère ni ma sœur ne lui avaient donnés. Or, elle pensait qu’avec mon métier, je ne me marierais jamais. » Mais à 42 ans, Esmeralda épouse in extremis Salvador Moncada, membre du conseil scientifique de la Fondation Lilian. « Ma mère ne voyait pas ce mariage d’un bon œil. D’abord parce qu’elle trouvait que mon futur mari était beaucoup plus âgé que moi, alors que nous avons douze ans d’écart et qu’elle en avait quinze avec mon père… Ensuite, parce qu’il était divorcé. Enfin, parce qu’il n’était pas catholique. »
La naissance des petits-enfants — Alexandra en 1998 et Leopoldo en 2001 — fera finalement oublier à la princesse Lilian ses réticences. Elle meurt en 2002, apaisée de se savoir une descendance. Après son mariage, la princesse Esmeralda déménage à Londres, mais précise — la boucle d’oreille qu’elle triture en tombe — qu’il ne s’agit en aucun cas d’un acquiescement à « la culture macho qui veut que ce soit toujours à la femme de sacrifier sa carrière » : plutôt une décision logique, liée aux engagements de son mari. Car l’homme n’est pas un scientifique de carrure étroite. Anobli par la reine d’Angleterre, sir Moncada aurait été pressenti deux fois pour le prix Nobel de médecine. Lilian Baels croyait dur comme fer qu’il en avait été écarté à cause de manœuvres souterraines, liées à ce mariage avec sa fille.
Consolation peut-être : leur fille Alexandra, aujourd’hui étudiante en biologie moléculaire, devrait se lancer dans la carrière scientifique. Pour l’heure, il n’est pas rare de l’apercevoir au bras de sa mère dans les galas de charité, silhouette pulpeuse et longue chevelure brune. Dans une interview publiée dans Paris Match, le duo affichait l’été dernier sa complicité, s’indignant de conserve que toutes les femmes aient été harcelées au moins une fois dans leur vie. « J’ai connu les mains déplacées, mais certainement beaucoup moins que d’autres car j’étais protégée par mon nom », estime Esmeralda.
La princesse a fait état de ses positions en faveur de l’IVG, sujet hautement inflammable au sein de la monarchie belge.
La princesse n’a pas attendu l’affaire Weinstein pour parler droits des femmes. Elle a fait état publiquement de ses positions en faveur de l’interruption volontaire de grossesse, sujet hautement inflammable au sein de la monarchie belge. Sur son compte Twitter, les #stopviolenceagainstwomen, #womeninspire et autres #womensrights sont légion. Une fibre qu’elle dit n’avoir pas héritée de sa mère, ce garçon manqué aux allures de diva, qui adorait la chasse et les sports, mais estimait que les femmes étaient intrinsèquement inférieures aux hommes en littérature comme en art culinaire. « C’est tellement injuste comme jugement, quand on sait comment les femmes ont été tenues à l’écart de ces domaines .» Inutile encore d’aller chercher du côté sa grand-mère la reine Élisabeth, correspondante de Colette certes, mais qui s’accommoda fort bien de la condition de son sexe. « Quand on vient d’un milieu protégé, d’une certaine manière, on ne peut pas comprendre. C’est uniquement parce que j’ai vécu seule, que j’ai eu des amis dans tous les milieux, de toutes nationalités, que j’ai pu imaginer les difficultés des autres femmes. »
L’engagement en faveur de l’environnement, c’est autre chose. Une passion qui se confond avec l’amour du père, qui associa très tôt Esmeralda à son « Fonds pour l’exploration et la conservation de la nature », dont elle est aujourd’hui la présidente. Pour Michel Genet, ancien directeur de Greenpeace Belgique et actuel directeur politique d’Ecolo, sa démarche est de toute évidence « super sincère ». Il a connu Esmeralda de Belgique en 2015, à l’occasion d’un colloque consacré à l’exploration gazière et pétrolière en Arctique.
Le colloque se tenait précisément au château d’Argenteuil, mis en vente par l’État après la mort de Lilian de Réthy, et finalement racheté par l’homme d’affaires Jean-Marie Delwart. « C’est un endroit auquel j’étais très attachée, que je voulais garder comme patrimoine national, commente la princesse. C’était un choc qu’il soit mis en vente, mais heureusement, le nouveau propriétaire est passionné par la nature, comme l’étaient mes parents. » Sur la suggestion de Delwart, Michel Genet demande à Esmeralda d’assurer le haut patronage de l’événement. Elle deviendra par la suite l’une de ses amies, mais surtout une amie très proche du Sud-Africain Kumi Naidoo, alors patron international de Greenpeace. « Elle a hérité de son père le naturalisme et comme beaucoup de naturalistes — mais pas tous —, elle a fait le pas d’un engagement pour la protection de la nature à un engagement pour la transition, estime Michel Genet. C’est une femme qui, sous ses dorures de princesse, tient un discours très engagé et très proche de ce que pensent beaucoup de progressistes. » Politiquement limpide, Esmeralda ? « Je pense que sur les enjeux environnementaux, comme sur la cause des femmes et la justice sociale, elle n’est en effet pas très loin d’un parti comme Ecolo. »
Sur les réseaux sociaux, la princesse s’est aussi fait le relais actif de la marche des jeunes pour le climat. Elle, la princesse de 62 ans, sait depuis longtemps qu’elle a un rôle moins excitant à jouer qu’Anuna De Wever, mais que ce rôle lui est imparti. Ainsi consacre-t-elle une partie de son temps à sensibiliser les « grands donateurs », ceux-là mêmes dont l’apport pécuniaire fait la différence pour les associations environnementales, ceux-là mêmes qu’on convie dans des dîners entre gens du même monde, ceux-là mêmes qui sont d’accord pour sauver la planète, pourvu qu’une princesse le demande.
Surprenante princesse qu’Esmeralda, antithèse apparente de son aînée Marie-Christine, qui coupa les ponts avec sa famille après son mariage éclair, au début des années 1980, avec un pianiste de bar québécois et homosexuel, et les lourdes dettes qui s’ensuivirent. Dans son bureau londonien, chaleureux cube boisé où elle se tient lors de notre second entretien par Skype, des cadres s’affichent en arrière-plan comme autant de légendes. Il y a des photographies réalisées en Colombie par Léopold III. Un portrait d’Alexandra avec sa demi-sœur, fille de Moncada. Un autre de son mari. Et une qu’elle est fière de nous montrer, la célèbre photo du Che, dédicacée par son auteur Alberto Korda, qui n’obtint jamais un sou pour ce cliché aussi mythique que christique. Un peu révolutionnaire, un peu midinette, la princesse rappelle que pour les gens de sa génération, Ernesto Guevara était une icône, un point c’est tout. À la voir dans ce décor aux allures de boîte à musique, une hypothèse s’insinue : si Esmeralda dégage plus de liberté que d’autres sujets du royaume, c’est peut être parce qu’elle a toujours su qu’elle n’échapperait pas totalement aux règles du jeu, que cet accent Cobourg continuerait de tapisser l’arrière de ses phrases, que les armoiries lui colleraient toujours vaguement à la peau, que son ouverture d’esprit serait toujours un peu, vue de loin, une manière de racheter le père et tous ceux qui l’ont précédé, jusqu’à Léopold II et à la conquête coloniale, jusqu’à la première mainmise des puissants et la première révolte de ceux qui voulurent y échapper. De son vrai prénom, Marie-Esmeralda, elle n’a d’ailleurs jamais utilisé que la moitié: la bohème rebelle contre l’éternel féminin biblique. « Mon père a choisi mon nom lors d’un voyage au Venezuela. Là-bas, il y a une montagne aux reflets verts que les Espagnols ont baptisée Esmeralda car ils pensaient qu’elle était recouverte d’émeraudes, mais il s’agissait en fait d’un genre de quartz, une pierre semi-précieuse. » Semi-précieuse parmi les ridicules, quartz couleur nature au milieu des ors rutilants, Esmeralda est la preuve faite femme que la monarchie en toc, dans ses marges, bouge encore.—
[:]