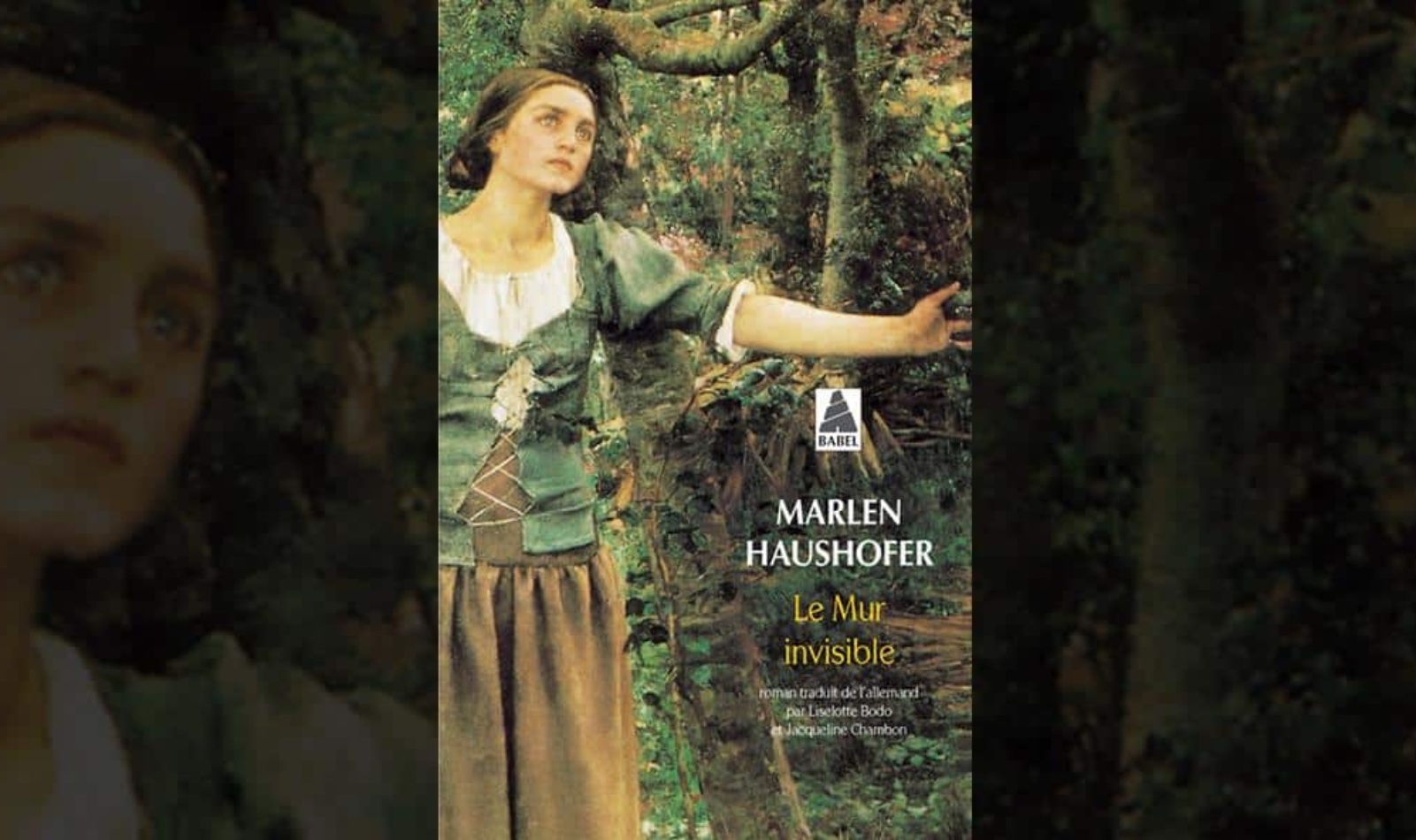Écrit en 1963 par Marlen Haushofer, une Autrichienne de 43 ans, « Le Mur invisible » est le roman dont il est urgent de s’emparer en ces temps bouleversés. Urgent au regard de sa grâce. Urgent au regard de la lumière qu’il jette sur notre actuel confinement.
[:fr]Un événement surnaturel arrive et renverse tout ce qu’on pensait savoir du monde. C’est ce qu’on appelle une expérience limite : une situation si remarquable qu’elle rend banales ou ordinaires toutes les autres formes d’expérience. Celle que traverse l’héroïne du Mur invisible reste, quand on a eu la chance de le lire, l’objet d’un choc — et d’une fascination qui ne s’efface pas. Le livre se rappelle à nous constamment depuis l’adoption du confinement. Le mur invisible, c’est celui qui s’érige, l’espace d’une nuit, entre la narratrice du roman et le reste du monde. Invitée en début de printemps dans un chalet de chasse, elle s’y réveille un matin mystérieusement esseulée. Partie chercher âme qui vive sur un chemin au silence ahurissant, elle sent sa tête buter contre un obstacle indétectable à l’œil nu.
«Une résistance lisse et froide à un endroit où il ne pouvait y avoir que de l’air. » Plus de voix humaine à la radio, plus rien qui bouge dans la vallée : la catastrophe qui l’a inexplicablement épargnée semble, de l’autre côté de ce qu’il faut bien appeler un mur infranchissable, d’une envergure sans précédent — ne la décrit-elle pas comme un poison qui sévit sur l’entendue du territoire ? « Cela ne pouvait tout simplement pas être vrai, de telles choses ne pouvaient pas arriver et même si elles arrivaient, ça ne pouvait pas être dans un petit village de montagne, ni en Autriche, ni en Europe. Je sais qu’il était ridicule de raisonner ainsi, mais c’est ce que j’ai pensé à ce moment-là, c’est pourquoi je ne veux pas le taire. »
Écrit et publié dans le contexte de la guerre froide (on y a vu, à l’époque, la traduction du cauchemar de l’escalade militaire, et de la hantise de voir surgir des armes susceptibles d’anéantir un pays entier), Le Mur invisible n’invite pas à un voyeurisme d’apocalypse ou de désolation ; il s’agit plutôt d’un récit antispectaculaire. Face à l’inconnu radical (combien de temps ? pourquoi ?), l’expérience de la narratrice fait l’effet d’un calme laboratoire de lucidité sur l’espèce humaine, l’appréhension de la valeur d’une vie et l’expérience du temps.
« Face à l’inconnu radical, l’expérience de la narratrice fait l’effet d’un calme laboratoire de lucidité sur l’espèce humaine ».
Comme tout bon récit survivaliste, le livre fascine en premier lieu par la faculté de résistance et de réorganisation de son héroïne dans un espace-temps arbitrairement suspendu. Jour après jour, saison après saison, on la voit se vouer à une suite de tâches éreintantes désormais inscrites au calendrier de sa survie (les foins, la traite de la vache, la culture de pommes de terre et de haricots). Mais c’est tout son être-au monde qui est bouleversé, et elle a besoin de le penser — à quoi l’écriture, et la tenue d’un journal de bord (celui-là même qu’on a sous les yeux), la pousse naturellement. « J’ai entrepris cette tâche pour m’empêcher de fixer yeux grands ouverts le crépuscule et d’avoir peur.»
Le caractère absolument inédit de la situation en empêche un sentiment d’expérience. Tout est à réinventer. À l’image de l’ancienne identité de la narratrice, le modèle de société (capitaliste, inégalitaire, patriarcale, écocide) dans lequel elle évoluait sans le questionner est devenu caduc avec une rapidité affolante. « Maintenant que les hommes n’existent plus, les conduites de gaz, les centrales électriques et les oléoducs montrent leur vrai visage lamentable. On en avait fait des dieux au lieu de s’en servir comme objets d’usage. » Au milieu d’une nature largement indifférente qui reprend ses droits, on observe, médusé, le ballet de réajustement de cette femme — ce réajustement à la volonté consciente, à l’essentiel.
Aujourd’hui, le mur invisible est partout. Comment ne pas y penser, à contempler un printemps insolent derrière une vitre, à deviner les autres sous des masques ? Il fait barrière à l’ancienne vie normale, il rive chacun, chacune de nous à un horizon angoissant de distance, à la plus grande incertitude. Confinés certes, mais continuellement abreuvés, interconnectés, sur-informés, enjoints à une productivité spéciale pour moment particulier, nous baignons dans un présent saturé. Le confinement à l’intérieur du confinement guette, qui ferait presque regarder la dure mais magnifique robinsonnade de l’héroïne de Marlen Haushofer comme un état d’avant — un fantasme de silence devenu impossible aujourd’hui.
Où trouver de l’espace pour inventer la suite ? « J’avais perdu l’ancien mais je n’avais pas encore gagné ce qui était nouveau : ce nouveau me restait inaccessible mais je savais qu’il existait. Je ne sais pourquoi, cette pensée suffit à me remplir d’une sorte de joie timide. » Le Mur invisible n’est pas un antidote au confinement, il n’est pas un divertissement pour s’en évader ; il agit en éclaireur. Il revient de loin, réparer nos détresses et nous questionner sur le monde dans lequel on acceptera de ressortir. —[:]