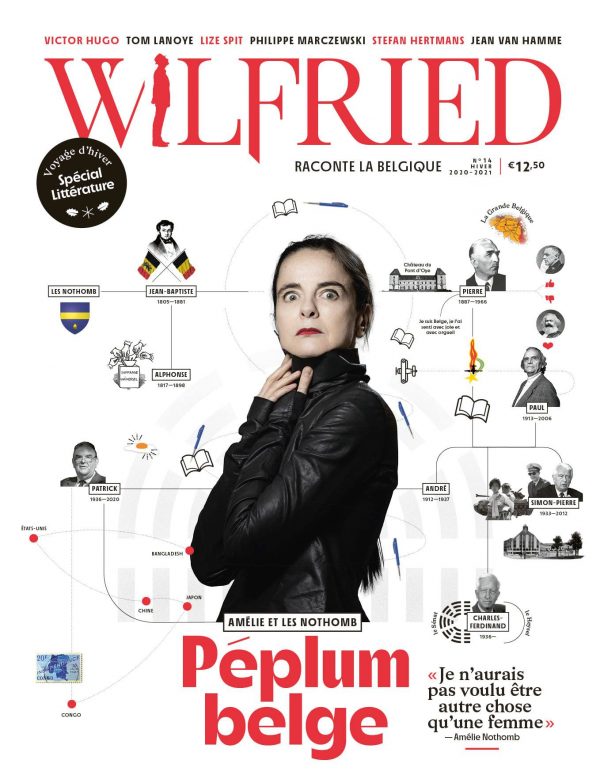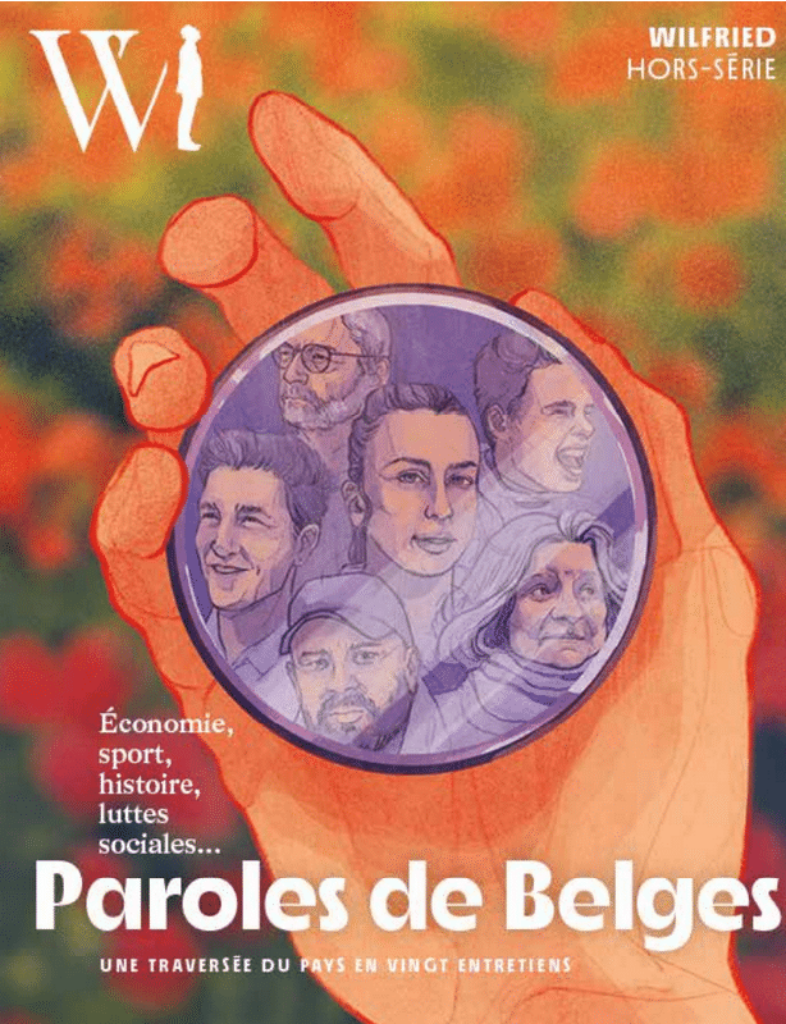Un méchant virus l’a sorti de sa réserve académique : le Frank-tireur au frank-parler est de retour. Et il y a plus étonnant encore que son come-back comme ministre de la Santé dans le gouvernement De Croo : c’est retrouver Vandenbroucke si vite, et tellement pareil à lui-même après dix ans d’éclipse. Non sans premiers accrochages…
Froid à pierre fendre, Frank Vandenbroucke ? Alors, vous ne l’avez pas vu le 28 octobre dernier devant la presse, après une visite des soins intensifs au CHC MontLégia. On comprend ça : le coronavirus et les médias, faut pas abuser ! Situons : nous sommes au flux fort de la deuxième vague, à Liège, la région d’Europe à l’hospitalisation la plus saturée. C’est soudain voix tremblante et yeux embués que le nouveau ministre fédéral de la Santé expose : « Ce que j’ai vécu ici, c’est très douloureux. Je trouve ça très choquant… » Larmes de crocodile ? Évidemment non ! Vraie émotion ? Mais oui bien